Du site de Valeurs Actuelles :
Le neurologue Xavier Ducrocq rétablit la vérité médicale sur le cas Vincent Lambert
Xavier Ducrocq
Mardi 2 juillet 2019
Chef du service de neurologie du CHR de Metz-Thionville, le professeur Xavier Ducrocq rétablit la vérité médicale sur le cas Vincent Lambert : l'homme, dont l'euthanasie a débuté mardi matin, n'est pas en fin de vie ou en situation d'obstination déraisonnable. “Arrêter ses traitements”, c'est simplement le laisser mourir de faim.
Vincent Lambert va mourir. Ainsi en ont décidé ses médecins - pour la quatrième fois en six ans, au CHU de Reims - et la “justice des hommes” rendue par la Cour de cassation, vendredi 28 juin. Au mépris des mesures provisoires de suspension de cette décision demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées (CIDPH) de l'Onu, la seule instance spécialisée dans le domaine du handicap.
Que lit-on et qu'entend-on à son sujet ? Citons quelques médias : « Vincent Lambert, symbole du débat sur la fin de vie », en « situation d'obstination déraisonnable », « arrêt des traitements », « en état végétatif irréversible » et même, de la bouche de la ministre des Solidarités et de la Santé : « Vincent Lambert n'est pas en situation de handicap » , expression reprise par le Dr Leonetti, auteur de la loi qui porte son nom. Vérités ? Non ! Pour nous qui avons pu approcher Vincent Lambert, mensonges.
SUR LE MÊME SUJET : Affaire Vincent Lambert : ce que dit (vraiment) le rapport des experts
Mais qui est Vincent Lambert ? Pourquoi nous annonce-t-on la date de sa mort, sinon parce qu'elle est programmée ? Ce que de rares pays voisins appellent “euthanasie” ?
Qui peut croire à une fin de vie qui s'éternise depuis six ans ?
Vincent Lambert n'est pas un « symbole » , mais une personne. Marié, père d'un enfant, sévèrement handicapé depuis un accident de voiture, en 2008. Il est lourdement paralysé et surtout en état de conscience altérée - c'est-à-dire que nous sommes incapables de préciser son niveau de conscience, parce qu'aucun code de communication fiable ne le permet. Pourtant, Vincent Lambert respire seul, il a des cycles de veille et de sommeil, tourne la tête, vocalise parfois, agite la jambe gauche. Il réagit à la présence de ses proches. Il est même capable de déglutir un peu de nourriture. En 2013, Vincent a résisté à trente et un jours de privation de toute nourriture, avec une hydratation minimale. Si bien que pour recommencer, dans quelques jours, on assortira cette privation d'alimentation d'une sédation profonde, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Au nom de la loi !
SUR LE MÊME SUJET : [Tribune] L'appel de cent juristes pour sauver Vincent Lambert
Lire la suite
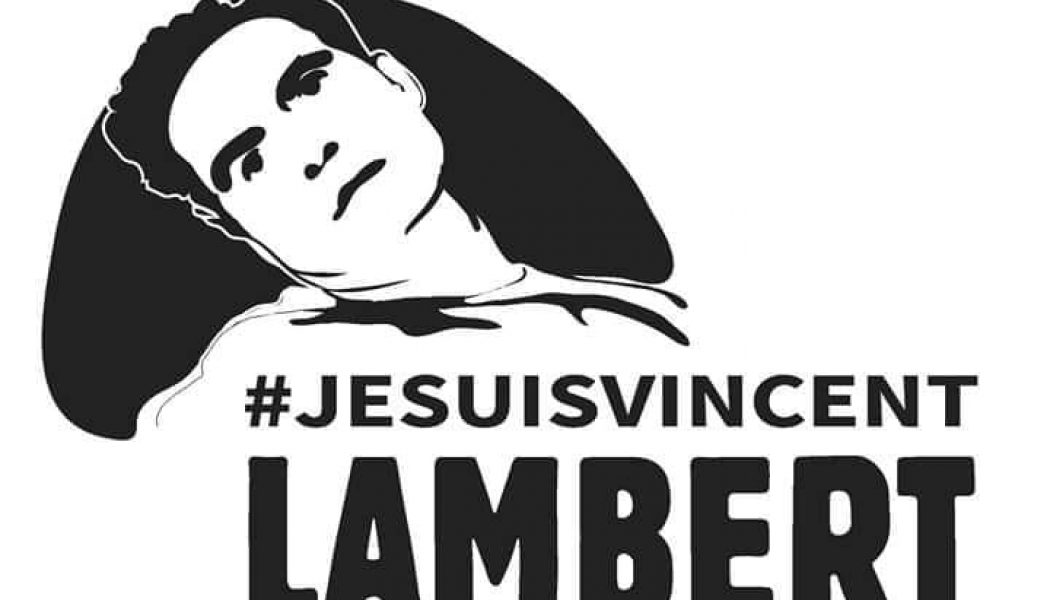


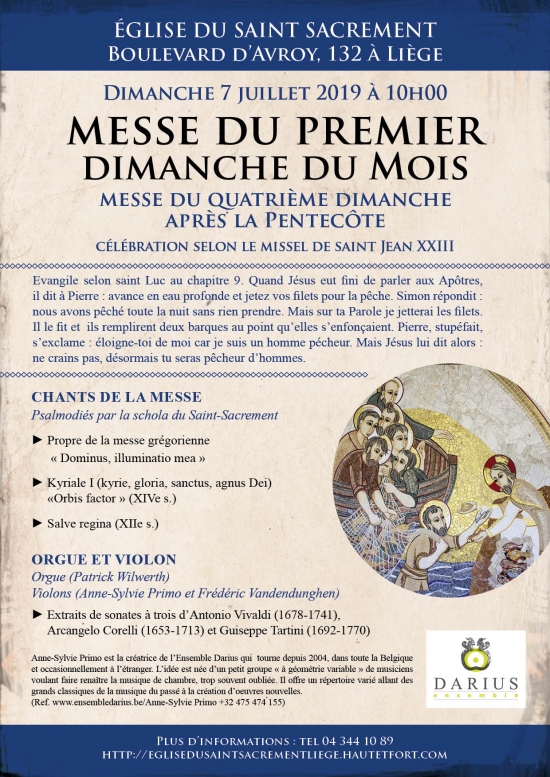
 Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la
Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la 

