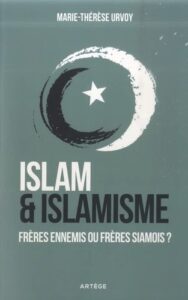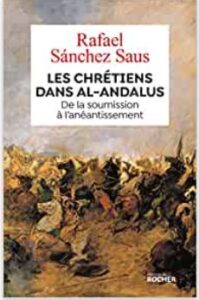De Massimo Introvigne dans le quotidien italien "Il Mattino" du 3 avril 2022, repris sur Bitter Winter :
Le pape François à Kiev : et s'il y allait ?
"Si" le Pape se rend à Kiev, il pourrait rassembler, et peut-être mettre de l'ordre, dans ce que certains considèrent comme des déclarations contradictoires sur la guerre.
Que se passera-t-il si le pape se rend à Kiev ? Bien sûr, dans cette question, pour l'instant, le mot clé est "si". François a déclaré que l'option de se rendre dans la capitale ukrainienne est "sur la table". Cela ne signifie pas qu'une décision a déjà été prise.
Mais "si" le pape se rend à Kiev, quelles seraient les raisons de sa visite ? Qu'est-ce qui changerait dans la position de l'Église catholique sur la guerre ? Et qu'est-ce qui pourrait changer dans la guerre elle-même ?
Il faut se rappeler qu'au cours des premières semaines de la guerre, François a appelé à la paix et a parlé du conflit en termes sincères. Il a exprimé une souffrance qu'il serait en effet peu généreux de ne pas considérer comme sincère. Cependant, il n'a pas condamné l'agression russe sans équivoque. Tant aux États-Unis qu'en Ukraine et en Europe de l'Est (moins en Italie), il a reçu quelques critiques à ce sujet.
Le pape n'est resté insensible ni à ces critiques ni à l'augmentation tragique du nombre de civils, y compris des enfants, tués par les bombardements russes en Ukraine. Le 20 mars, le ton a changé. François a rappelé à l'Angélus que "des missiles et des bombes sont tombés sur des civils, des personnes âgées, des enfants, des mères enceintes" et a dénoncé "l'agression violente contre l'Ukraine, un massacre insensé où se répètent chaque jour massacres et atrocités."
Tout le monde comprend que s'il y a une "agression violente contre l'Ukraine", il y a un agresseur, et ce ne sont pas les Ukrainiens. Il manquait encore la référence explicite à Poutine et à la Russie, mais cela fait partie de la tradition de l'Église catholique, qui n'appelait même pas Hitler et Staline par leur nom lorsqu'elle dénonçait leurs idéologies et leurs crimes. Des politiciens italiens comme Matteo Salvini et Silvio Berlusconi condamnent également la guerre sans jamais mentionner Poutine, mais ce qui pour ces politiciens est une tactique pour François et l'Église catholique est une tradition et une stratégie.
Cependant, le 24 mars, s'adressant à des femmes catholiques, le pape a déclaré qu'il avait "honte" en lisant qu'"un groupe d'États s'est engagé à dépenser deux pour cent de son PIB pour acheter des armes, en réponse à ce qui "est maintenant" : c'est de la folie", ajoutant : "La vraie réponse n'est pas plus d'armes, plus de sanctions, plus d'alliances politico-militaires, mais une autre approche, une manière différente de gouverner le monde."
Les risques dans lesquels François court lorsqu'il improvise sans texte préparé sont bien connus, et ils ne sont pas seulement liés à la langue italienne (où il a fait quelques erreurs dans ce discours - et significativement aucune traduction anglaise officielle n'a été publiée par le Vatican). En Italie, tout le monde a pensé à un soutien papal à l'ancien Premier ministre Giuseppe Conte (qui avait en fait été le premier à s'engager à augmenter les dépenses militaires à deux pour cent du PIB lorsqu'il était en fonction) dans sa polémique contre l'actuel Premier ministre Mario Draghi sur le budget de l'armement, et en général les paroles du Pape ont ravi le front pro-russe.
Puis, le 25 mars, François a consacré la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie en référence au message que, selon les croyants catholiques, la Vierge a confié en 1917 à trois enfants bergers à Fatima, au Portugal. Dans ce message, la consécration était demandée pour faire face au risque que "la Russie répande des erreurs dans le monde entier". La Russie, et non l'Ukraine ou les États-Unis. Tous les médias ne connaissent pas le dialogue ininterrompu entre les papes des XXe et XXIe siècles, qui les ont tous pris très au sérieux, et les révélations de Fatima. Mais pour ceux qui le savaient, la référence était claire.
Or, l'annonce d'une éventuelle visite à Kiev fait suite à celle d'une prochaine rencontre avec le patriarche de l'Église orthodoxe russe Kirill, l'un des plus fervents partisans de Poutine : une rencontre prévue depuis un certain temps mais qui semblait avoir été annulée.
Y a-t-il une grande confusion au Vatican ? Je ne le pense pas. Le pape, parlant d'autres sujets, a répété à plusieurs reprises que le "Catéchisme de l'Église catholique" promulgué par Jean-Paul II reste le texte normatif de référence pour les catholiques, auquel lui aussi, en tant que "fils de l'Église", obéit. Malgré les attaques des évêques allemands qui voudraient abandonner un texte qui ne les convainc plus sur les questions morales, le renoncement au Catéchisme n'est pas à l'ordre du jour du Vatican.
François a confié au Cardinal Secrétaire d'Etat Pietro Parolin la tâche d'expliquer patiemment que le Catéchisme, d'une part, au numéro 2315, condamne sévèrement les dépenses des Etats en armements, et d'autre part, au numéro 2308, affirme que, jusqu'à ce que des accords internationaux souhaitables convainquent tous les pays de renoncer aux armes de guerre, un Etat attaqué par un autre a le droit et même le devoir de les utiliser. Il n'y a aucune contradiction entre les deux thèses.
En outre, l'Église enseigne également que les pays ont le droit de se défendre contre le terrorisme, et aujourd'hui, Al-Qaïda et ISIS disposent de véritables armées et d'armes de guerre. Si seuls ces groupes avaient des armes de guerre, et non ceux qui les combattent, nous serions tous à la merci des terroristes.
Il est vrai que le Catéchisme, au numéro 2309 - et Parolin l'a rappelé - affirme également que le recours aux armes n'est justifié que lorsqu'il y a "de sérieuses perspectives de succès." Mais cela ne signifie pas qu'il est illégal de résister à un ennemi qui semble être beaucoup plus fort militairement, sinon la chrétienté aurait dû se rendre plusieurs fois aux Turcs, et le monde à Hitler. Le "succès" ne signifie pas non plus la victoire totale et la destruction de l'adversaire. Il signifie aussi gagner sur le terrain des conditions plus favorables dans une négociation de paix, qui, sans une résistance efficace, n'aurait pas été une négociation mais une reddition inconditionnelle.
"Si" le pape se rend à Kiev, il sera certainement conscient que sa photographie avec Zelenskyy contribuera puissamment à la cause ukrainienne, quoi qu'il en dise, même si plus tard, nous ne savons pas quand et où, il se fera également photographier avec le patriarche Kirill. Mais s'il se rend à Kiev, c'est pour redire ce que - avec une certaine confusion lorsqu'il s'agit de parler à bâtons rompus - lui et l'Église disent depuis quelques semaines.
Que la paix reste l'étoile polaire de tout discours chrétien sur les conflits, que cette fois il y a eu une agression et que la résistance est légitime, mais que le but de la résistance est d'arriver à des négociations de paix équilibrées, où personne ne se rend et où chacun sacrifie quelque chose. Un discours pour Zelenskyy, bien sûr, mais pour qu'il signifie aussi Poutine.