Sur le site de Radio Vatican, le point de vue du Cardinal libanais Béchara Raï, patriarche des Maronites
« (RV) Les points les plus controversés de la relatio post disceptationem sont parmi les sujets les plus discutés en Europe et plus globalement en Occident. Même si les questions liées aux divorcés remariés et aux homosexuels sont également présentes partout dans le monde, des catholiques de certaines régions du monde se sentent moins concernées pour diverses raisons.
C’est le cas au Liban, représenté à ce synode extraordinaire sur la famille par le cardinal Béchara Raï, patriarche d’Antioche des maronites. Il revient, au micro de Xavier Sartre, sur les travaux en cours dans les carrefours linguistiques et sur les controverses.
Ecoutons le Cardinal Béchara Raï :
Notre contexte est tout à fait différent. Nous n’avons pas les problèmes de l’Europe. Pourquoi il y a-t-il ces problèmes en Europe ? En Europe, le problème n’est pas seulement une nouvelle culture de genre, le changement profond des mentalités dans le monde. En Occident, l’État légifère sans aucune considération de la loi divine, que ce soit la loi révélée ou la loi de la nature. C’est pourquoi tout est ouvert. Il n’y a pas de limites.
Chez nous, au Liban et au Moyen-Orient en général, il y a la séparation entre la religion et l’État mais il n’y a pas de séparation entre l’État et Dieu comme c’est le cas en Occident dans le sens de tout ce qui est religieux, on l’appelle statut personnel et tout ce qui est mariage et effet civil relèvent des compétences religieuses, pas de l’État. L’État ne légifère en rien sur ce qui est contraire à la loi divine ou qui concerne le mariage et les effets civils. Ceci nous protège. Nous avons d’autres problèmes. Nous n’avons pas le problème des unions libres, ça n’existe pas. Nous n’avons pas les problèmes des divorcés-remariés, nous n’en avons pas pour les catholiques. Les homosexuels, nous n’en avons pas. On ne les a jamais reconnus. Le Parlement ne légifère pas sur l’avortement. Nous sommes protégés. C’est pourquoi nos problèmes sont tout à fait différents.
Nos problèmes sont des problèmes de guerre. Le problème du changement de religion pour pouvoir obtenir le divorce. Vous avez des familles, des conjoints catholiques qui embrassent l’islam pour divorcer ou bien qui changent de confession pour être orthodoxes. Il y a très peu de cas. Notre grand problème, c’est le problème économique des familles pauvres à cause de la guerre, des conflits. Et aussi, le grand nombre de réfugiés et l’émigration.
On a tendance à opposer ceux qui sont plus attachés à la doctrine et ceux qui sont peut-être plus attachés à une pastorale un peu plus compréhensive envers les personnes. Selon vous, comment concilier ces deux positions ?
Ce sont des questions qui ont été très débattues. Mais ils sont tous arrivés à dire qu’il faut toujours unir la vérité et la miséricorde, la justice et la réconciliation, la doctrine et la pratique. On a toujours insisté sur cela. Je pense que ça va rester. Prenez par exemple l’Évangile de l’enfant prodigue. Son père lui a laissé la liberté de partir. Il est parti. Mais quand il est rentré, il a été traité avec miséricorde. Quelqu’un disait « Comment pouvoir parler de compassion avec des gens qui ne reviennent pas ? » Il faut qu’ils reviennent pour que nous ayons la compassion et la miséricorde.
Ref. Regard du Cardinal Raï sur le synode pour la famille
JPSC
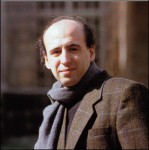 1. CINQ WEEK-ENDS AVEC MARCEL PÉRÈS, DIRECTEUR DE L’ENSEMBLE ORGANUM ET DU CIRMA (Centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes).
1. CINQ WEEK-ENDS AVEC MARCEL PÉRÈS, DIRECTEUR DE L’ENSEMBLE ORGANUM ET DU CIRMA (Centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes). 2. CYCLE DE COURS D’INITIATION AVEC STÉPHAN JUNKER, PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE DE VERVIERS
2. CYCLE DE COURS D’INITIATION AVEC STÉPHAN JUNKER, PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE DE VERVIERS