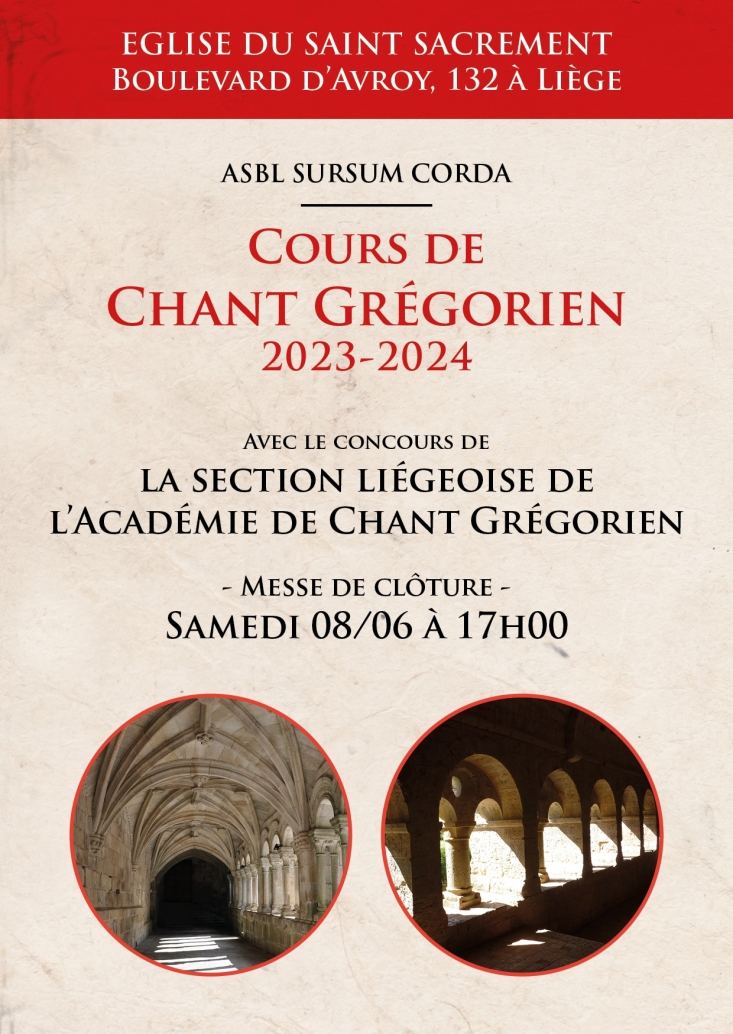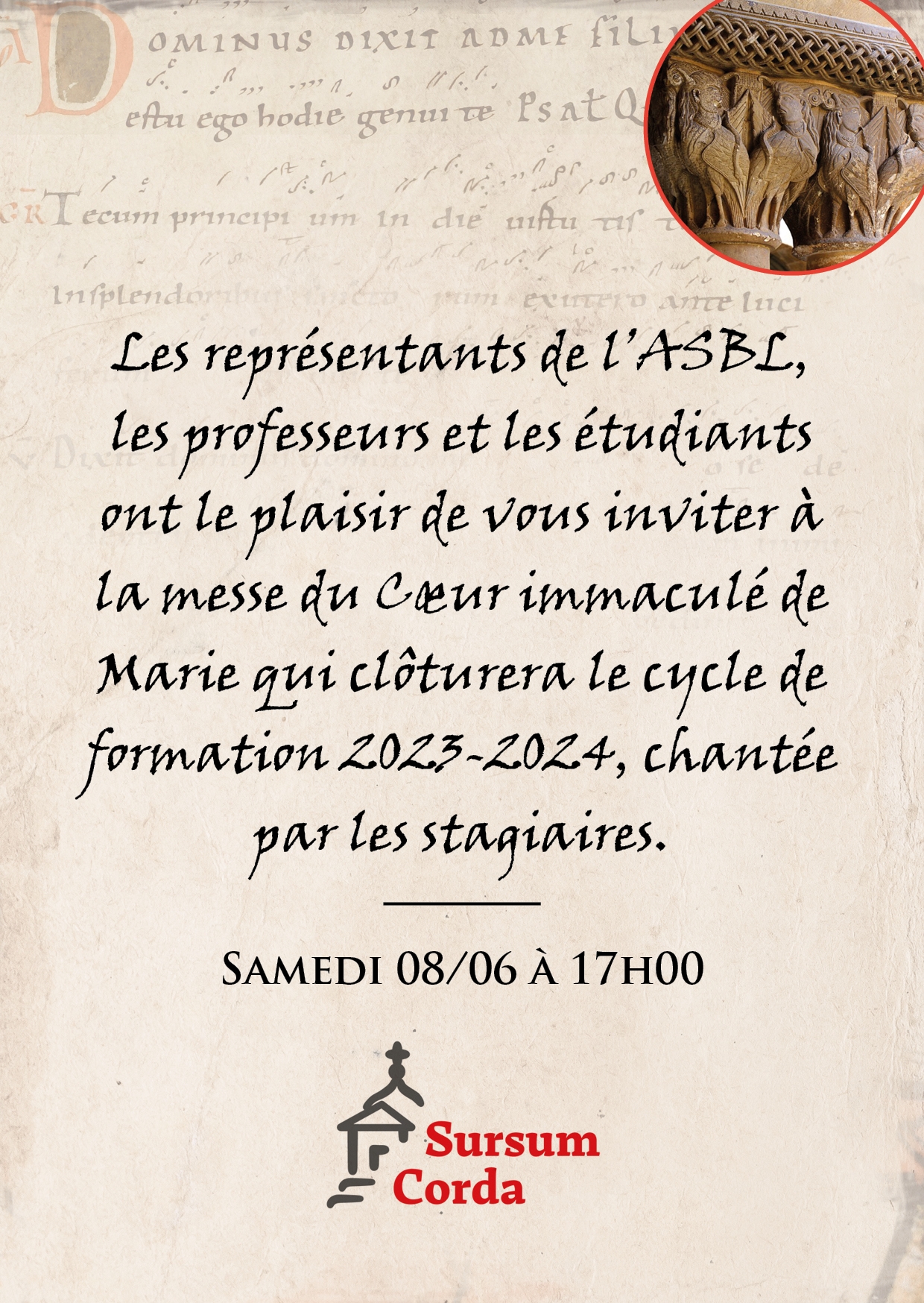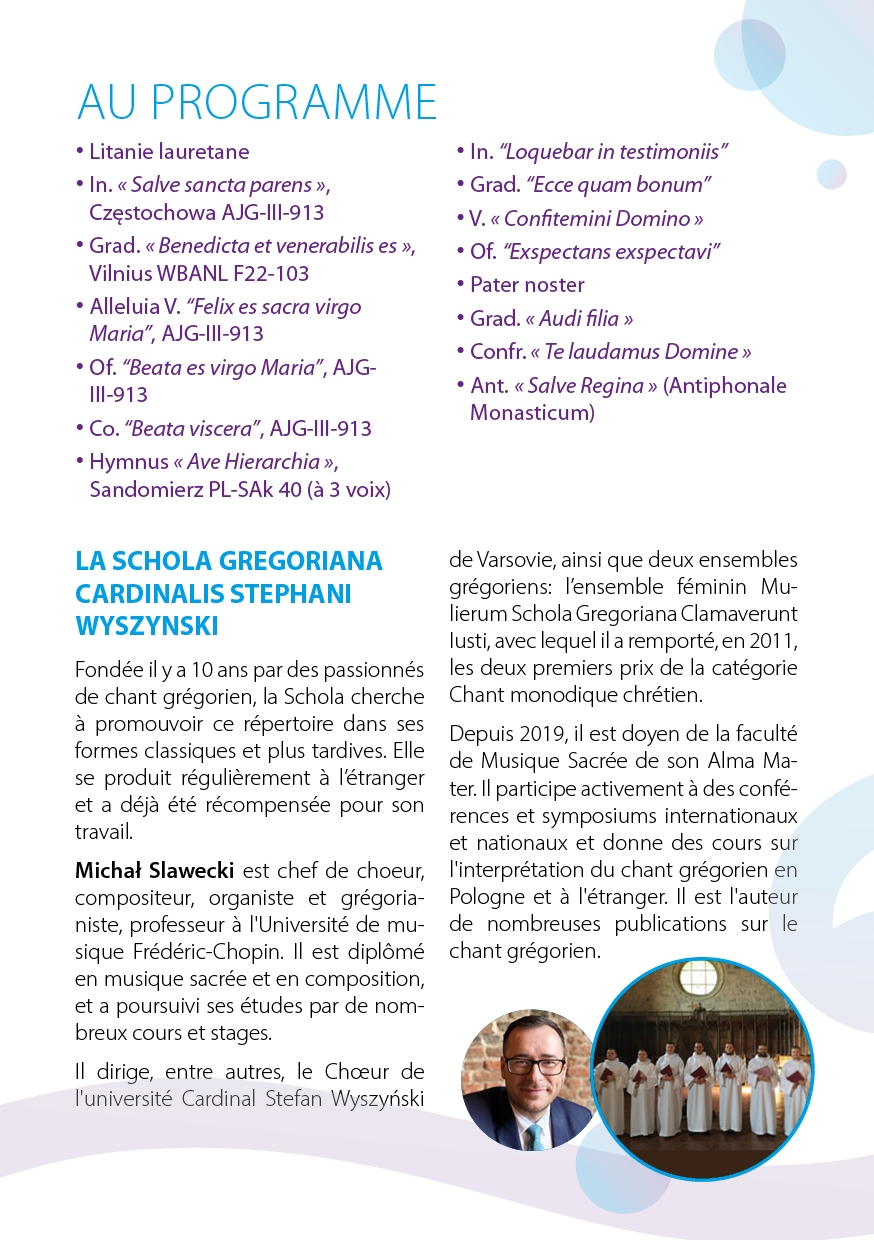DISCOURS DE SA SAINTETÉ LE PAPE FRANCOIS
AUX COMEDIENS
Salle Clémentine
Vendredi 14 juin 2024
(source (en anglais) - traduction automatique)
________________________________________
Chers amis, chères amies,
J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et d'exprimer ma gratitude aux membres du Dicastère pour la culture et l'éducation qui ont organisé cette réunion.
Je vous tiens en haute estime en tant qu'artistes qui s'expriment à travers le langage de la comédie, de l'humour et de l'ironie. Parmi tous les professionnels qui travaillent à la télévision, au cinéma, au théâtre, dans la presse écrite, dans les chansons et sur les médias sociaux, vous êtes parmi les plus aimés, les plus recherchés et les plus populaires. Certes, c'est parce que vous êtes très bon dans ce que vous faites, mais il y a aussi une autre motivation : vous avez et cultivez le don de faire rire les gens.
Au milieu de tant de nouvelles sombres, plongés comme nous le sommes dans de nombreuses urgences sociales et même personnelles, vous avez le pouvoir de répandre la paix et les sourires. Vous faites partie des rares personnes qui ont la capacité de s'adresser à tous les types de personnes, de générations et de milieux culturels différents.
À votre manière, vous fédérez les gens, car le rire est contagieux. Il est plus facile de rire ensemble que seul : la joie nous ouvre au partage et constitue le meilleur antidote à l'égoïsme et à l'individualisme. Le rire permet également de faire tomber les barrières sociales, de créer des liens entre les personnes et d'exprimer ses émotions et ses pensées, contribuant ainsi à la construction d'une culture commune et à la création d'espaces de liberté. Vous nous rappelez que l'homo sapiens est aussi l'homo ludens ! Car le jeu et le rire sont au cœur de la vie humaine, pour s'exprimer, pour apprendre et pour donner un sens aux situations.
Votre talent est un don précieux. Associé au sourire, il répand la paix dans nos cœurs et parmi les autres, nous aidant à surmonter les difficultés et à faire face au stress quotidien. Il nous aide à trouver le soulagement dans l'ironie et à traverser la vie avec humour. J'aime prier chaque jour avec les mots de Saint Thomas More : "Accorde-moi, Seigneur, un bon sens de l'humour". Je demande cette grâce pour chaque jour, car elle m'aide à aborder les choses avec le bon esprit.
Vous réussissez également un autre miracle : vous parvenez à faire sourire les gens tout en gérant les problèmes et les événements, petits et grands. Vous dénoncez les abus de pouvoir, vous donnez une voix aux situations oubliées, vous mettez en lumière les abus, vous pointez les comportements inappropriés. Vous le faites sans semer l'alarme ou la terreur, l'anxiété ou la peur, comme d'autres types de communication ont tendance à le faire ; vous incitez les gens à penser de manière critique en les faisant rire et sourire. Vous le faites en racontant des histoires de la vie réelle, en racontant la réalité de votre point de vue unique ; et de cette façon, vous parlez aux gens des problèmes, grands et petits.
Selon la Bible, au début du monde, alors que tout était créé, la sagesse divine a pratiqué votre forme d'art pour le bénéfice de nul autre que Dieu lui-même, le premier spectateur de l'histoire. Elle est décrite de la manière suivante : "J'étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre, et je faisais chaque jour ses délices, me réjouissant sans cesse devant lui, me réjouissant de son monde habité et me réjouissant des fils des hommes" (Prv 8,30-31). Rappelez-vous ceci : lorsque vous parvenez à arracher des sourires complices à un seul spectateur, vous faites aussi sourire Dieu.
Vous, chers artistes, savez penser et parler avec humour sous différentes formes et dans différents styles ; et dans chaque cas, le langage de l'humour permet de comprendre et de "sentir" la nature humaine. L'humour n'offense pas, n'humilie pas et ne rabaisse pas les gens en fonction de leurs défauts. Alors que la communication d'aujourd'hui génère souvent des conflits, vous savez rapprocher des réalités diverses et parfois contraires. Que de choses à apprendre de vous ! Le rire de l'humour n'est jamais "contre" qui que ce soit, mais il est toujours inclusif, volontaire, suscitant l'ouverture, la sympathie, l'empathie.
Cela me rappelle l'histoire du livre de la Genèse, lorsque Dieu promet à Abraham qu'il aura un fils dans l'année. Lui et sa femme Sarah étaient âgés et sans enfant. Sarah écoutait et riait intérieurement. Abraham a dû faire de même. Cependant, Sarah a conçu et mis au monde un fils dans sa vieillesse, au moment fixé par Dieu. Sarah dit alors : "Dieu m'a fait rire ; tous ceux qui m'entendront riront de moi" (Gn 21,6). C'est pourquoi ils ont appelé leur fils Isaac, ce qui signifie "il rit".
Pouvons-nous rire de Dieu ? Bien sûr, nous le pouvons, tout comme nous jouons et plaisantons avec les personnes que nous aimons. La sagesse et la tradition littéraire juives sont passées maîtres en la matière ! Il est possible de le faire sans offenser les sentiments religieux des croyants, en particulier des pauvres.
Chers amis, que Dieu vous bénisse, vous et votre art. Continuez à remonter le moral des gens, surtout de ceux qui ont le plus de mal à regarder la vie avec espoir. Aidez-nous, avec un sourire, à voir la réalité avec ses contradictions et à rêver d'un monde meilleur ! Avec mes sentiments les plus sincères, je vous bénis et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi.