« La Libre Afrique » fait le point avec Hubert Leclercq :
 « Moins de quarante jours avant le passage par les urnes en République démocratique du Congo pour les présidentielles et les législatives nationales et provinciales.
« Moins de quarante jours avant le passage par les urnes en République démocratique du Congo pour les présidentielles et les législatives nationales et provinciales.
Un scrutin qui est loin d’être acquis, vu les défis qui se dressent encore devant la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), les dimensions gigantesques du pays et le manque criant d’infrastructures.
Pour tenter de respecter les impératifs du calendrier constitutionnel, le patron de la Ceni, Denis Kadima Kazadi, a loué deux avions au Kenya et acquis une flotte de petites embarcations afin de dispatcher les milliers de machines à voter dans tout le pays. “Tout est trop tardif, explique un député de l’opposition qui souligne : “l’impact des contingences météorologiques. On est en saison des pluies, tout déplacement est compliqué dans certaines zones du pays. C’est chaque année comme ça, la Ceni devait l’anticiper”, poursuit-il.
Qu’importe, le pouvoir en place continue de marteler que les scrutins se tiendront le 20 décembre coûte que coûte. “Souvenez-vous de la prophétie de Denis Kadima quand il avait annoncé chez vous (à Bruxelles lors d’un séminaire sur les élections en RDC, organisé en décembre 2022 par l’institut Egmont, NdlR) que les élections ne seraient pas parfaites et qu’il ne fallait pas vouloir le beurre et l’argent du beurre, pour reprendre ces mots”, rappelle un expert politique présent ce jour-là. “Cela va être les élections les plus cochonnées de l’histoire. Il faut s’attendre à ce que la moitié des bureaux ne soient même pas ouverts”, annonce un opposant, proche de l’ancien président Joseph Kabila qui évoque le dernier communiqué de la mission d’observation des catholiques et des protestants publié ce lundi 13 novembre qui constate que “3 706 bureaux de vote ont été dupliqués 2,3 voire 4 fois”. Le même kabiliste évoque aussi la réunion de ce lundi dans le cadre de concertation entre la Ceni et les représentants des candidats à la présidence. “Une nouvelle démonstration du forcing envers et contre tout de Denis Kadima pour organiser des élections impossibles qui vont générer tant de frustrations qu’il faut craindre le pire au lendemain du scrutin”.
RDCongo : Le match Tshisekedi – Katumbi peut commencer
Rendez-vous à Pretoria
C’est dans ce contexte de vives tensions politiques qui ne cessent de croître dans un pays miné par une véritable guerre dans le Kivu, des violences à caractère ethnique sur plusieurs fronts sur toute l’étendue du territoire, que cinq candidats à la présidence se parlent en Afrique du Sud. À partir de ce lundi, les premiers lieutenants de Katumbi, Fayulu, Mukwege, Sesanga et Matata sont réunis à Pretoria, à l’invitation d’une l’ONG sud-africaine déjà active il y a cinq ans, à Genève, dans le même exercice de désignation d’un candidat commun. À l’époque, c’est Martin Fayulu qui s’était imposé. “Être désigné à ce stade ne suffit pas pour gagner des élections”, explique Luc Malembe, un des porte-parole de Martin Fayulu qui insiste “il faut gagner les élections nationales et, surtout, faire en sorte que les voix des électeurs comptent vraiment”.
« On est conscient de l’attente de la population pour une candidature commune”, enchaîne Jean-Pierre Muongo, le directeur de campagne de Delly Sesanga. “Notre objectif est de dégager les grandes lignes d’un programme commun qui doit nous permettre de bâtir ce front de l’opposition en 48 heures. C’est court mais la majorité des négociateurs ne sont pas des novices. On peut y arriver si tout le monde joue le jeu.”
La détermination est présente dans les QG contactés mais tous savent que la tâche sera difficile. “Avant de parler d’un candidat commun, il faut que la Ceni vide les questions autour du fichier électoral”, reprend-on dans le camp Fayulu. Le candidat “unique” de l’opposition de 2018 est loin de faire l’unanimité à Pretoria. Son inscription à la présidentielle en dernière minute, après avoir demandé aux membres de son parti de ne pas participer aux législatives, interrogent plusieurs participants à cette réunion. “C’est un comportement pour le moins étrange”, assure un proche de Matata, qui pointe “la faiblesse de ce candidat qui n’aura donc pas d’élu à l’Assemblée nationale.” “Denis Mukwege est aussi parti seul”, enchaîne un autre lieutenant.
Hervé Diakiese, le porte-parole d’Ensemble pour la République, le parti pour de Moïse Katumbi a insisté début de semaine dernière sur la volonté de son candidat de se mettre au service du pays. “Ce qui ne veut pas dire que Katumbi va accepter de s’effacer au profit d’un autre candidat”, explique un proche de Fayulu.
RDC : « Denis Mukwege sera le facteur X de l’élection de 2023 »
« Un candidat commun, c’est possible”, explique un membre de l’équipe de Sesanga, “sera-t-il commun aux cinq qui se retrouvent à Pretoria ? C’est loin d’être gagné”. Le scénario de Genève, où un candidat est porté par l’ensemble des acteurs présents avant que deux candidats (Tshisekedi et Kamerhe) renient leur engagement le lendemain, est dans toutes les têtes. “Cet embrouillamini n’a pas empêché Fayulu de remporter le scrutin et Tshisekedi de devenir iniquement Président de la République. Le clan Kabila n’a pu se maintenir au pouvoir. Tshisekedi doit être conscient qu’il abat sa dernière carte et que la mobilisation et le contrôle de l’appareil de l’État ne sont plus suffisants face à la détermination du peuple et aux moyens technologiques qui peuvent être mis en place pour contrôler le fichier.”
« 2018 n’est pas 2023”
« La déception face au régime en place nous pousse à trouver une voie d’entente”, explique un proche de Sesanga. “Ceux qui ne joueront pas le jeu seront montrés du doigt par la population”.
Pourtant, malgré ces déclarations ; le doute est clairement de mise. “2023 n’est pas 2018, explique le professeur Bob Kabamba, politologue à l’Université de Liège. “Il y a cinq ans les poids lourds qu’étaient Bemba et Katumbi étaient sur la touche. Ils étaient les moteurs externes de la conciliation. Cette année, il n’y a plus de profil similaire. Les cinq candidats qui se retrouvent à Pretoria ont engagé des frais pour cette candidature et n’ont pas nécessairement envie de céder leur place. L’autre grande question porte sur les élections elles-mêmes. Le doute reste de mise sur la tenue du scrutin malgré les propos rassurants du président de la Ceni. Certains candidats savent qu’ils ne feront pas le poids, mais ils veulent exister et monnayer leur ralliement si les élections sont retardées et que tout le monde doit se retrouver à la table des négociations.”
RDC : Perquisitions en série, Katumbi et Kalonda dans le viseur d’un régime de plus en plus dictatorial
L’interrogation Denis Mukwege
La figure de Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018 est au cœur des biens des interrogations. “L’homme a un ego surdimensionné”, explique un homme d’affaires congolais qui le connaît “depuis de longues années. Son prix Nobel n’a rien arrangé. Il ne se retirera jamais au profit d’un autre candidat”. “Il est entré dans la course pour être président, les calculs politiques, ce n’est pas pour lui”, ajoute un autre businessman de l’est du pays, qui poursuit : “Ses amis occidentaux le portent aux nues, mais au pays, il manque cruellement d’assise, de popularité”.
Katumbi et la mauvaise expérience de 2018
Moïse Katumbi est aussi parmi les candidats qui ont déjà injecté beaucoup d’argent dans la campagne. “Mais il pourrait faire un pas de côté s’il est convaincu, explique un diplomate occidental. “Mais il faudra le convaincre. Il ne faut pas oublier qu’entre 2016 et 2018, c’est lui qui a porté financièrement l’opposition congolaise. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a vite oublié ce passé. Katumbi a investi beaucoup d’argent et voit aujourd’hui le clan Tshisekedi lui tailler des croupières jusque chez lui, à Lubumbashi. Dans ce contexte, on voit mal le candidat n°3 se retirer”, poursuit le diplomate.
RDC : Salomon Kalonda, le prisonier encombrant
Félix Tshisekedi sait que Moïse Katumbi est son adversaire le plus dangereux. Il coche toutes les cases pour être l’outsider n°1 depuis que la Cour constitutionnelle a validé sa candidature : il est très populaire à l’intérieur et l’extérieur du pays, il a un vrai parti, les moyens financiers et il a affiché sa détermination. “Il est fort possible de sortir de Pretoria sans accord à 5 mais avec, malgré tout, un candidat qui sortirait renforcé et qui pourrait agréger d’autres candidats qui ne sont pas à Pretoria. Katumbi est le plus à même de réussir ce pari”, conclut le diplomate. »
Bref, les cinq cadors de l’opposition sont entrés en négociation en Afrique du Sud, mais sans grand résultat : à un mois des élections, Tshisekedi semble le plus probable en l’absence d’une candidature unique de l’opposition. Pourtant, le faible bilan du Président Tshisekedi ne plaide pas en faveur de sa réélection mais qu’est-ce que l’opinion démocratique au Congo : mwana soko mobali ? (Belgcath)

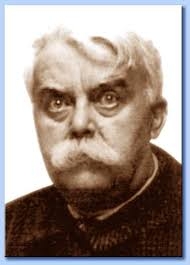 « Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur
« Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur
 «
«