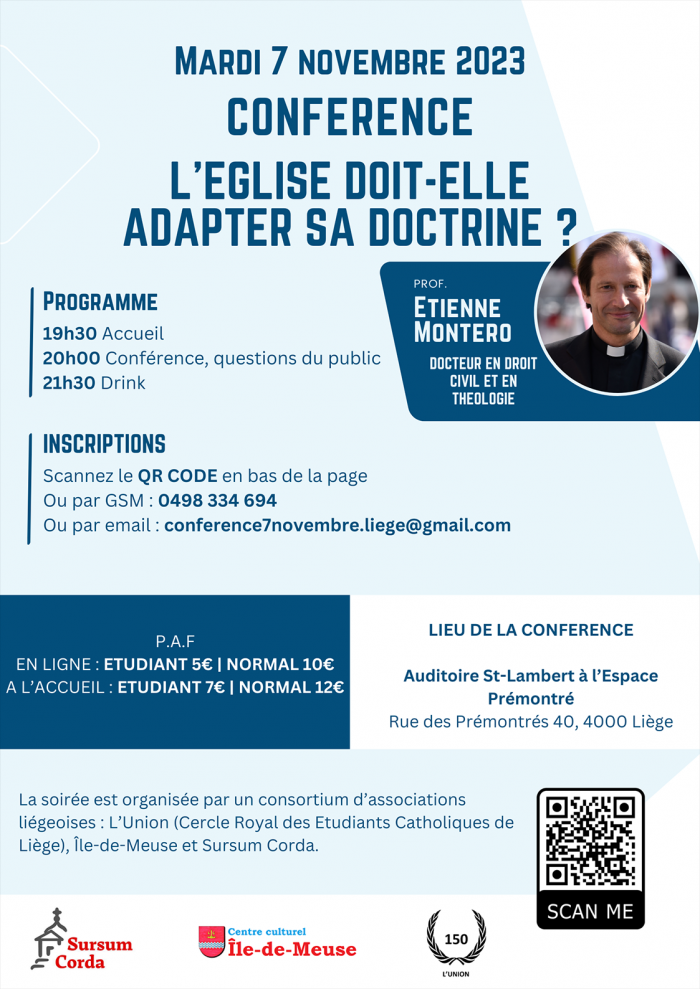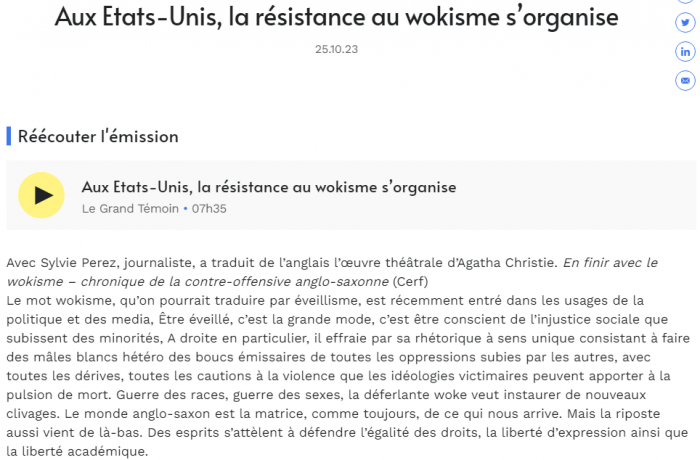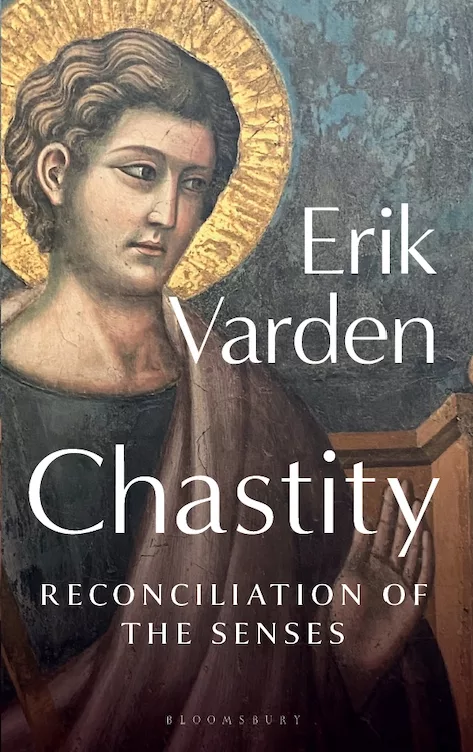De Luca Volonte sur la Nuova Bussola Quotidiana :
Mauvais signaux de la nouvelle majorité polonaise
Bien qu'il n'y ait pas encore de gouvernement, en Pologne, la nouvelle majorité dicte déjà la ligne à suivre face aux conservateurs. Et les associations d'avorteurs et de LGBT passent déjà à l'action. Alors que les vraies purges commencent.
25_10_2023
Dès les premiers jours qui ont suivi le vote polonais du 16 octobre, alors qu'elle n'est pas encore au pouvoir, les signes indiquant la direction que la coalition de centre-gauche souhaite donner à l'avenir du pays sont très clairs. Les ambiguïtés prennent fin tant à Varsovie qu'à Bruxelles.
Plusieurs dirigeants d'organisations pro-avortement et pro-LGBTI, malgré la prudence des premiers jours, veulent franchir le pas et espèrent beaucoup des changements que la nouvelle coalition voudrait introduire : des unions civiles pour les homosexuels, une certaine libéralisation du niveau d'éducation pour la doctrine du genre, et la liberté d'avorter jusqu'à la 12ème semaine. Donald Tusk, le premier ministre indiqué par les oppositions, l'avait déjà anticipé dans ses promesses électorales et l'avait réitéré quelques jours avant le vote.
En revanche, dans les villes où les partis majoritaires gouvernent déjà, la victoire électorale a permis de dévoiler les désirs les plus cachés, clairement contraires aux racines juives et catholiques. Tout d'abord, la majorité arc-en-ciel de gauche, centriste et modérée du conseil municipal de Wroclaw, troisième ville du pays, a adopté le 20 octobre une résolution demandant "la suppression du financement de l'instruction religieuse dans le budget de la ville de Wroclaw... compte tenu de la situation économique et de l'augmentation constante des coûts de fonctionnement du système éducatif".
Toute décision en la matière relève du gouvernement national, qui fournit une partie du budget à la municipalité pour cette dépense, et c'est précisément pour cette raison que le conseil municipal de Wroclaw, avec l'opposition du PiS et des partis de droite, en approuvant cet acte purement politique, a voulu faire appel au Premier ministre et au ministre de l'éducation, actuel et futur, afin de trouver des solutions légales pour permettre à la ville de supprimer ce financement.
D'ailleurs, autre mauvais signe, le 21 octobre, dans la capitale Varsovie, gouvernée par la coalition de centre-gauche, s'est déroulée une incroyable manifestation organisée par la gauche en faveur des Palestiniens, au cours de laquelle des slogans violents et des insultes menaçantes à l'égard du peuple juif (certains appelant explicitement au nettoyage des Juifs du monde) ont conduit l'ambassadeur d'Israël, le président de la République et plusieurs membres de l'actuel gouvernement conservateur à intervenir et à condamner, non seulement la violence et les menaces verbales des manifestants pro-palestiniens, mais aussi le silence absolu des dirigeants de la majorité actuelle et du maire de Varsovie Rafał Trzaskowski, l'ancien candidat d'unité de l'opposition aux dernières élections pour la présidence de la république, soutenu par les organisations LGBTI et Open Society et qui avait dans le passé interdit et dispersé plusieurs manifestations d'extrême-droite.
Avez-vous peut-être vu des journaux italiens ou européens stigmatiser les manifestations antisémites de gauche à Varsovie ? Non, au contraire, les journaux européens continuent sans relâche à faire l'éloge de Tusk et à dire que, grâce au nouveau gouvernement, toute l'Europe pourra vaincre la droite populiste et autoritaire lors des prochaines élections européennes.
Alors que les pourparlers des forces politiques et des coalitions avec le Président de la République Duda ont commencé à Varsovie, afin d'entamer la procédure de nomination du Premier ministre en charge et de confiance dans le nouvel exécutif, au milieu des appels du Premier ministre sortant Mateusz Morawiecki à la coopération pour le bien du pays entre tous les partis au Parlement et des demandes de Donald Tusk et de ses alliés de pouvoir gouverner le plus tôt possible, la Commission européenne se montre complaisante. En ce qui concerne la suppression d'importants organes de contrôle et l'épuration des membres non alignés des organismes publics et des cours de justice, ainsi que la modification de la composition des hautes cours, Bruxelles se montre complaisante et se tait.
Aucun des commissaires européens, ni la présidente Ursula Von der Leyen, n'ont prononcé un seul mot pour stigmatiser les tentations de la coalition de Donald Tusk. Au contraire, la présidente Von der Leyen a rappelé que " le vote de 2024 sera l'un des événements les plus importants de l'histoire de notre Union et [...] nous devons nous concentrer sur la mission commune qui nous unit tous : garantir une compétition électorale libre et équitable " car, " si des acteurs étrangers paient secrètement des campagnes de lobbying pour influencer nos processus démocratiques, de telles activités doivent être démasquées ", il faut éviter de voir " les démocraties attaquées de l'intérieur ".
Très bien, mais alors pourquoi rester silencieux face aux violations flagrantes et aux influences électorales étrangères dans le vote polonais, maintenant systématiquement et solidement démontrées en faveur de Tusk et de ses alliés. Il est désormais prouvé que Soros, au moins, a occupé les médias et soutenu les oppositions, notamment en finançant la Fondation Báthory et, par son intermédiaire, une myriade d'organisations dont le seul but est de s'opposer au PiS et à l'Église polonaise.
Ce silence est d'autant plus inquiétant, au vu de la transparence du vote lors des prochaines élections européennes, si l'on considère que dans le projet d'avis sur "la transparence et la responsabilité des organisations non gouvernementales financées par le budget de l'UE", approuvé aujourd'hui par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, il est demandé que les obligations de déclaration, même sur les financements étrangers, "pour les ONG, doivent rester limitées". En d'autres termes, Bruxelles veut-elle uniquement accorder le droit d'influencer les élections et leurs résultats en Europe à l'armada de Soros &Co. afin de maintenir les alliances politiques de centre-gauche, les bureaucraties et l'opacité actuelle ?