De Life Site News :
Raymond Arroyo défend les catholiques américains contre la remarque accusatrice du pape: ils aiment l’Église Catholique
Raymond Arroyo est un auteur à succès du New York Times et producteur américain. Il est le directeur des nouvelles et le présentateur principal d'EWTN News
WASHINGTON, DC, 9 septembre 2019 (LifeSiteNews) -
Raymond Arroyo, du EWTN, a défendu les catholiques américains traditionnels et leur fidélité à l'enseignement de l'Église dans une analyse époustouflante de la récente remarque improvisée du pape François: «C'est un honneur pour moi que les Américains m'attaquent . "
Le pape a fait sa remarque accusatrice à bord de l'avion papal en route pour le Mozambique après avoir reçu un exemplaire du nouveau livre "Comment l'Amérique voulait changer le pape", du journaliste français Nicolas Senèze.
Dans The World Over d’EWTN, Arroyo a critiqué la prémisse de l’ouvrage selon laquelle "une cabale américaine est déterminée à venir à bout du pape François" - prémisse avec laquelle le pape est apparemment d'accord.
«C’est fatiguant et, franchement, un récit dénué de tout fait que nous entendons surtout des secteurs européens et des progressistes américains depuis des années», a déclaré Arroyo. "Il est fondé sur l'idée que les catholiques américains fidèles aux idées traditionnelles, des chroniqueurs aux évêques, en passant par les cardinaux et les entrepreneurs - même les types de médias, comme ce réseau - sont résolus à saper le pontificat du pape François."
Arroyo a rappelé à ses téléspectateurs comment, il y a deux ans, le conseiller papal, le père Antonio Spadaro, "cherchait à promouvoir le fantasme selon lequel le catholicisme américain aurait été infecté par une alliance avec des protestants fondamentalistes menant à ce qu'il a appelé un" œcuménisme de haine "».
"Austen Ivereigh, biographe du pape, joue actuellement le même air dans un livre à paraître intitulé Wounded Shepherd, qui promeut la même sottise selon lequel l'agenda de la réforme du pape est attaqué par des traditionalistes bénéficiant de larges financements", a déclaré l'hôte du REO.
Ces représentations "sont une interprétation erronée de la situation sur les plans factuel et culturel", a déclaré Arroyo, qui finissent par "détruire, fustiger ou diaboliser les autres".
"Ils commettent l'erreur de désigner des catholiques orthodoxes en Amérique comme des membres de la droite, des acteurs d'un complot politique visant à annuler l'ordre du jour de François."
"La vérité est beaucoup plus simple", a noté Arroyo. "Les catholiques américains croient réellement ce que l'Église a toujours enseigné. Ils sont assez forts et disposent de suffisamment de plates-formes pour diffuser cette conviction."
Ces catholiques américains "sont pro-vie, dévotionnels" et "ils aiment l'église et le pape", a-t-il ajouté.
Arroyo a qualifié de «risibles» et absurdes les théories du complot avancées jusque dans les échelons supérieurs de l’Église.
"Si cette cabale américaine est si puissante et si bien financée, pourquoi n'a-t-elle absolument rien à produire pour ses efforts?", a demandé Arroyo. «Je pense pouvoir dire que les vents progressistes soufflent assez puissamment sur Rome ces jours-ci avec rendez-vous, dissimulations et synodes, à toute vitesse."
Et au cours des dernières décennies, ces «vents progressistes» de changement ont eu de graves conséquences inattendues. Arroyo observe:
La fréquentation de la messe hebdomadaire est passée de 55% en 1970 à 21% aujourd'hui;
Il y a maintenant 30 millions d'ex-catholiques aux États-Unis;
Le nombre de personnes s'identifiant comme catholiques en 2015 était de 81,6 millions. En 2017, il était tombé à 74,3 millions.
«Pourquoi cela se passe-t-il?» interroge-t-il. "Certes, la crise des abus sexuels et la perte de confiance est un facteur énorme, mais il en va de même pour la croyance en l'Eucharistie, le mariage, le clergé célibataire."
«Nous devons poser ces questions et nous continuerons de le faire», a-t-il promis.
Arroyo pense que les catholiques américains traditionnels sont diabolisés simplement pour avoir posé des questions importantes à ceux qui voudraient les faire taire. «Il s’agit là d’une tentative insensée de… purger les voix de l’Église qui ose s’interroger sur les changements radicaux en cours et sur la tactique brutale utilisée pour les incarner [.]».
«Étant donné la corruption sexuelle et financière dans l'Eglise, il nous incombe à tous, laïcs et membres du clergé, de poser des questions et d'exiger des réponses avec amour.
«Si les gens veulent critiquer les catholiques traditionnels, il faut y aller! Ils l'ont fait à l'égard de Mère Angélique, de Jean-Paul II, de Benoît XVI », s'est exclamé Arroyo. "Mais ne diabolisons pas les gens qui s'engagent dans un dialogue."
«Ne créons pas de théories du complot stupides dans le but de rejeter leurs préoccupations ou leurs questions. La plupart de ces catholiques traditionnels ont un profond respect pour la charge et la personne du pape. Et comme les saints de jadis, ils essaient, dans la mesure de leurs moyens, de l’empêcher de commettre des erreurs tragiques ou de se laisser tromper par des voix qui défendent leurs propres objectifs », at-il ajouté.

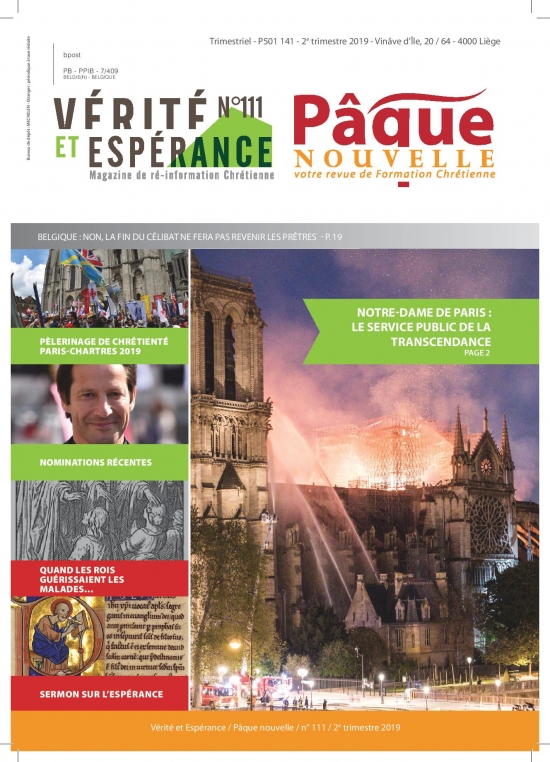
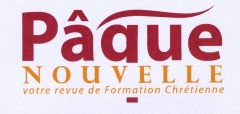

 « Du 6 au 27 octobre se tiendra à Rome le synode sur l’Amazonie. L’« instrument de travail », rendu public le 17 juin, a été l’objet de nombreuses critiques. Analyse des enjeux du synode.
« Du 6 au 27 octobre se tiendra à Rome le synode sur l’Amazonie. L’« instrument de travail », rendu public le 17 juin, a été l’objet de nombreuses critiques. Analyse des enjeux du synode.