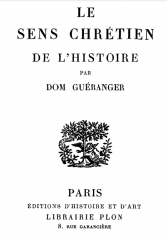G. et M.-M. Lebbe
Monsieur le Cardinal Jozef De Kesel
Messieurs les Evêques flamands
secr.mgr.dekesel@diomb.be
johan.bonny@bisdomantwerpen.be
patrick.hoogmartens@bisdomhasselt.be
lode.aerts@bisdombrugge.be
sec.bisdom@bisdomgent.be
secretariaat.hulpbisschop@vlbm.be
cc :
Les Evêques francophones de Belgique
mgr.jpdelville@evechedeliege.be
mgrwarin@diocesedenamur.be
guy.harpigny@evechetournai.be
jean.kockerols@skynet.be
Bruxelles, le 19 octobre 2022
Lettre ouverte
Eminence,
Excellences,
Nous sommes un couple marié catholique belge, parents de jeunes enfants.
1. Le mardi 20 septembre 2022, vous avez publié un document intitulé « Être proche des personnes homosexuelles sur le plan pastoral » dans lequel vous promouvez une reconnaissance des couples homosexuels qui désirent vivre une relation stable et fidèle. Vous proposez un « moment de prière» dans lequel le couple homosexuel priera pour s'engager devant Dieu l'un envers l'autre dans la fidélité.
Vous donnez des exemples de prières que les personnes qui entourent le couple (famille, amis) pourront réciter pour et avec eux, pour renforcer leur lien et pour faire de leur foyer un lieu de compréhension et de tolérance. Vous affirmez que « même s’il ne s’agit pas d’un mariage religieux, cette relation peut aussi leur être source de paix et de bonheur partagé ». Les passages 250, 297 et 303 d'Amoris Laetitia sont cités pour étayer votre initiative.
Vous déclarez vouloir mieux accepter et intégrer les couples homosexuels au sein de l’Eglise et vouloir « répondre à leurs questions sur les positions de l'Église ». Vous voulez apprécier leur choix et partager leur joie d'avoir trouvé un partenaire stable.
Vous détaillez ensuite le « moment de prière » où le couple demandera à Dieu « de bénir et de perpétuer cet engagement d'amour et de fidélité ». Vous précisez que la cérémonie peut être simple afin de conserver une claire différence entre le mariage sacramentel et cet « engagement » du couple homosexuel devant Dieu.
2. L'objet principal de l'initiative pastorale publiée ne s'adresse pas simplement aux personnes ayant des tendances homosexuelles comme le titre de votre document peut le suggérer mais aux personnes homosexuelles actives et aux couples homosexuels, vivant ensemble et souhaitant approfondir leur engagement de fidélité l'un envers l'autre.
Les prières proposées s'adressent uniquement aux couples homosexuels qui souhaitent sceller leur amour devant Dieu et demandent à être « donnés l'un à l'autre pour toujours ».
Un couple homosexuel qui vit ensemble et demande à approfondir son « engagement » l'un envers l'autre est/a été ou sera sexuellement actif. C’est implicite dans votre déclaration.
3. Vous approuvez de ce fait l’union homosexuelle, et donc forcément les actes homosexuels.
4. L'acte homosexuel, cependant, selon l'enseignement de l'Église, reste « intrinsèquement désordonné » et enfreint les 6e et 9e commandements sur la chasteté.
En publiant le document « Être proche des personnes homosexuelles sur le plan pastoral », vous vous êtes formellement éloignés de l'enseignement du Christ sur la sexualité (Mt 19, 4-6 ; 15, 19-20) dont l'usage est réservé au mariage, c’est-à-dire à l’union entre un homme et une femme :
« N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme, et dit : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mt 19, 4-6)
Votre document :
- transgresse la loi divine dans l'Écriture Sainte (Gn 1, 26-28 et Gn 2, 24 ; Gn 19, 1-29 ; Lv 18, 22 ; Lv 20, 13, 1 Tm 1, 9-10)
- viole les avertissements explicites de Saint Paul à ce sujet (1 Co 6, 9-10 ; Rm 1, 24-27)
- s’oppose diamétralement au Catéchisme de l'Église Catholique (CEC, 2357-2359).
- ne tient pas compte des directives données en 2021 par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (Responsum CDF, 22 fév. 2021)
- va à l'encontre de plus de 2000 ans de Tradition et de Magistère de l'Eglise Catholique
Finalement, votre nouvelle pastorale contredit également l'enseignement du pape François et d'Amoris Laetitia lui-même, sur lequel vous prétendez fonder votre document.
Amoris Laetitia énonce clairement les lignes directrices de l'accompagnement pastoral des « situations irrégulières ». Il précise notamment que le « discernement ne pourra jamais s’exonérer des exigences de vérité et de charité de l’Évangile proposées par l'Église » (AL, 300).
Le pape affirme que les conditions suivantes doivent nécessairement être présentes dans l'accompagnement des personnes vivant en « situations irrégulières », à savoir : « humilité, (…) discrétion, (…) amour de l’Église et de son enseignement, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu » (AL, 300).
Il met en garde contre tout relativisme :
« La tiédeur, toute forme de relativisme, ou une réticence injustifiée quand il s’agit de le proposer, seraient un manque de fidélité à l’Évangile et également un manque d’amour de l’Église envers ces mêmes jeunes. Comprendre les situations exceptionnelles n’implique jamais d’occulter la lumière de l’idéal dans son intégralité ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l’être humain » (AL, 307).
Le pape François rejette toute initiative qui établirait même la plus vague similitude entre une union homosexuelle et le mariage. Il cite les Pères du Synode : « il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille » (AL, 251).
Votre démarche contrevient donc à l’esprit synodal.
5. L'Église catholique ne peut pas bénir ou « prier sur » une union qui est contraire à l'ordre du Créateur et qui relève de l’ordre du péché.
La promouvoir, c'est tomber dans l’hérésie. Réciter les prières suggérées est de l’ordre du blasphème.
Par contre, aimer les personnes homosexuelles en vérité est exigé par la loi de Dieu.
Les prêtres fidèles qui ne souhaitent pas que ce « moment de prière » ait lieu dans leur paroisse devront-ils recourir à « l'objection de conscience » dans l'Église à laquelle ils ont consacré leur vie ? Avez-vous songé à l’impact que votre initiative aura sur les chrétiens persécutés dans le monde, dont des milliers, chaque année, préfèrent mourir plutôt que de trahir leur foi ?
De nombreux fidèles en Belgique souffrent profondément de votre déclaration.
6. Votre document et votre nouvelle initiative pastorale portent atteinte à la dignité des personnes homosexuelles dans l'Église en laissant entendre qu'elles sont incapables de suivre l'enseignement du Christ.
Il s'agit d'une approche condescendante, discriminatoire et humiliante pour la personne ayant des tendances homosexuelles, désireuse de vivre selon les commandements de Dieu.
Ce n'est pas l'amour du Christ que vous proclamez, mais une attaque contre la vocation à la sainteté à laquelle est appelée toute personne, et donc également celle ayant des tendances homosexuelles.
La personne ayant des tendances homosexuelles, comme tout enfant de Dieu dans l’Église, est invitée à suivre ses commandements.
Avec la grâce de Dieu, il/elle n'est pas moins capable que n'importe quel autre chrétien de répondre à l'appel du Christ : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive » (Lc 9, 23). Il/elle n'est pas moins capable de répondre au commandement d'amour du Christ à la femme adultère : « Va, et désormais ne pèche plus » (Jn 8,11).
Votre initiative pastorale remplace le commandement du Christ à la femme adultère par : « Va, continue de pécher et sois béni dans ton péché ».
La croix du Christ, clé de notre salut, a été retirée de votre discours.
Nous sommes tous pécheurs, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, appelés à le suivre sur le chemin exigeant de la sainteté et à être, dans l’amour, « parfaits, comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48). La miséricorde de Dieu nous a donné les sacrements pour persévérer et progresser sur ce chemin de la sainteté.
Votre démarche récente ne peut être qualifiée de pastorale.
Un pasteur veille sur son troupeau et cherche inlassablement la brebis égarée par amour pur et désintéressé pour la ramener en sécurité, loin des dangers du péché. Le Christ, le seul vrai Berger, nous ramène constamment à lui dans l'enceinte parfaite de son amour.
7. Un véritable accompagnement pastoral des personnes homosexuelles doit être encouragé. La personne homosexuelle dans l'Église Catholique a besoin de notre amour et de notre respect, de notre soutien et de notre prière.
Le pape François déclare avec justesse: « nous désirons d’abord et avant tout réaffirmer que chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect, avec le soin d’éviter ‘toute marque de discrimination injuste’ et particulièrement toute forme d’agression et de violence » (AL, 250).
Votre déclaration du 20 septembre ne reflète pas l'amour de Dieu pour la personne homosexuelle. Au contraire, elle invite les consciences à ignorer la gravité du mal moral. Le péché (dans ce cas, une union homosexuelle) ne sera jamais une « source de paix et de bonheur partagé », comme vous le proclamez.
***
Nous prions et demandons que la clarté soit rétablie, que la confusion cesse, que l'amour désintéressé du Christ, Vérité Incarnée, entre dans nos cœurs afin que nous puissions nous aider mutuellement à porter nos croix, à soulager la souffrance et à vivre selon les enseignements de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Désireux de suivre les commandements de Dieu et la doctrine de l'Eglise et pour le bien de l’unité de l’Église, au nom de très nombreux catholiques souffrants et offensés de votre déclaration, nous vous demandons de rétracter votre document « Être proche des personnes homosexuelles sur le plan pastoral », datant du 20 septembre 2022.
Nous le demandons par amour de Dieu et de ses commandements, par amour de l’Eglise, et par amour pour les personnes homosexuelles qui désirent vivre le projet de Dieu sur elles.
Nous vous demandons de réaffirmer que l'union sexuelle est réservée à un homme et une femme, engagés dans le sacrement du mariage.
Nous ne pouvons pas obéir ou accepter, suivre ou participer à la nouvelle approche pastorale envers les couples homosexuels telle que vous l’avez promulguée.
Vu la gravité du sujet, nous autorisons la diffusion large de cette lettre.
Nous vous prions d’agréer, Votre Eminence, Vos Excellences, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.
G. et M-M. LEBBE