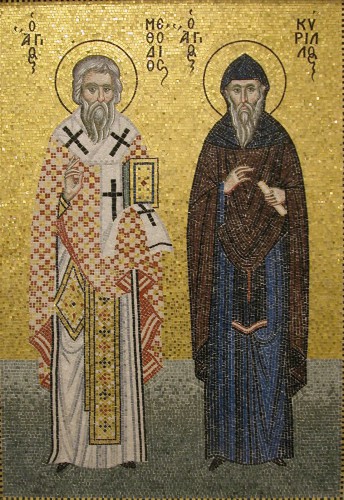Du Tagespost :
Benoît XVI et l'identité spirituelle de l'Europe
24 février 2026
Des universitaires et des représentants d'institutions ecclésiastiques se sont réunis la semaine dernière à l'ambassade d'Allemagne près le Saint-Siège à Rome pour rendre hommage à l'œuvre du pape Benoît XVI, et notamment à son engagement pour l'identité culturelle et spirituelle de l'Europe. « Il ne s'en est jamais lassé », a déclaré l'historien et ancien rédacteur en chef de L'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, selon un article du Catholic World Report, lors de cette conférence organisée en amont du centenaire de la naissance de Benoît XVI l'année prochaine.
En tant que théologien, puis préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et enfin pape, Joseph Ratzinger s'est efforcé de faire comprendre que l'Europe ne devait pas être perçue uniquement comme un projet économique ou politique, mais comme un concept culturel et historique dont les fondements sont indissociables du christianisme. Cela a été affirmé lors de l'événement intitulé « Ricordando Benedetto XVI » (En mémoire de Benoît XVI), illustré par plusieurs exemples.
L'Europe ne peut exister sans le christianisme.
Par exemple, dans son discours très remarqué prononcé à Subiaco en 2005, à la veille de la mort de Jean-Paul II , Ratzinger avertissait : « La tentative, poussée à l’extrême, de réguler les affaires humaines au mépris total de Dieu nous conduit toujours plus près du précipice, vers un isolement toujours plus grand de l’humanité par rapport à la réalité. » Une Europe qui renie ses racines chrétiennes et cherche à établir une communauté humaine sans Dieu ne peut perdurer. Cette conviction a façonné toute la pensée de Ratzinger et est devenue un thème central de son pontificat.
Comme l'explique Mariusz Kuciński, directeur du Centre d'études Ratzinger à Bydgoszcz, en Pologne, Ratzinger envisageait une Europe fondée sur trois piliers fondamentaux : les Dix Commandements, la philosophie grecque et le droit romain. Le christianisme y jouait un rôle unificateur. Si ces fondements étaient séparés, « il ne resterait finalement plus rien », affirme Kuciński.
“Veluti si Deus daretur”
Parmi les contributions majeures de Ratzinger à la compréhension de l'identité européenne, les intervenants ont également cité son ouvrage de 2004, « Sans racines », coécrit avec Marcello Pera. Ratzinger y défend l'idée que l'Europe est plus qu'une confédération d'États ou une union politique ; c'est un projet spirituel dont l'identité naît de l'union de la foi et de la raison. Parallèlement, il met en garde contre une « étrange et pathologique haine de soi dans le monde occidental ». Si l'Occident déploie des efforts louables pour s'ouvrir aux valeurs étrangères, « il ne s'aime plus lui-même ».
Il a exhorté les chrétiens à agir comme une « minorité créative » et à renforcer une nouvelle orientation vers les valeurs spirituelles, non seulement au sein de l'Église, mais aussi dans la conception culturelle de l'Europe dans son ensemble. Dans ce contexte, les participants ont également repris l'appel bien connu de Ratzinger à, en quelque sorte, renverser l'axiome des Lumières : même ceux qui n'ont pas accès à la foi devraient s'efforcer de vivre leur vie « veluti si Deus daretur » – comme si Dieu existait.
Lors de la cérémonie, il a également été souligné que Ratzinger avait apporté sa contribution à la réflexion sur la crise de l'identité européenne bien au-delà de ses fonctions officielles. Même après sa démission en 2013, il est resté attentif aux évolutions ecclésiastiques et sociétales. Pour beaucoup, il est devenu une source d'inspiration, notamment quant à la manière dont l'Église et la société peuvent trouver leur place dans un monde de plus en plus sécularisé.