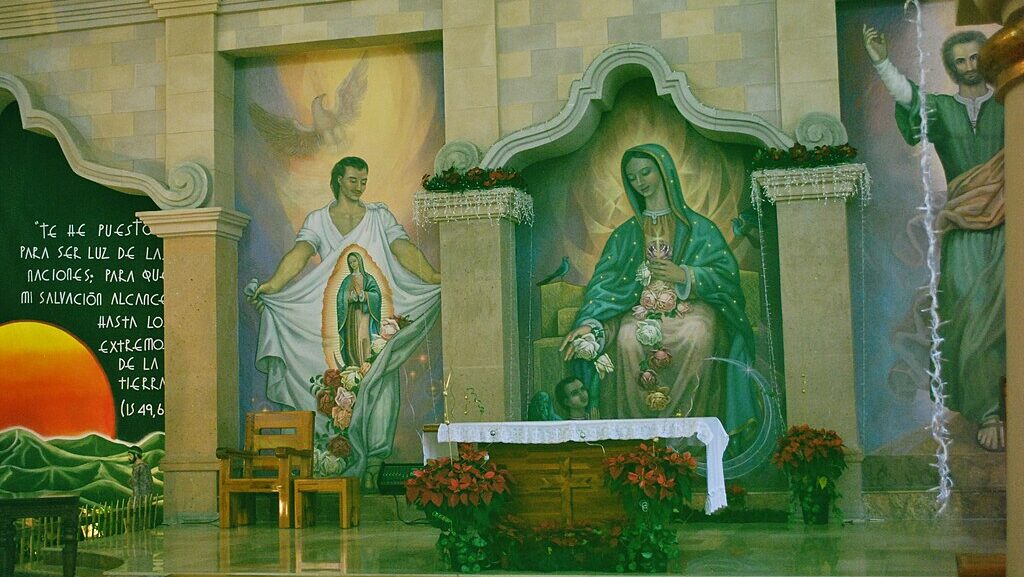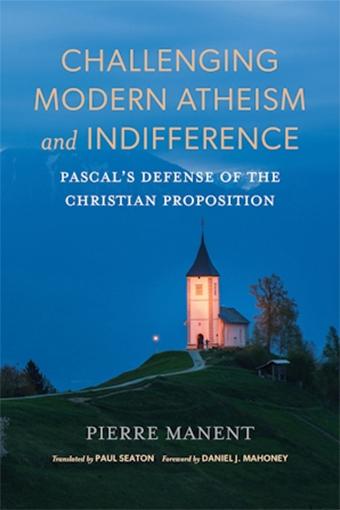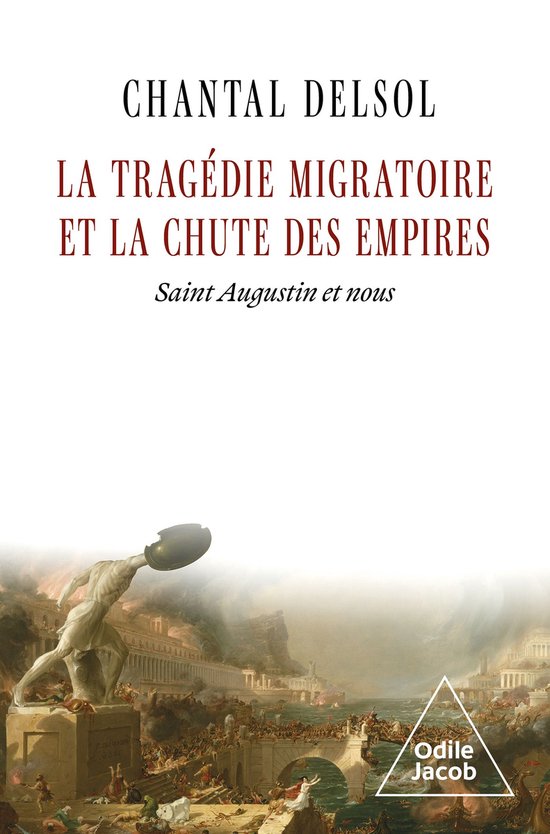De Gaetano Masciullo sur The European Conservative :
Les évêques allemands et le spectre du schisme : comment en est-on arrivé là ?
28
Parallèlement à la Conférence des évêques allemands, qui réunit tous les évêques et coordonne la pastorale, la liturgie, la communication et diverses autres initiatives, se trouve, à la tête de l'Église catholique en Allemagne, le Comité central des catholiques allemands (ZdK), une instance unique au monde. À ce jour, le ZdK se limite à représenter les catholiques allemands dans la sphère publique, à coordonner l'apostolat des laïcs, à conseiller les évêques et à publier des prises de position sur des questions d'intérêt public. Il ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel, car dans l'Église catholique, le pouvoir de gouvernement appartient au pape et aux évêques en communion avec lui.
Bien que la ZdK ait été historiquement créée pour protéger la minorité catholique dans un pays protestant, et culturellement très agressive envers les « papistes », après le concile Vatican II, la ZdK a dégénéré en un organe quasi parlementaire et a été exploitée par les progressistes pour tenter d'initier des réformes démocratiques au sein de l'Église.
Un autre aspect de l'Église allemande, qui la rend doublement unique dans le paysage catholique, est qu'elle est l'Église la plus riche du monde. En 2025, le patrimoine du Saint-Siège s'élevait à environ 4 milliards d'euros, tandis que celui de l'Église allemande était estimé à 250 milliards d'euros. Bien que l'argent n'explique pas tout, il joue néanmoins un rôle considérable dans la compréhension de certains choix. Le Vatican est très prudent avant de rompre ses liens avec une Église qui, de gré ou de force, constitue une source de financement importante. Et les évêques allemands en sont parfaitement conscients.
Le Chemin synodal de l'Église catholique allemande ( Der Synodaler Weg ) a débuté le 1er décembre 2019, après une phase préparatoire minutieuse menée par la Conférence des évêques allemands et la ZdK (Conférence des évêques allemands). Un groupe de 230 personnes s'est initialement réuni pour débattre de quatre thèmes : la séparation des pouvoirs au sein de l'Église ; la morale sexuelle ; le ministère sacerdotal, notamment la question du célibat ; et le rôle des femmes dans la vie ecclésiale. Cette liste correspond presque aux « quatre nœuds » que le cardinal Carlo Maria Martini, figure emblématique du progressisme catholique sous Jean-Paul II, avait présentés aux évêques européens en 1999.
L'élément déclencheur de tout ce processus fut celui des abus sexuels dans l'Église catholique, qui, sous le pontificat de Benoît XVI, devint un thème mondial, amplifié et exploité par de nombreux médias et secteurs institutionnels progressistes pour ternir le « tournant conservateur » que le pape Benoît avait donné à la gouvernance de l'Église.
En Allemagne, la pression était particulièrement forte, que ce soit en raison des origines allemandes du pape Benoît XVI ou de la forte présence progressiste et pro-protestante au sein du clergé. C’est pourquoi, en Allemagne plus qu’ailleurs, la question des abus a été présentée et interprétée publiquement par les catholiques eux-mêmes non seulement comme une faute morale, mais aussi comme le symptôme d’une défaillance systémique de l’Église catholique : doctrinale, juridique et culturelle. C’est à partir de là que le Chemin synodal a entrepris de repenser l’Église dans son ensemble.
Entre-temps, Benoît XVI a démissionné en 2013 de son ministère d'évêque de Rome. Les cardinaux réunis en conclave ont décidé d'élire, comme chacun sait, Jorge Mario Bergoglio, c'est-à-dire François, candidat phare du Groupe réformiste de Saint-Gall, alors dirigé par Martini, déjà mentionné : un groupe de cardinaux et d'évêques, principalement originaires de la région germanophone, qui entendaient réformer l'ensemble de l'Église catholique dans une direction analogue, mais non identique, à celle envisagée en Allemagne.
François, cependant, une fois au pouvoir, ne se comporta pas comme un pion : le jésuite Martini connaissait bien le caractère impulsif et indépendant de Bergoglio. Son programme, tout en se révélant résolument révolutionnaire, ne correspondait pas entièrement à celui du Groupe de Saint-Gall.