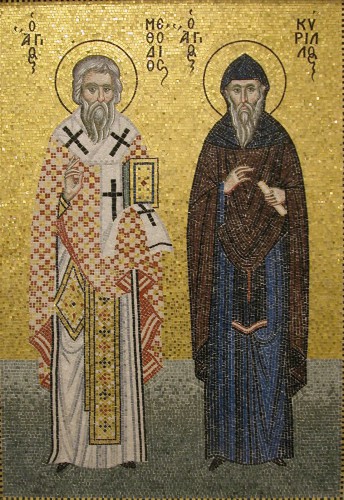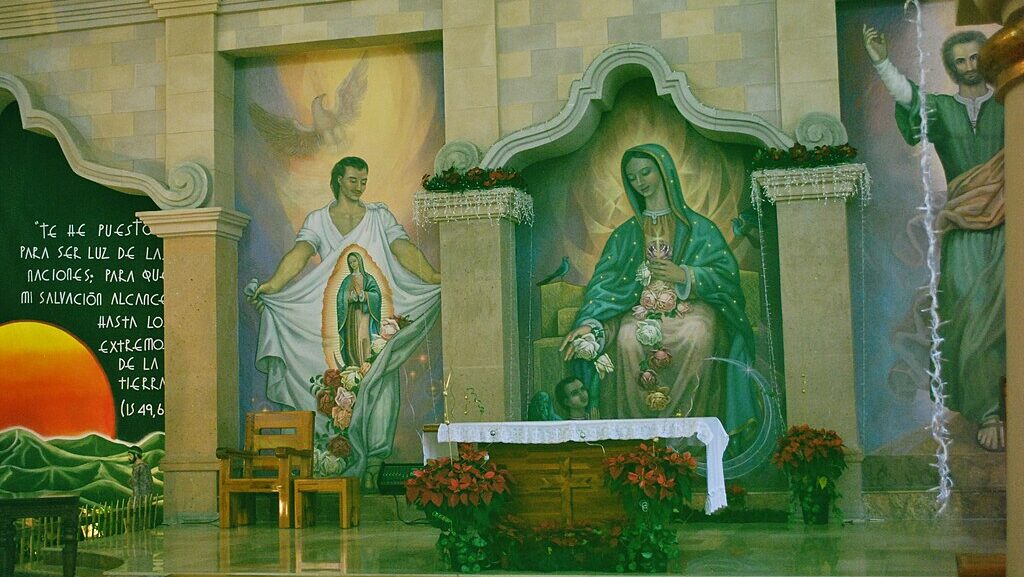Du site de la Conférence épiscopale italienne :
Appel : Chrétiens pour l'Europe. La force de l'espoir
« Il est beau de devenir pèlerins de l’espérance. Et il est beau de le rester, ensemble ! » Telle est l’invitation que le pape Léon XIV, à la fin du Jubilé de l’Espérance, a adressée à toutes nos Églises, afin que le temps qui s’ouvre soit « le commencement de l’espérance ». En tant que présidents des Conférences épiscopales européennes, nous nous sentons investis de la responsabilité d’accueillir et de relayer l’invitation du Pape. Nous vivons dans un monde déchiré et polarisé par la guerre et la violence. Nombre de nos concitoyens sont angoissés et désorientés. L’ordre international est menacé. Dans ce contexte, l’Europe doit retrouver son âme afin d’offrir au monde entier sa contribution indispensable au « bien commun ». Nous pouvons y parvenir en réfléchissant à ce qui a contribué à la fondation de l’Europe. D’un point de vue historique, après les civilisations hellénistique et romaine, le christianisme a été l’un des fondements essentiels de notre continent. Il a largement façonné le visage d’une Europe humaniste, solidaire et ouverte sur le monde.
Aujourd'hui, nous vivons dans une Europe pluraliste, caractérisée par la diversité linguistique, les différences culturelles régionales et la multitude de traditions religieuses et spirituelles. Bien que moins nombreux, les chrétiens n'en demeurent pas moins courageux et persévérants, fidèles à leurs convictions.
Au lendemain d'une guerre dévastatrice, marquée par l'extermination de millions de personnes pour des raisons raciales, religieuses ou identitaires, l'urgence de construire un monde nouveau s'est imposée. Nombre de laïcs catholiques ont résolument conçu l'Europe comme une maison commune et se sont engagés dans l'élaboration d'un nouveau cadre international, notamment par la création des Nations Unies. Leur objectif était de bâtir une société réconciliée, conçue comme un point de convergence et une garantie de respect mutuel des spécificités, un bastion de la liberté, de l'égalité et de la paix.
Dans la Déclaration qui a conduit à la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, premier pas vers l'Union européenne, les rédacteurs ont sagement affirmé : « La contribution organisée et essentielle qu'une Europe peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien de relations pacifiques. L'Europe ne se construira pas d'un seul coup, ni par une construction commune ; elle se construira par des réalisations concrètes, créant avant tout une solidarité de fait . » Les pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide De Gasperi, inspirés par leur foi chrétienne, n'étaient pas de naïfs rêveurs, mais les architectes d'un édifice magnifique, quoique fragile. « Parce qu'ils aimaient le Christ, ils aimaient aussi l'humanité et ont œuvré à son unité », comme l'a souligné à maintes reprises saint Jean-Paul II, rappelant le rôle des chrétiens dans la construction de l'Europe.
Le 25 mars 1957, lors de son discours prononcé à l'occasion des traités instituant la CEE et la CEAE, Konrad Adenauer déclara : « Jusqu'à récemment, nombreux étaient ceux qui considéraient l'accord que nous consacrons officiellement aujourd'hui comme irréalisable (…). Nous sommes conscients de la gravité de notre situation, qui ne peut être résolue que par l'unification de l'Europe ; nous savons également que nos projets ne sont pas motivés par l'égoïsme, mais visent à promouvoir le bien-être du monde entier. La Communauté européenne poursuit exclusivement des fins pacifiques et n'est dirigée contre personne (…). Notre objectif est de travailler avec tous pour promouvoir le progrès dans la paix . »
La tragédie meurtrière de la Seconde Guerre mondiale avait mis en garde la génération fondatrice de l'Europe contre la tentation, pour les régimes totalitaires se nourrissant de nationalisme, de poursuivre des objectifs hégémoniques dont l'issue ne peut être que la guerre. « Le nationalisme exacerbé est une forme d’idolâtrie : il place la nation au rang de dieu et l’oppose à l’humanité », affirmait Alcide De Gasperi, soulignant que « l’Europe unie n’est pas née contre les patries , mais contre les nationalismes qui les ont détruites ».
L’Europe ne saurait se réduire à un marché économique et financier, au risque de trahir la vision originelle de ses pères fondateurs. Respectueuse de l’État de droit et rejetant la logique exclusiviste de l’isolationnisme et de la violence, elle privilégiera la résolution supranationale des conflits, en choisissant les mécanismes et les alliances appropriés. Elle doit toujours être prête à renouer le dialogue, même en temps de conflit, et à œuvrer pour la réconciliation et la paix. L’Europe est appelée à rechercher des alliances qui jettent les bases d’une véritable solidarité entre les peuples.
Malgré la présence de nombreux mouvements eurosceptiques dans divers pays du continent, les Européens se sont rapprochés, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Un cadre international est en train de disparaître et un nouveau reste à voir le jour. Le pape François, conscient que nous vivons une période de bouleversements historiques, l’a définie ainsi : « Au siècle dernier, l’humanité a été témoin d’un nouveau départ : après des années de conflits tragiques, culminant avec la guerre la plus terrible de mémoire d’homme, une nouveauté sans précédent dans l’histoire a surgi, par la grâce de Dieu. Les cendres des décombres n’ont pu éteindre l’espoir et la quête de l’autre qui brûlaient dans le cœur des Pères fondateurs du projet européen. Ils ont posé les fondements d’un bastion de paix, d’un édifice construit par des États unis non par imposition, mais par le libre choix du bien commun, renonçant à jamais à la confrontation. L’Europe, après tant de divisions, s’est enfin retrouvée et a commencé à bâtir sa demeure . (…)L’Église peut et doit contribuer à la renaissance d’une Europe fatiguée, mais encore riche d’énergie et de potentiel. Sa tâche coïncide avec sa mission : l’annonce de l’Évangile, qui aujourd’hui plus que jamais se traduit avant tout par un appel aux souffrances de l’humanité, par la présence forte et simple de Jésus, par sa miséricorde consolatrice et encourageante (Discours prononcé à l’occasion de la remise du prix Charlemagne, le 6 mai 2016).
Le monde a besoin de l’Europe. C’est cette urgence que les chrétiens doivent saisir afin de s’engager résolument, où qu’ils soient, pour son avenir, avec la même conscience aiguë que les Pères fondateurs. « Vécue comme un engagement désintéressé au service de la cité, au service de l’humanité, la politique peut devenir un engagement d’amour envers son prochain », expliquait Robert Schuman. Au nom de leur foi, les chrétiens sont appelés à partager leur espérance de la fraternité universelle avec tous les habitants du continent européen.
Cardinal Jean-Marc Aveline,
archevêque de Marseille,
président de la Conférence épiscopale française
Cardinal Matteo Maria Zuppi,
archevêque de Bologne,
président de la Conférence épiscopale italienne
Monseigneur Georg Bätzing,
évêque de Limbourg,
président de la Conférence des évêques allemands
L'archevêque Tadeusz Wojda
de Gdansk,
président de la Conférence épiscopale polonaise