D'Aude Carasco sur le site du journal La Croix :
KTO a réinventé avec succès son modèle
La chaîne catholique, qui enregistre une hausse constante de son audience et de ses dons, renouvelle profondément sa grille en cette rentrée, avec quinze nouvelles émissions.
La chaîne KTO a aménagé l’an dernier dans la banlieue sud de Paris, à Malakoff, dans l’ancienne usine d’un sous-traitant de l’aéronautique. Soixante-dix permanents, dont une trentaine de journalistes et animateurs, travaillent sous cette cathédrale métallique, aux murs blancs immaculés. Après cinq déménagements en quinze ans, la chaîne a acquis ce siège de 1 900 m2, en payant moins chaque mois pour le remboursement de son emprunt qu’auparavant pour ses loyers à Issy-les-Moulineaux.
Une collecte de 9,2 millions d’euros
« Devenir propriétaire avait un intérêt pour la survie de la chaîne », souligne sa directrice générale, Philippine de Saint-Pierre. Les téléspectateurs ont largement répondu aux campagnes de dons pour ses travaux d’aménagement. En 2015, la chaîne enregistrait ainsi la collecte la plus importante de son histoire, avec 9,2 millions d’euros venus de 265 000 donateurs (contre 8 millions d’euros et 245 000 donateurs en 2014).
Au total (avec les produits exceptionnels de l’exercice, les abonnements, la publicité…), la chaîne disposait l’an dernier d’une enveloppe de 13 millions d’euros, dont 79 % ont servi à l’exécution de sa mission de production de programmes (59 % d’émissions, 21 % de directs et 20 % de documentaires).
La « chaîne de télévision catholique francophone » créée en 1999 par l’archevêque de Paris, le cardinal Jean-Marie Lustiger, a ainsi pris un nouvel envol, deux ans après un troisième échec de sa candidature à la TNT. Un mal pour un bien ? « Comme toutes les chaînes à l’époque, KTO devait se financer par la publicité, elle-même fondée sur l’audience, qui supposa l’accession à la TNT,résume la chaîne dans son dossier de présentation. Le CSA refusa cet accès, ce qui remit en cause le modèle. Il fallut en inventer un autre : le recours aux dons, c’est-à-dire à l’abonnement volontaire. »
La multiplication des canaux de diffusion (box ADSL, réseaux câblés, satellite AB3, Web et réseaux sociaux) et le succès des collectes ont conduit la chaîne à renoncer à demander un canal sur la TNT. « Nous n’avons pas été recalés pour des raisons de manque de solidité de dossier, puisque même nos concurrents louaient la qualité de notre travail et notre ouverture aux autres religions. Nous l’avons été pour des raisons idéologiques », estime Philippine de Saint-Pierre, tout en soulignant que ce refus a permis à la chaîne de prendre très tôt « le virage de la révolution numérique ».
Rajeunir les donateurs
L’« immense masse » de la collecte provient aujourd’hui de petits donateurs, qui envoient des chèques de quelques dizaines d’euros. « Nous allons continuer à élargir le nombre de donateurs, et aussi à les rajeunir », souligne Vincent Redier, le président du conseil d’administration de KTO.
« Nous travaillons aussi sur les micro-dons, renchérit Philippine de Saint Pierre.Nous sommes très présents sur YouTube, les applications mobiles, la télévision connectée, ce qui nous permet de toucher de plus en plus de jeunes », intéressés par des dons ponctuels ou sous forme d’abonnements via des modes de paiements numériques.
Les programmes courts (de 3 à 7 minutes), qui connaissent un succès auprès des plus jeunes et se diffusent très vite sur le Web, ont été démultipliés dans la nouvelle grille (avec 11 nouveautés sur 14).
Parmi les nouveautés, citons « Le Caté en 3 minutes » – un dessin animé en 72 épisodes, dans lequel le P. Johannes M. Schwartz explique de façon simple et ludique les enseignements de l’Église –, « Écologie humaine » – à travers des exemples concrets de nouveaux comportements, Tugdual Derville appelle à une « révolution de la bienveillance » – ou encore « Quèsaco », où le P. Bernard Klasen explique un mot ou un concept catholique.
Bon sens et plaisir des sens
Quatre nouvelles émissions sont aussi proposées cette année. Le vendredi soir (à 20 h 40) alterneront une fois par mois les émissions de débats « Sans langue de buis » (discussion entre des chrétiens et un évêque sur un thème) et « Déo et Débats » (échange libre sur l’actualité autour d’invités).
Le jeudi (à 19 h 40), les téléspectateurs s’initieront à « la vie concrète des entreprises » dans « Le travail dans tous les sens » (débat entre Joseph Thouvenel et Édouard Tétreau) ou au plaisir des sens et au bon sens avec « La cuisine des monastères ». Un moine ou une religieuse feront découvrir à François Lespes une « recette simple, pas chère, de saison, et emplie de spiritualité ».
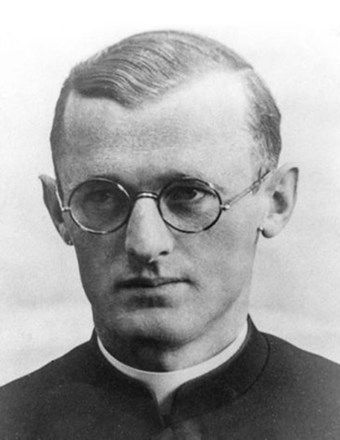
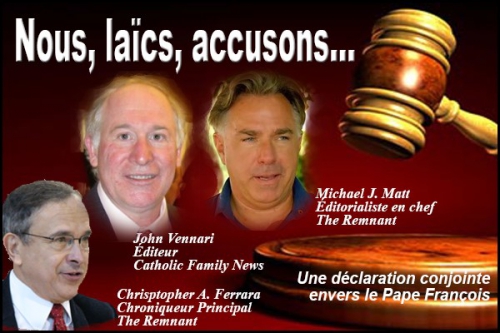
 favorise chez les fidèles, la prière personnelle, l'oraison mentale, d'une façon qui est en harmonie avec la célébration des rites sacrés par le prêtre. Ce n'est guère le cas dans beaucoup de nos messes actuelles, où toute forme de recueillement est rendue impossible la plupart du temps, où l'extériorité prévaut sur l'intériorité. Notons deux moments forts du rite traditionnel lorsque la messe n'est pas chantée en semaine. L'offertoire silencieux permet de se recueillir et de se préparer à ce qui va suivre. Quelques minutes de précieux silence sont ainsi offertes au fidèle, afin qu'il puisse unir l'offrande de sa vie à celle du Christ, et dire à Dieu les raisons pour lesquelles il veut s'unir au saint sacrifice: adorer, rendre grâce, réparer ses fautes et demander des fruits particuliers pour lui ou pour les siens. Notons que dans le nouvel ordo missae, l'offertoire se fait aussi en principe en silence, à l'exception de l'orate fratres et de la prière sur les offrandes. Il est permis toutefois de dire à haute voix les deux prières d'offrande du pain et du vin. C'est ce qui se fait couramment et on peut le regretter.
favorise chez les fidèles, la prière personnelle, l'oraison mentale, d'une façon qui est en harmonie avec la célébration des rites sacrés par le prêtre. Ce n'est guère le cas dans beaucoup de nos messes actuelles, où toute forme de recueillement est rendue impossible la plupart du temps, où l'extériorité prévaut sur l'intériorité. Notons deux moments forts du rite traditionnel lorsque la messe n'est pas chantée en semaine. L'offertoire silencieux permet de se recueillir et de se préparer à ce qui va suivre. Quelques minutes de précieux silence sont ainsi offertes au fidèle, afin qu'il puisse unir l'offrande de sa vie à celle du Christ, et dire à Dieu les raisons pour lesquelles il veut s'unir au saint sacrifice: adorer, rendre grâce, réparer ses fautes et demander des fruits particuliers pour lui ou pour les siens. Notons que dans le nouvel ordo missae, l'offertoire se fait aussi en principe en silence, à l'exception de l'orate fratres et de la prière sur les offrandes. Il est permis toutefois de dire à haute voix les deux prières d'offrande du pain et du vin. C'est ce qui se fait couramment et on peut le regretter. Padre Pio de Pietrelcina, comme l'Apôtre Paul, plaça la Croix de son Seigneur au sommet de sa vie et de son apostolat, comme sa force, sa sagesse et sa gloire... les trésors de grâce que Dieu lui avait accordés avec une largesse singulière, il les distribua sans répit par son ministère, servant les hommes et les femmes qui accouraient à lui toujours plus nombreux, et engendrant une multitude de fils et de filles spirituels...
Padre Pio de Pietrelcina, comme l'Apôtre Paul, plaça la Croix de son Seigneur au sommet de sa vie et de son apostolat, comme sa force, sa sagesse et sa gloire... les trésors de grâce que Dieu lui avait accordés avec une largesse singulière, il les distribua sans répit par son ministère, servant les hommes et les femmes qui accouraient à lui toujours plus nombreux, et engendrant une multitude de fils et de filles spirituels...