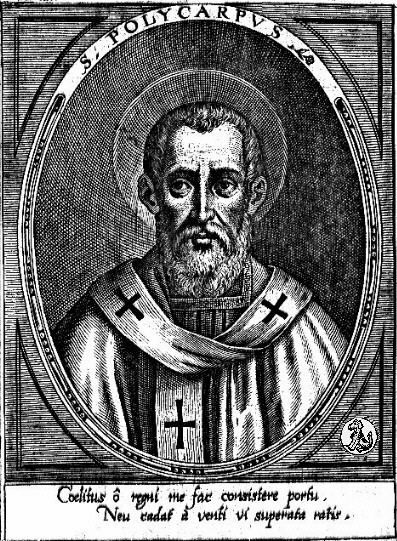Je vous salue cordialement et vous remercie de votre réflexion sur le signe d’inculturation parfaite que le Seigneur a accordé à son peuple en la personne de Notre-Dame de Guadalupe. En méditant sur l’inculturation de l’Évangile, il convient de reconnaître la manière dont Dieu lui-même s’est révélé et nous a offert le salut.
Il a choisi de se révéler non comme une entité abstraite ni comme une vérité imposée de l’extérieur, mais en s’inscrivant progressivement dans l’histoire et en dialoguant avec la liberté humaine. « Après avoir, à maintes reprises et de diverses manières, parlé à nos pères par les prophètes » ( Hébreux 1, 1), Dieu s’est pleinement révélé en Jésus-Christ, en qui il ne communique pas seulement un message, mais se communique lui-même. C’est pourquoi, comme l’enseigne saint Jean de la Croix, après le Christ, il n’y a plus de parole à espérer, plus rien à dire, car tout a été dit en lui (cf. Ascension du Mont Carmel , II, 22, 3-5). Évangéliser, c’est avant tout rendre Jésus-Christ présent et accessible. Toute action de l’Église doit chercher à introduire les êtres humains dans une relation vivante avec lui, une relation qui illumine l’existence, interpelle la liberté et ouvre un chemin de conversion, les préparant à recevoir le don de la foi en réponse à l’Amour qui donne sens et soutient la vie dans toutes ses dimensions.
Cependant, la proclamation de la Bonne Nouvelle s’inscrit toujours dans une expérience concrète. Garder cela à l’esprit, c’est reconnaître et imiter la logique du mystère de l’Incarnation, par lequel le Christ « s’est fait chair et a habité parmi nous » ( Jn 1, 14), assumant notre condition humaine, avec tout ce qu’elle implique dans sa dimension temporelle. Il s’ensuit que la réalité culturelle de ceux qui reçoivent la proclamation ne saurait être ignorée, et l’inculturation n’est pas une concession secondaire ni une simple stratégie pastorale, mais une exigence intrinsèque de la mission de l’Église. Comme le soulignait saint Paul VI , l’Évangile – et, par conséquent, l’évangélisation – ne s’identifie à aucune culture particulière, mais est capable de les imprégner toutes sans se soumettre à aucune ( Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi , 20).
Partant de cette conviction, inculturer l’Évangile signifie suivre le chemin parcouru par Dieu : entrer avec respect et amour dans l’histoire concrète des peuples afin que le Christ soit véritablement connu, aimé et accueilli au cœur de leur propre expérience humaine et culturelle. Cela implique d’embrasser les langues, les symboles, les modes de pensée, de sentiment et d’expression de chaque peuple, non seulement comme des vecteurs extérieurs de la proclamation, mais comme des lieux réels où la grâce désire demeurer et agir.
Il convient toutefois de préciser que l’inculturation ne saurait se réduire à la sacralisation des cultures ni à leur adoption comme cadre d’interprétation définitif du message évangélique. Elle ne saurait non plus se limiter à un accommodement relativiste ou à une adaptation superficielle du message chrétien, car aucune culture, aussi précieuse soit-elle, ne peut se fondre sur la Révélation ni devenir le critère ultime de la foi. Légitimer tout ce qui est culturellement acquis ou justifier des pratiques, des visions du monde ou des structures qui contredisent l’Évangile et la dignité de la personne reviendrait à ignorer que toute culture – comme toute réalité humaine – doit être éclairée et transformée par la grâce qui découle du Mystère pascal du Christ.
L’inculturation est plutôt un processus exigeant et purificateur, par lequel l’Évangile, tout en demeurant entier dans sa vérité, reconnaît, discerne et accueille les germes de la Parole présents dans les cultures, et simultanément purifie et élève leurs valeurs authentiques, les libérant de ce qui les obscurcit ou les déforme. Ces germes de la Parole , traces de l’action antérieure de l’Esprit, trouvent en Jésus-Christ leur critère d’authenticité et leur plénitude.
De ce point de vue, Notre-Dame de Guadalupe est une leçon de pédagogie divine concernant l'inculturation de la vérité salvifique. Elle ne canonise aucune culture ni n'absolutise ses catégories, mais elle ne les ignore ni ne les méprise non plus : elles sont accueillies, purifiées et transfigurées pour devenir un lieu de rencontre avec le Christ. La Vierge de Guadalupe révèle la manière dont Dieu s'approche de son peuple : respectueuse dans son approche, intelligible dans son langage, et ferme et douce à la fois dans son accompagnement vers la rencontre avec la plénitude de la Vérité, avec le fruit béni de ses entrailles. Sur la tilma, parmi les roses peintes , la Bonne Nouvelle pénètre dans le monde symbolique d'un peuple et rend visible sa proximité, offrant sa nouveauté sans violence ni contrainte. Ainsi, ce qui s’est passé à Tepeyac n’est pas présenté comme une théorie ou une tactique, mais comme un critère permanent pour discerner la mission évangélisatrice de l’Église, appelée à proclamer le Vrai Dieu pour qui nous vivons , sans l’imposer, mais aussi sans diluer la nouveauté radicale de sa présence salvatrice.
Aujourd’hui, dans de nombreuses régions des Amériques et du monde, la transmission de la foi ne va plus de soi, notamment dans les grands centres urbains et les sociétés pluralistes marquées par des conceptions de l’humanité et de la vie qui tendent à reléguer Dieu à la sphère privée, voire à l’ignorer complètement. Dans ce contexte, le renforcement de la pastorale exige une inculturation capable de dialoguer avec ces réalités culturelles et anthropologiques complexes, sans pour autant les accepter sans esprit critique, afin de favoriser une foi mature et adulte, soutenue dans des contextes exigeants et souvent difficiles. Cela implique de concevoir la transmission de la foi non comme une répétition fragmentée de contenus ni comme une simple préparation fonctionnelle aux sacrements, mais comme un véritable chemin de disciple, où une relation vivante avec le Christ forme des croyants capables de discerner, de rendre compte de leur espérance et de vivre l’Évangile avec liberté et cohérence.
Dès lors, la catéchèse devient une priorité indispensable pour tous les pasteurs (cf. CELAM, Document Aparecida , 295-300). Elle est appelée à occuper une place centrale dans l’activité de l’Église, à accompagner de manière continue et profonde le cheminement vers une foi véritablement comprise, embrassée et vécue personnellement et consciemment, même lorsque cela implique d’aller à contre-courant des discours culturels dominants.
Lors de ce congrès, vous avez cherché à redécouvrir et à comprendre comment diffuser dignement le contenu théologique de l'événement de Guadalupe et, par conséquent, de l'Évangile lui-même. Puisse l'exemple et l'intercession de tant de saints évangélistes et pasteurs qui ont affronté ce même défi en leur temps – Toribio de Mogrovejo, Junípero Serra, Sebastián de Aparicio, Mamá Antula, José de Anchieta, Juan de Palafox, Pedro de San José de Betancur, Roque González, Mariana de Jesús, Francisco Solano, parmi tant d'autres – vous accorder lumière et force pour continuer à proclamer l'Évangile aujourd'hui. Et que Notre-Dame de Guadalupe, Étoile de la Nouvelle Évangélisation, accompagne et inspire chaque initiative menant au 500e anniversaire de son apparition. Je vous accorde de tout cœur ma bénédiction.
Cité du Vatican, 5 février 2026. Mémoire de saint Philippe de Jésus, protomartyr mexicain.
LEÓN PP. XIV