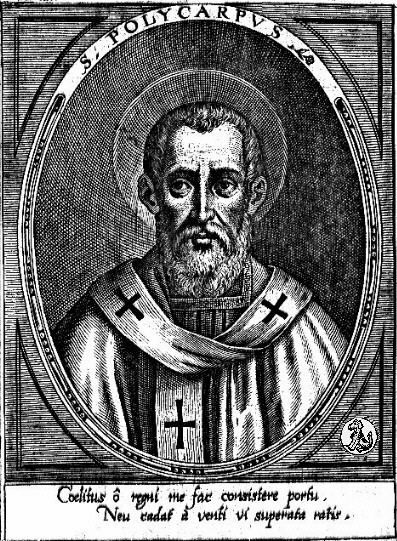De Miguel Escrivá sur InfoVaticana :
Allemagne : laboratoire de l'autodestruction ecclésiale

En Allemagne, l'Église catholique possède l'une des structures économiques les plus solides au monde, et pourtant, elle affiche l'un des taux de fréquentation des sacrements les plus faibles. Le chiffre officiel de 6,6 % des catholiques inscrits à la messe dominicale ne laisse guère présager d'espoir. Plus de 93 % de ceux qui se disent catholiques ne communient pas régulièrement. Dès lors, le pourcentage de fidèles conscients de la nécessité de se confesser et de demeurer en état de grâce peut être réduit, même parmi les catholiques eux-mêmes, à un chiffre négligeable, inférieur à 1 %.
Nous ne sommes pas confrontés à une simple perte de ferveur. Nous sommes confrontés à une rupture profonde avec le cœur sacramentel . Lorsque la messe dominicale cesse d'être l'acte structurant de la communauté et devient une pratique minoritaire, l'Église cesse de s'organiser autour de l'autel et devient une institution culturelle dotée d'un point de référence chrétien. À proprement parler, une communauté où seulement un fidèle sur quinze assiste régulièrement à la messe cesse d'être sociologiquement fonctionnelle en tant qu'Église vivante et met objectivement les âmes en danger.
Vocations : effondrement structurel, et non crise conjoncturelle
Le paysage de la formation religieuse confirme ce constat avec une précision arithmétique. Avec environ 150 séminaristes diocésains à l'échelle nationale et à peine 28 ordinations par an pour près de vingt millions de catholiques, le ratio est le plus faible au monde. Il ne s'agit pas simplement d'un taux de remplacement insuffisant ; il s'agit d'une base de formation incapable d'assurer sa propre pérennité.
Une Église de cette taille démographique, qui forme moins de trente prêtres par an, est inévitablement vouée à une réduction drastique de son réseau paroissial, au regroupement forcé des communautés et à une dépendance structurelle vis-à-vis du clergé étranger. Ces statistiques ne décrivent pas une difficulté passagère ; elles révèlent une impossibilité mathématique de continuité dans les conditions actuelles.
Le contraste est d'autant plus frappant que, sur un même territoire, des communautés comme la Fraternité Saint-Pie-X (FSSP) et la Fraternité Saint-Pierre (SSP) comptent, à elles deux, un nombre de séminaristes comparable à celui de tous les diocèses allemands réunis. Et ce, malgré le fait que l'Allemagne ne soit pas, historiquement, un bastion du traditionalisme. Or, là où la liturgie demeure stable, où la doctrine n'est pas compromise et où l'identité sacerdotale est clairement affirmée, les vocations existent. C'est un fait avéré.
Abus liturgiques et laxisme sacramentel : une érosion de l’intérieur
Au déclin démographique s'ajoute une détérioration qualitative qu'il est impossible d'ignorer. La propagation des abus liturgiques, la banalisation du sens sacrificiel de la messe, le relâchement de la discipline sacramentelle et une réinterprétation progressive de la morale catholique ont engendré un climat d'ambiguïté persistante. Lorsque la liturgie perd son caractère sacré et que la pratique sacramentelle est relativisée, la transmission de la foi s'en trouve inévitablement affectée.
Les statistiques ne sont pas une cause, mais une conséquence. Des décennies d'adaptation progressive, de redéfinition du langage doctrinal et d'érosion symbolique ont produit un résultat vérifiable : le vide.
Le synodisme comme aboutissement du paradigme
Le processus synodal allemand, tel qu'on le prétend, n'émane pas d'une Église forte et expérimentée, mais d'une Église statistiquement épuisée. La proposition d'un modèle de plus en plus sécularisé, délibératif et doctrinalement défaillant est présentée comme une réponse à la crise. Or, les données suggèrent que nous ne sommes pas face à la solution, mais plutôt à l'étape finale d'un processus.
Repenser l'autorité ne suscite pas la foi et contredit le Magistère sur l'ordre. Redistribuer les responsabilités n'accroît pas les vocations. La réorganisation institutionnelle ne remplace pas la vie sacramentelle. Si la fréquentation dominicale n'est que de 6,6 % et que le nombre de vocations est infime, le problème n'est pas un problème de gouvernance, mais un problème d'identité.
État de nécessité et question de l'obéissance
Face à ce constat, la Fraternité Saint-Pie-X (FSSPX) a maintes fois invoqué la notion d’ état de nécessité , s’appuyant sur le principe suprême du salut des âmes , loi suprême de l’Église. L’analyse de cas particuliers, comme celui de l’Allemagne, soulève une question qui dépasse le cadre émotionnel pour entrer dans le domaine moral et juridique : lorsqu’une structure ecclésiale semble objectivement vouée à l’autodétruire, la théorie classique de l’obéissance peut-elle s’appliquer en théorie si son effet concret est l’extinction ?
Dans une Église qui semble sur le point de disparaître, l’évaluation morale ne se limite pas au respect formel des procédures administratives ou synodales. Elle s’envisage à l’aune de la finalité ultime : la préservation de la foi et la transmission de la grâce. Si l’obéissance devient un instrument d’érosion doctrinale ou de vide sacramentel, le débat cesse d’être disciplinaire et se déplace vers celui de la survie de l’Église.
Rome est confrontée à une décision inévitable
L'Allemagne est devenue le paradigme contemporain de la voie moderniste : des ressources abondantes, une « sophistication » institutionnelle et, simultanément, une pratique sacramentelle minimale et des vocations à un niveau historiquement bas. Les statistiques ne sont pas hostiles ; elles sont objectives. Et ce qu'elles décrivent, c'est une Église qui, si cette tendance se poursuit, se réduira à une minorité résiduelle maintenue par des structures formelles.
Le moment synodal place Rome face à un dilemme historique. Soit elle accepte passivement un processus qui, concrètement, équivaut à l'euthanasie institutionnelle d'une Église nationale, soit elle opère une transformation doctrinale et disciplinaire immédiate qui restaure la centralité sacramentelle et l'identité catholique.