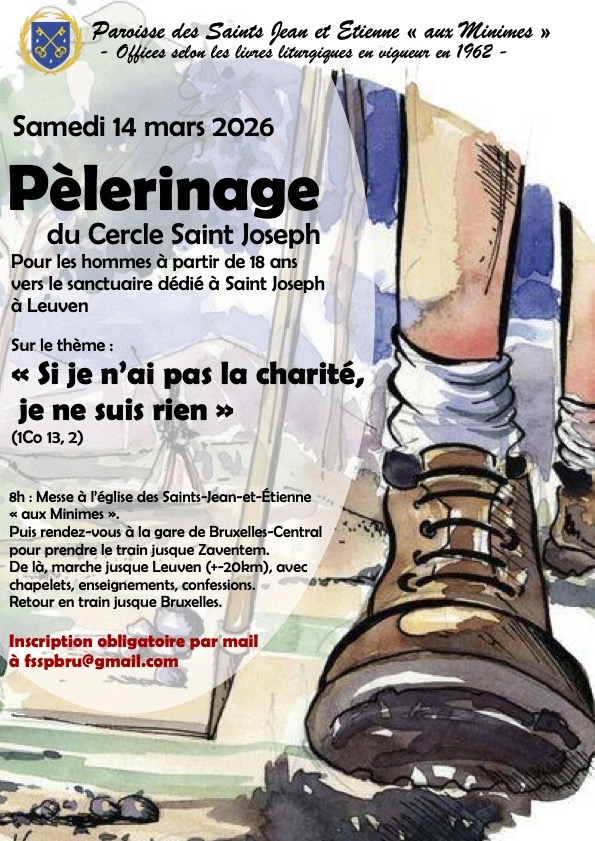
Foi - Page 4
-
Samedi 14 mars; Pèlerinage du Cercle Saint-Joseph : "Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien"
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, conférences, spectacles, manifestations, Eglise, Foi, Spiritualité -
Bruxelles, 26 mars, conférence de Laetitia Calmeyn : Jean-Paul II pour aujourd'hui ?
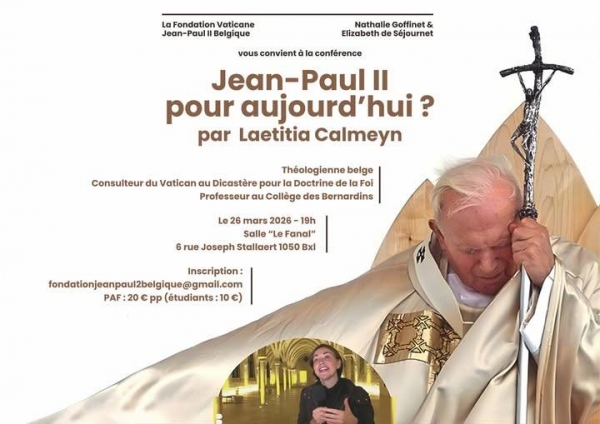
Laetitia Calmeyn est une théologienne belge née le 6 septembre 1975 à Bruxelles. Elle a d’abord travaillé comme infirmière en soins palliatifs avant de se tourner vers la théologie, étudiant à l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles puis obtenant un doctorat en théologie à l’Institut pontifical Jean‑Paul II de Rome en 2009.
Consacrée comme vierge consacrée dans le diocèse de Paris, elle enseigne notamment au Collège des Bernardins et à l’École Cathédrale, spécialisée en théologie morale et anthropologie théologique. Depuis 2018, elle est consulteur au Dicastère pour la doctrine de la foi au Vatican, l’une des premières femmes nommées à cette fonction.
Elle a aussi publié plusieurs ouvrages de théologie, dont des travaux sur l’exhortation Amoris Laetitia du pape François.
-
L'homélie du Pape lors de la messe avec le rite des Cendres
MESSE AVEC LE RITE DES CENDRES
HOMÉLIE DU PAPE LÉON XIV
Basilique Sainte-Sabine en l’Aventin
Mercredi 18 février 2026Chers frères et sœurs,au début de chaque Temps liturgique, nous redécouvrons avec une joie toujours nouvelle la grâce d’être l’Église, c’est-à-dire la communauté convoquée pour écouter la Parole de Dieu. Le prophète Joël nous a rejoints par sa voix qui conduit chacun à sortir de son isolement et fait de la conversion une urgence indissociablement personnelle et publique : « Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! » (Jl 2, 16). Il mentionne les personnes dont l’absence serait facile à justifier : les plus fragiles et les moins aptes à se rassembler en grand nombre. Puis le prophète nomme l’époux et l’épouse : il semble les appeler hors de leur intimité afin qu’ils se sentent partie intégrante d’une communauté plus large. Viennent ensuite à leur tour les prêtres qui se trouvent déjà, presque par devoir, « entre le portail et l’autel » (v. 17) ; ils sont invités à pleurer et à trouver les mots justes pour tous : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple ! » (v. 17).
Le Carême, aujourd’hui encore, est un temps fort de communauté : « Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte » (Jl 2, 16). Nous savons combien il est de plus en plus difficile de rassembler les gens et de se sentir comme un peuple, non pas de manière nationaliste et agressive, mais dans une communion où chacun trouve sa place. C’est même ici que prend forme un peuple qui reconnaît ses propres péchés, à savoir que le mal ne vient pas de prétendus ennemis, mais qu’il a atteint les cœurs, qu’il est présent dans la vie de chacun et qu’il doit être affronté en assumant courageusement ses responsabilités. Nous devons admettre qu’il s’agit d’une attitude à contre-courant mais qui, alors qu’il est si naturel de se déclarer impuissant face à un monde en feu, constitue une véritable alternative, honnête et attirante. Oui, l’Église existe aussi comme prophétie pour des communautés qui reconnaissent leurs propres péchés.
Certes, le péché est personnel, mais il prend forme dans les milieux réels et virtuels que nous fréquentons, dans les attitudes avec lesquelles nous nous conditionnons mutuellement, souvent au sein de véritables “structures de péché” d’ordre économique, culturel, politique et même religieux. Opposer le Dieu vivant à l’idolâtrie – nous enseigne l’Écriture – c’est oser la liberté et la retrouver à travers un exode, un cheminement. Ne plus être paralysés, rigides, sûrs de nos positions, mais rassemblés pour bouger et changer. Comme il est rare de trouver des adultes qui se repentent, des personnes, des entreprises et des institutions qui admettent avoir commis des erreurs !
Aujourd’hui, il s’agit précisément de cette possibilité pour nous. Et ce n’est pas un hasard si de nombreux jeunes, même dans des contextes sécularisés, ressentent plus que par le passé l’appel de ce jour, le Mercredi des Cendres. Ce sont eux, en effet, les jeunes, qui saisissent distinctement qu’un mode de vie plus juste est possible et qu’il existe des responsabilités quant à ce qui ne va pas dans l’Église et dans le monde. Il convient donc de commencer là où l’on peut et avec ceux qui sont là. « Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut ! » (2 Co 6, 2). Nous sentons donc la portée missionnaire du Carême, non pas pour nous détourner du travail sur nous-mêmes, mais pour l’ouvrir à nombre de personnes inquiètes et de bonne volonté qui cherchent les voies d’un authentique renouveau de la vie, à l’horizon du Royaume de Dieu et de sa justice.
« Pourquoi les peuples diraient-ils : « Où donc est leur Dieu ? » » (Jl 2, 17). La question du prophète est comme un aiguillon. Elle nous rappelle aussi ces pensées qui nous concernent et qui surgissent chez ceux qui observent le peuple de Dieu de l’extérieur. Le Carême nous incite en effet à ces revirements – ces conversions – dont dépend la crédibilité de notre annonce.
Il y a soixante ans, quelques semaines après la fin du Concile Vatican II, saint Paul VI voulut célébrer publiquement le rite des cendres, rendant visible à tout le monde, lors d’une Audience générale dans la Basilique Saint-Pierre, le geste que nous sommes sur le point d’accomplir aujourd’hui. Il en parla comme d’une « cérémonie pénitentielle sévère et impressionnante » (Paul VI, Audience générale, 23 février 1966), qui heurte le sens commun et en même temps rejoint les questions de la culture. Il disait : « Nous, les modernes, nous pouvons nous demander si cette pédagogie est encore compréhensible. Nous répondons par l’affirmative. Parce qu’il s’agit d’une pédagogie réaliste. Elle est un rappel sévère à la vérité. Elle nous ramène à la vision juste de notre existence et de notre destin ».
Cette « pédagogie pénitentielle » – disait Paul VI – « surprend l’homme moderne sous deux aspects » : le premier est « celui de son immense capacité d’illusion, d’autosuggestion, de tromperie systématique de lui-même sur la réalité de la vie et ses valeurs ». Le second aspect est « le pessimisme fondamental » que le Pape Montini constatait partout : « La plupart des témoignages humains que nous offrent aujourd’hui la philosophie, la littérature, le spectacle – disait-il – concluent en proclamant la vanité inéluctable de toute chose, l’immense tristesse de la vie, la métaphysique de l’absurde et du néant. Ces témoignages sont une apologie des cendres ».
Nous pouvons aujourd’hui reconnaître la prophétie que contenaient ces paroles et sentir dans les cendres qui nous sont imposées le poids d’un monde en feu, de villes entières détruites par la guerre : les cendres du droit international et de la justice entre les peuples, les cendres d’écosystèmes entiers et de la concorde entre les personnes, les cendres de la pensée critique et des anciennes sagesses locales, les cendres de ce sens du sacré qui habite toute créature.
« Où donc est leur Dieu ? », se demandent les peuples. Oui, très chers amis, l’histoire nous le demande, et avant cela, notre conscience : appeler la mort par son nom, en porter les signes, mais témoigner de la résurrection. Reconnaître nos péchés pour nous convertir est déjà un présage et un témoignage de résurrection : cela signifie en effet ne pas s’arrêter dans les cendres, mais se relever et reconstruire. Alors, le Triduum pascal, que nous célébrerons au sommet du cheminement du Carême, libérera toute sa beauté et sa signification. Il le fera en nous ayant engagés, par la pénitence, dans le passage de la mort à la vie, de l’impuissance aux possibilités de Dieu.
C’est pourquoi les martyrs d’hier et d’aujourd’hui brillent comme des pionniers de notre chemin vers Pâques. L’ancienne tradition romaine des stations de Carême – dont celle d’aujourd’hui est la première – est instructive : elle renvoie autant au mouvement, en tant que pèlerins, qu’à la pause – statio – auprès des “mémoires” des martyrs sur lesquelles s’élèvent les basiliques de Rome. N’est-ce pas une invitation à nous mettre sur les traces des témoignages admirables dont le monde entier est désormais parsemé ? Reconnaître les lieux, les histoires et les noms de ceux qui ont choisi la voie des Béatitudes et en ont assumé les conséquences jusqu’au bout. Une myriade de semences qui, alors qu’elles semblaient perdues, ensevelies dans la terre, ont préparé la moisson abondante qu’il nous appartient de récolter. Le Carême, comme nous le suggère l’Évangile, en nous libérant du désir d’être vus à tout prix (cf. Mt 6, 2.5.16), nous apprend plutôt à voir ce qui naît, ce qui grandit, et nous pousse à le servir. C’est l’harmonie profonde qui s’établit dans le secret de celui qui jeûne, prie et aime avec le Dieu de la vie, notre Père et celui de tous. C’est vers Lui que nous réorientons, avec sobriété et joie, tout notre être, tout notre cœur.
Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, liturgie, Magistère, Spiritualité -
Forte hausse continue du nombre de baptêmes d’adultes dans l’Église catholique en Belgique
Du service de presse et d'information de la conférence des évêques de Belgique :
Forte hausse continue du nombre de baptêmes d’adultes dans l’Église catholique en Belgique
 Par Peter Haegeman
Par Peter HaegemanLe nombre d'adultes candidats au baptême dans l'Église catholique en Belgique continue d'augmenter de manière remarquable. Cette année, ils sont 689, soit trois fois plus qu'il y a dix ans et une hausse de presque 30 % par rapport à l’année précédente.
Ce 18 février, mercredi des Cendres, marque le début du Carême, période pendant laquelle les chrétiens se préparent à Pâques, fête de la Résurrection et sommet de l’année liturgique. Pour les catéchumènes, c’est-à-dire les candidats adultes au baptême, ce temps revêt une importance particulière : ils se préparent plus intensément à recevoir le baptême lors de la nuit de Pâques. Cette année, celle-ci tombe le 4 avril.
En 2025, ils étaient 534. Il y a dix ans, en 2016, 229 catéchumènes ont été accueillis dans l'Église catholique de notre pays par le baptême. En 2026, nous enregistrons donc un triplement par rapport à dix ans auparavant, ce qui confirme la croissance que nous avons également observée ces dernières années.
Voici les chiffres par diocèse pour cette année (2026) :Anvers 57 Bruges 9 Gand 38 Hasselt 25 Brabant Flamand & Malines 53 Malines-Bruxelles 248 Bruxelles 152 Brabant Wallon 43 Liège 79 Namur 56 Tournai 177 Total 689 Dimanche prochain, les catéchumènes célèbrent l'appel décisif
Le dimanche 22 février, ces catéchumènes franchiront une étape importante sur le chemin qui les mène au baptême. Ils répondront à l’appel décisif célébré dans chaque diocèse. L'étape suivante et ultime consiste à recevoir le baptême, l'Eucharistie et la confirmation pendant la Vigile pascale, dans la nuit de Pâques.
L’appel décisif marque une étape déterminante dans le cheminement des candidats vers le baptême : l'évêque les reconnaît officiellement comme admis à recevoir les sacrements d'initiation (baptême, première communion et confirmation) lors de la Vigile pascale.
À partir de ce moment, le Carême prend pour eux le caractère d'une période intensive de préparation spirituelle. C'est un temps de purification intérieure et d'approfondissement de la foi. Les catéchumènes sont invités à aligner de plus en plus leur vie sur l'Évangile. Ainsi, lors de la Vigile pascale, ils pourront recevoir le baptême, l'Eucharistie et la confirmation avec un cœur libre et croyant. C'est pourquoi il est très important que ces nouveaux chrétiens (‘néophytes’) continuent à être accompagnés par la communauté des croyants après la Vigile pascale, afin qu'ils puissent grandir dans la foi et l'engagement. -
"Dieu existe : les preuves scientifiques"; une video vue près d'un million de fois
De "1000 raisons de croire" :

Olivier Bonnassies, fondateur de 1000 raisons de croire, vient d’être reçu sur la chaîne YouTube LEGEND pour parler des preuves de l’existence de Dieu et de son livre « Dieu, la science, les preuves ».
Bientôt 1 million de vues et déjà plus de 8 500 commentaires : cette interview, mise en ligne il y a quelques jours, rencontre un très grand écho, et les réactions sont nombreuses. Cela confirme ce que nous constatons depuis le lancement des 1000 raisons de croire : en France, la question de Dieu n’a rien perdu de sa force.
En lançant le projet des 1000 raisons de croire, l’un de nos objectifs était précisément de remettre la question de l’existence de Dieu au cœur du débat, avec une approche accessible, rationnelle et lumineuse. Aujourd’hui, ce débat est bien là.
Comme vous le savez, les réseaux sociaux façonnent une part importante de l’opinion publique. Il est essentiel d’y être présents pour y porter une parole claire, respectueuse, et capable de transmettre la vérité dans la charité.
Concrètement, nous vous invitons à :
- regarder la vidéo,
- la liker et la partager,
- laisser un commentaire positif et encourageant,
- et, si vous le pouvez, interagir avec d’autres en répondant avec bienveillance.
Voici le lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=ZiQiRMZ2XQU Merci pour votre engagement fidèle et pour votre service de la vérité.
L’équipe de 1000 raisons de croire
-
Le carême, temps de conversion
Un emprunt à nos frères orthodoxes sur le site sagesse-orthodoxe.fr :
LE CARÊME, TEMPS DE LA CONVERSION
On emploie l’expression « se convertir », mais, en fait, c’est le Seigneur qui nous rappelle. Il ramène son peuple de la captivité spirituelle, comme Il l’a, autrefois, ramené de la captivité de Babylone ou de l’esclavage d’Égypte. Le Seigneur attire l’homme à lui, Il l’appelle, Il le cherche et Il cherche à susciter en lui la nostalgie de son amour et de sa familiarité. L’exemple du Fils débauché est très parlant : l’Esprit saint agit dans le cœur de l’homme et lui donne le désir de retourner vers le Père. Un théotokion du jeudi de la 4ème semaine de Carême (Cathisme III, t.7) exprime ce mystère en une prière : « Seigneur, nous sommes ton peuple, les brebis de ton bercail : vers toi ramène tes enfants dispersés ; sous ta houlette rassemble les brebis égarées, de ton troupeau aie pitié, bon Pasteur, par les prières de la Mère de Dieu, seul Ami des hommes et Seigneur sans péché. » Le psaume 50 l’annonce : « les impies reviendront à toi ».
Dieu agit
La conversion n’est pas un phénomène moral ; elle correspond à une action de Dieu. Cet appel adressé par Dieu à son peuple, et à chaque membre de ce peuple, était très fort chez les anciens, exprimé par la bouche des grands prophètes ; il est devenu encore plus profond depuis l’Incarnation, la Résurrection et la Pentecôte. Plus que jamais, le Seigneur agit de l’intérieur de l’homme pour l’appeler à la communion avec lui-même : « suis-moi ! ». Nous pouvons donc prier ainsi : Convertis-nous, ô Dieu de miséricorde ! « Convertis-moi, que je revienne ! », dit le prophète Jérémie (31, 18).
Description
Le désir d’être sauvé est une des façons dont le Seigneur nous appelle. « Lorsque je vois l’océan de cette vie soulevé par la tempête des tentations, j’accours à ton havre de paix et je te prie, ô Dieu de bonté : À la fosse rachète ma vie ! » (hirmos de la 6ème ode en ton 6). La pensée de la mort et de la brièveté de la vie nous réveille du sommeil de l’inconscience et de l’oubli qui nous tuent. Mais surtout le désir des biens à venir, la promesse d’une jouissance indéfinie auprès à l’ombre de l’amour, stimulent la conversion : Dieu « a promis, dans l’observance de ses commandements, immortalité de vie et jouissance des biens éternels » (anaphore de saint Basile)
La conversion sera un véritable retour de l’esprit vers Dieu, un changement de la pensée, une révolution de la mentalité. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur » (Isaïe 55, 8). La conversion est un retournement dont l’enjeu est d’acquérir la pensée divine. Cherchons, dit saint Paul, à avoir la pensée du Christ (1 Co 2, 16).
Méthode
Comment le faire ? Il s’agit de changer nos habitudes. Nous sommes habitués au péché, à vivre loin de Dieu et de son Église. Nous sommes gagnés par les pensées et la mentalité du monde. Pour retrouver la mentalité du Christ et de ses disciples, il nous est proposé une période de recyclage, en quelque sorte, de remise à niveau, comme on le fait dans le monde professionnel, de rééducation volontaire. Saint Silouane le dit : nous pouvons remplacer des habitudes par d’autres habitudes, étant entendu que l’homme est un animal d’habitude. Nous devons nous habituer ou nous réhabituer à Dieu, à sa familiarité, à sa douceur, au bien-être qu’il y a à se trouver dans sa maison, chez lui, c’est-à-dire chez nous, puisque nous sommes ses fils et ses filles.
Exerçons-nous ainsi au pardon, au non jugement, à la sobriété pour changer l’habitude de la gourmandise, à la fidélité aux offices et aux prières communautaires, à nous confesser plus fréquemment afin de communier plus souvent. Entraînons-nous à lire la parole de Dieu, à nous montrer aimables et prévenants avec notre prochain ; habituons-nous à un rythme régulier de prière quotidienne. Ces nouvelles habitudes vont véritablement changer notre vie quotidienne et toute notre mentalité, notre regard sur autrui et sur l’actualité.
Le repentir
La conversion n’est pas encore le repentir. Elle est une subversion dans nos habitudes mentales, alimentaires, affectives, voire sexuelles. Mais elle n’a rien à voir avec le repentir, parce qu’elle n’est qu’un changement – révolutionnaire, certes – dans l’organisation de la vie, une discipline de vie en quelque sorte. Mais le repentir est autre chose : c’est un sentiment douloureux de deuil ; un regret douloureux de ses fautes, du temps perdu dans le péché ; une vraie amertume de s’être si longtemps, et stupidement, privé de l’amour de Dieu. Le repentir est un passage de la « mortelle tristesse », ou de la tristesse morbide et mortifère, qui est celle du monde, à ce qu’on appelle la « componction » (Jeudi de la 4ème semaine de Carême, ode 9, théotokion). Celle-ci signifie un cœur blessé par la nostalgie de la familiarité de Dieu. « Pourquoi m’as-Tu repoussé loin de ta face, Lumière inaccessible ? Malheureux que je suis, les ténèbres extérieures m’ont enveloppé ; fais-moi revenir je t’en supplie, et dirige mes pas vers la lumière de ta loi » (hirmos en ton 8 de la 5ème ode). Pour se muer en repentir, la conversion doit être animée par un cri douloureux, une lamentation, une supplication qui peut aller jusqu’aux larmes. La lecture des écrits de saint Silouane nous instruit beaucoup sur cela.
-
Ne pas confondre carême et ramadan
D'Annie Laurent ("petite feuille verte") (archive 9 mars 2013) :
PFV n°9 : Le carême et le ramadan
Dans l’Islam, le culte comporte cinq prescriptions que l’on appelle « piliers » : la profession de foi (chahâda), la prière rituelle (salât), l’aumône légale (zakat), le jeûne du Ramadan (sawm) et le pèlerinage à La Mecque (hajj).
Le sens du mot « Ramadan »
« Ramadan », mot dont l’étymologie évoque la chaleur brûlante, est le nom d’un mois sacré, le neuvième de l’année lunaire musulmane, durant lequel « le Coran fut descendu, comme guidance pour les hommes » (Coran 2, 185).
Un jeûne obligatoire
Pour le Coran, la prescription du jeûne durant le mois de Ramadan émane de Dieu Lui-même qui énonce aussi deux cas d’exemption, les voyageurs et les malades, quitte à eux de rattraper les jours perdus (2, 183-185). La tradition a étendu ces dispenses aux femmes enceintes (astreintes elles aussi au « rattrapage ») et aux enfants jusqu’à leur puberté.
Les règles du jeûne
Le Dieu du Coran précise les modalités de ce jeûne : « Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, à l’aube. Ensuite, faites jeûne complet jusqu’à la nuit » (Coran 2, 187). Il s’agit, du lever au coucher du soleil, de s’abstenir de toute consommation de nourriture et de boisson, y compris de la moindre goutte d’eau, de tabac et de relations sexuelles, sous peine de « rupture illicite du jeûne ». Même le fait d’avaler la salive est interdit. Dans certains pays musulmans, pendant le Ramadan, les dentistes ne travaillent que la nuit, afin d’éviter ce risque à leurs patients. Les cafés et restaurants sont fermés pendant la journée.
La rupture légale du jeûne
Dès le coucher du soleil, tous les interdits cessent. Les musulmans se retrouvent alors pour « rompre le jeûne » autour d’un repas festif, l’iftar, auquel ils convient leurs parents, leurs proches et leurs amis (y compris des non musulmans). La fête peut durer tard dans la nuit, la nourriture est souvent abondante et comporte des mets de choix. Les musulmans prennent par ailleurs une collation tôt le matin, avant le lever du jour.
-
Une homélie de Benoît XVI pour la messe des Cendres
Homélie de Benoît XVI pour la messe des Cendres
13/02/2013
« Frères vénérés,
Chers frères et sœurs,
Aujourd’hui, Mercredi des Cendres, nous entamons un nouveau chemin de Carême, chemin qui se déroule sur quarante jours et nous conduit à la joie de la Pâque du Seigneur, à la victoire de la Vie sur la mort. Selon la très ancienne tradition romaine des “stations” de Carême, nous sommes rassemblés pour la célébration de l’Eucharistie. Cette tradition prévoit que la première “station” ait lieu dans la basilique de Sainte-Sabine, sur la colline de l’Aventin. Les circonstances ont suggéré de se rassembler dans la Basilique Vaticane. Ce soir, nous sommes nombreux autour de la tombe de l’apôtre Pierre afin, aussi, de lui demander son intercession pour le chemin de l’Église en ce moment particulier, renouvelant notre foi dans le pasteur suprême de l’Église, le Christ Seigneur. Pour moi, c’est un moment approprié pour remercier chacun, spécialement les fidèles du diocèse de Rome, alors que j’apprête à conclure mon ministère pétrinien et pour demander un soutien particulier dans la prière.
Les lectures qui ont été proclamées nous offrent des éléments qu’avec la grâce de Dieu, nous sommes appelés à transformer en attitudes et en comportements concrets au cours de ce Carême. L’Église nous propose tout d’abord l’appel très fort que le prophète Joël adresse au peuple d’Israël : « Parole du Seigneur : revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil » (2, 12). Il faut souligner l’expression « de tout votre cœur » qui signifie : du centre de nos pensées et de nos sentiments, des racines de nos décisions, de nos choix, de nos actions, dans un geste de liberté totale et radicale. Mais ce retour à Dieu est-il possible ? Oui, parce que c’est une force qui ne vient pas de notre cœur mais qui se libère du cœur même de Dieu. C’est la force de sa miséricorde. Le prophète dit encore : « Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment » (2, 13). Revenir au seigneur est possible comme “grâce” parce qu’elle est œuvre de Dieu et fruit de la foi que nous confions à sa miséricorde. Mais ce retour à Dieu devient une réalité concrète dans notre vie seulement lorsque la grâce du Seigneur pénètre dans l’intime et le secoue, nous donnant la force de « déchirer nos cœurs ». C’est encore le prophète qui fait résonner ces mots de la part de Dieu : « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » (2, 13). De fait, y compris de nos jours, nombreux sont ceux qui sont prêts à « déchirer leurs vêtements » en face de scandales et d’injustices – naturellement commises par d’autres – mais peu nombreux semblent être ceux qui sont prêts à agir sur leur propre ‘’cœur», sur leur propre conscience et leurs intentions pour laisser le Seigneur les transformer, les renouveler et les convertir.
Ce « revenez à moi de tout votre cœur » est ensuite un appel qui s’adresse non seulement à l’individu mais à la communauté. Nous avons entendu dans la première lecture : « Sonnez de la trompette dans Jérusalem : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! » (2, 15-16). La dimension communautaire est un élément essentiel de la foi et de la vie chrétienne. Le Christ est venu « afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (cf Jn 11, 52). Le « nous » de l’Église est la communauté dans laquelle Jésus nous réunit tous ensemble (cf Jn 12, 32) : la foi est nécessairement ecclésiale. Il est important de s’en souvenir et de le vivre en ce temps de Carême : que chacun d’entre nous sache que le chemin pénitentiel ne doit pas être vécu dans la solitude mais avec tant de frères et sœurs, dans l’Église.
Le prophète, pour finir, s’arrête sur la prière des prêtres, lesquels, les larmes aux yeux, s’adressent à Dieu pour lui dire : : « N’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : ‘Où donc est leur Dieu ?’ » (2, 17). Cette prière nous fait réfléchir sur l’importance du témoignage de foi et de vie chrétienne de chacun d’entre nous et de nos communautés pour exprimer le visage de l’Église et comment ce visage peut être parfois défiguré. Je pense en particulier aux fautes contre l’unité, aux divisions dans le corps ecclésial. Vivre le Carême dans une communion ecclésiale plus intense et plus évidente, en surmontant les individualismes et les rivalités, est un signe humble et précieux en direction de ceux qui loin de la foi ou indifférents.
« Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut ! » (2 Co 6, 2). Les paroles de l’apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe résonnent encore pour nous avec une urgence qui n’admet ni absence ou inertie. Le mot « maintenant » répété plusieurs fois dit qu’on ne peut laisser fuir ce moment, que ce moment nous est offert comme une occasion unique et irremplaçable. Et le regard de l’Apôtre se concentre sur le partage par lequel le Christ a voulu caractériser son existence, assumant l’humanité jusqu’à prendre sur lui le péché des hommes. La phrase de saint Paul est très forte : Dieu « l’a fait péché pour nous ». Jésus, l’innocent, le Saint, « celui qui n’avait pas connu le péché » (2 Co 5, 21), prend sur lui le poids du péché, partageant avec l’humanité le résultat de la mort, et de la mort sur la croix. La réconciliation qui nous est offerte s’est faite au prix le plus fort, celui de la croix dressée sur le Golgotha, sur laquelle a été suspendu le Fils de Dieu fait homme. Dans cette plongée de Dieu au cœur de la souffrance humaine et dans l’abîme du mal se trouve la racine de notre justification. Le « revenez à Dieu de tout votre cœur » de notre chemin de Carême passe par la Croix, à la suite du Christ sur la route qui conduit au Calvaire, au don total de soi. C’est un chemin sur lequel il faut apprendre chaque jour à sortir toujours plus de notre égoïsme et de nos fermetures, pour faire place à Dieu qui ouvre et transforme le cœur. Et saint Paul rappelle comment l’annonce de la Croix résonne pour nous grâce à la prédication de la Parole, dont l’Apôtre lui-même est l’ambassadeur ; c’est un appel qui nous est lancé pour que ce chemin de Carême soit marqué par une écoute plus attentive et assidue de la Parole de Dieu, lumière qui illumine nos pas.
Dans la page de l’Évangile de Matthieu, qui appartient à ce qu’on appelle le Sermon sur la montagne, Jésus se réfère à trois pratiques fondamentales prévues par la Loi de Moïse : l’aumône, la prière et le jeune. ; ce sont encore des indications traditionnelles de la démarche de Carême pour répondre à l’invitation qui nous est faite de « revenir à Dieu de tout son cœur ». Mais Jésus souligne que c’est la qualité et la vérité de la relation à Dieu qui qualifie l’authenticité de tout geste religieux. C’est ainsi qu’il dénonce l’hypocrisie religieuse, le comportement de ceux qui se veulent se montrer en spectacle, les attitudes de ceux qui cherchent les applaudissements et les approbations. Le vrai disciple ne sert ni lui-même, ni le « public », mais son Seigneur, dans la simplicité et la générosité : « Ton Père, qui voit dans le secret, te le revaudra » (Mt 6 4.6.18). Notre témoignage sera d’autant plus incisif que nous chercherons moins notre propre gloire et que nous aurons conscience que la récompense du juste, c’est Dieu lui-même, c’est d’être uni à Lui, ici, sur le chemin de la foi et au terme de la vie, dans la paix et la lumière du face-à-face avec Lui pour toujours (cf. 1 Co 13, 12).
Chers frères et sœurs, commençons l’itinéraire du Carême, confiants et joyeux. Que l’invitation à la conversion, à « retourner à Dieu de tout notre cœur » résonne fortement en nous, dans l’accueil de sa grâce qui fait de nous des hommes nouveaux, l’accueil de cette surprenante nouveauté qui est la participation à la vie même de Jésus. Que personne d’entre nous ne reste sourd à cet appel qui nous est encore adressé à travers l’austère rite des cendres qui vont nous être imposées dans quelques instants. Que la Vierge Marie, Mère de l’Église et modèle de tout disciple authentique du Seigneur, nous accompagne dans cette démarche. Amen ! »
-
Carême 2026 : plusieurs plateformes proposent des parcours spirituels numériques
Plusieurs plateformes proposent des parcours spirituels numériques pour vous accompagner quotidiennement :- Hozana : Propose des communautés de prière et des méditations quotidiennes envoyées par email.
- Prions en Église : Avec Prions en Eglise, “Le Seigneur est mon bonheur, chemin vers Pâques”. Chaque jour, recevez dans votre boîte mail la méditation du jour. C’est ainsi que Prions en Église vous accompagne sur le chemin vers Pâques et vous aide à ne pas abandonner. Ensemble, avançons pas à pas, à l’écoute de la Parole tout au long du Carême.
Chaque jour, écoutez l’évangile et la méditation du père Sébastien Antoni et prenez le temps de lire le texte proposé. Par l’écoute et la lecture, la Parole s’installe dans votre quotidien, fortifie votre fidélité et prépare votre cœur à célébrer Pâques dans la joie. Découvrir et s’inscrire
- Le Coach Carême (Chemin Neuf) : Un parcours de 40 jours avec saint Jean de la Croix particulièrement adapté à ceux qui découvrent ou redécouvrent la foi.
- KTO TV : Retransmet en direct les grandes célébrations (comme les offices du Mercredi des Cendres à Notre-Dame de Paris) et propose des enseignements vidéo.
- Hallow : Application de méditation chrétienne proposant des défis de prière et de jeûne structurés.
- Carême 2026 avec Misericordia : Miséricordia, et si vous viviez un Carême missionnaire ? Misericordia vous invite cette année à vivre un carême différent, exigeant, authentique et… missionnaire ! Découvrez ce parcours de 40 jours qui vous invitera à revisiter les fondamentaux du Carême tout en vous permettant d’avancer de manière concrète dans votre vie de foi, dans votre relation au Seigneur et de vivre une expérience missionnaire impactante et concrète. Découvrir et s’inscrire
- (Re)viens à la source du baptême : la proposition du Jour du Seigneur. Le Jour du Seigneur invite à vivre le temps de carême avec un nouveau parcours inspiré des trésors spirituels et liturgiques de l’Église. Inscrivez-vous ! Pour ce carême 2026, Le Jour du Seigneur vous propose de (re)venir à la source vivante du baptême. En communion avec toutes celles et ceux qui se préparent à recevoir ce sacrement dans la nuit de Pâques, et guidés par un des premiers prédicateurs de l’Église, Saint Cyrille de Jérusalem (IVè s), nous revisiterons pendant 7 semaines les grands signes du baptême, leur enracinement et leur sens profond. (Voir le parcours)
- Avec Prie en Chemin, animerez-vous un petit groupe de partage ? Avec Prie en Chemin, vivez un carême de consolation et de conversion. Prie en Chemin s’associe au Secours Catholique et au CCFD pour vous proposer un parcours de Carême intitulé « Je serai avec toi ». À l’écoute de la Parole de Dieu et du partage de foi de frères et sœurs chrétiens ayant vécu la précarité, se dessinera un chemin de conversion à ce Dieu qui porte toujours secours. Il sera possible de cheminer avec d’autres au sein d’équipes fraternelles tout au long de ce temps de préparation à Pâques. Découvrir et s’inscrire en vidéo
- Avec Retraites dans la ville des Dominicains : « Revenez à moi de tout votre cœur ». Vous vous sentez parfois déboussolés ? Votre vie spirituelle est au ralenti ? Vous avez la flemme de vous lancer dans un nouveau carême Carême dans la ville est fait pour vous ! « Revenez à moi de tout votre coeur » : cette parole du prophète Joël résonne avec force aujourd’hui. Un vibrant appel à la conversion pour un chemin de repentance authentique. Reprenons confiance dans la miséricorde du Seigneur ! Découvrir et s’inscrire
- Avec Prier aujourd’hui, au fil des jours. Plongez dans le silence, à la rencontre de Dieu qui vous parle dans sa Parole ! Pour ce Carême 2026 : six semaines, six textes de la Bible et un podcast quotidien pour vous guider dans votre découverte de la Parole. Alors prenez une Bible, de quoi écrire, asseyez-vous tranquillement et… chut, écoutez-le ! Découvrir et s’inscrire
- Carême 40 pour mieux aimer la Bible avec Fraternité Saint-Vincent-Ferrier Programme et inscriptions
- Et aussi sur RCF Radio Notre-Dame
- Et encore : Vivre le Carême autrement avec l’application YouPray https://youpray.fr/
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Christianisme, Eglise, Foi, Spiritualité -
Homélie pour le Mercredi des Cendres
Du Père Joseph-Marie Verlinde sur homélies.fr (Archive 2004) :
« Revenez à moi » : le Seigneur nous invite lui-même à cet acte d’audace inouïe qui consiste à revenir à lui, alors que dans notre folie, nous nous étions éloignés de la Source de tout bien. Et comme pour nous rassurer et vaincre nos ultimes résistances, il proteste de ses bonnes intentions : « Le Seigneur votre Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment » (1ère lect.) ; bien plus : « Il désire vous combler de ses bienfaits ».
En ce jour où nous commençons par un saint jeûne le temps de pénitence du Carême, il est bon de nous imprégner de ces paroles pleines d’espérance, qui doivent orienter tout notre cheminement vers Pâques.
-
"Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant" (Bernadette Soubirous)
 C'est aujourd'hui la fête de sainte Bernadette Soubirous (1844-1879), elle qui déclarait : "C'est parce que j'étais la plus pauvre et la plus ignorante que la Sainte Vierge m'a choisie ". "Cette date à été choisie car c’est un 18 février que la Vierge Marie lui dit : « Je ne vous promets de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre. » Bernadette avait 14 ans lorsqu’elle vit pour la première fois la Vierge. Fille aînée d’une famille de meunier que l’arrivée des moulins à vapeur jettera dans une extrême pauvreté, Bernadette SOUBIROUS est accueillie en janvier 1858 à l’Hospice de Lourdes dirigé par les Sœurs de la Charité de Nevers, pour y apprendre à lire et à écrire afin de préparer sa première communion. En février 1858, alors qu’elle ramassait du bois avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui apparaît au creux du rocher de Massabielle, près de Lourdes. Dix huit Apparitions auront ainsi lieu entre février et juillet 1858. Chargée de transmettre le message de la Vierge Marie, et non de le faire croire, Bernadette résistera aux accusations multiples de ses contemporains. En juillet 1866, voulant réaliser son désir de vie religieuse, elle entre chez les Sœurs de la Charité de Nevers à Saint-Gildard, Maison-Mère de la Congrégation. Elle y mène une vie humble et cachée. Bien que de plus en plus malade, elle remplit avec amour les tâches qui lui sont confiées. Elle meurt le 16 avril 1879 à 35 ans.
C'est aujourd'hui la fête de sainte Bernadette Soubirous (1844-1879), elle qui déclarait : "C'est parce que j'étais la plus pauvre et la plus ignorante que la Sainte Vierge m'a choisie ". "Cette date à été choisie car c’est un 18 février que la Vierge Marie lui dit : « Je ne vous promets de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre. » Bernadette avait 14 ans lorsqu’elle vit pour la première fois la Vierge. Fille aînée d’une famille de meunier que l’arrivée des moulins à vapeur jettera dans une extrême pauvreté, Bernadette SOUBIROUS est accueillie en janvier 1858 à l’Hospice de Lourdes dirigé par les Sœurs de la Charité de Nevers, pour y apprendre à lire et à écrire afin de préparer sa première communion. En février 1858, alors qu’elle ramassait du bois avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui apparaît au creux du rocher de Massabielle, près de Lourdes. Dix huit Apparitions auront ainsi lieu entre février et juillet 1858. Chargée de transmettre le message de la Vierge Marie, et non de le faire croire, Bernadette résistera aux accusations multiples de ses contemporains. En juillet 1866, voulant réaliser son désir de vie religieuse, elle entre chez les Sœurs de la Charité de Nevers à Saint-Gildard, Maison-Mère de la Congrégation. Elle y mène une vie humble et cachée. Bien que de plus en plus malade, elle remplit avec amour les tâches qui lui sont confiées. Elle meurt le 16 avril 1879 à 35 ans.Elle est béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933. Son corps retrouvé intact, repose depuis 1925, dans une châsse en verre dans la Chapelle. Chaque année, venant du monde entier, des milliers de pèlerins et de visiteurs, se rendent à Nevers pour accueillir le message de Bernadette." catholique.org
-
Sainte Bernadette Soubirous (18.2); "Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l'autre."

Sainte Bernadette Soubirous[1]
Décret de la S. Congrégation des Rites[2] sur l'héroïcité de ses vertussource : missel.free
Le 18 novembre 1923 eut lieu dans la salle ducale au Palais du Vatican la cérémonie de lecture solennelle du Décret sur l'héroïcité des verus de la Vénérable Bernadette Soubirous. Cette Cause « intéresse l'univers catholique tout entier » à cause des rapports qui la rattachent au grand fait de Lourdes, et dans une lettre à ses diocésains Mgr. Chatelus, évêque de Nevers, déclare qu'elle est « particulièrement chère au Pape [ancien pélerin de Lourdes], qui en possède tous les détails et en désire le succès ».
Sur cette question : « Est-il bien établi, dans le cas et pour l'effet dont il s'agit, que les vertus théologales de Foi, d'Espérance et de Charité envers Dieu et le prochain, ainsi que les vertus cardinales de Prudence, de Justice, de Force et de Tempérance et leurs annexes, ont été pratiquées à un degré héroïque ? »
