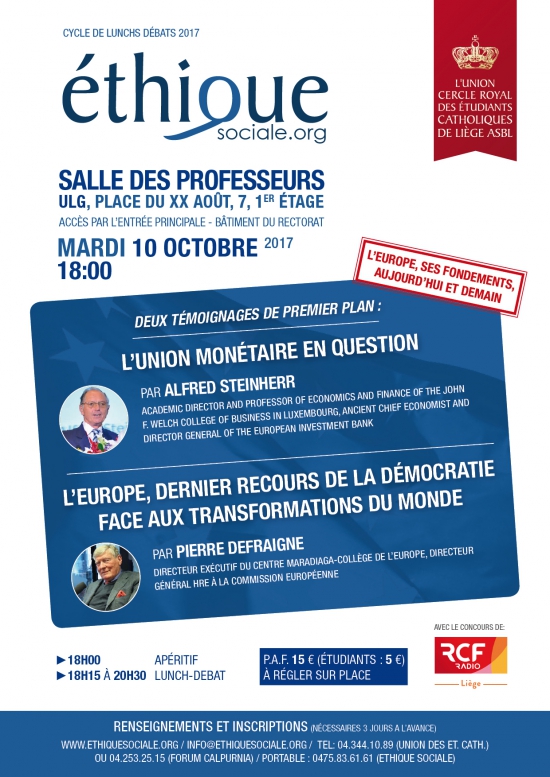D'Antoine-Marie Izoard sur le site de l'hebdomadaire "Famille chrétienne" :
Cardinal Tagle : « Le pape François est un conservateur ! »
EXCLUSIF MAG – L’archevêque de Manille, le cardinal Luis Antonio Tagle, est façonné par sa rencontre avec les pauvres. De passage en France, il nous a accordé un entretien exceptionnel.
Pétri d’humilité et légèrement timide, le cardinal Luis Antonio Tagle ne court pas après les interviews. Celui que l’on surnomme Chito, un diminutif donné par sa mère, a pourtant accepté de nous recevoir à l’occasion d’un bref passage en France. C’est au sanctuaire de Lisieux, où il était venu célébrer les fêtes de sainte Thérèse les 30 septembre et 1er octobre derniers, que nous l’avons rencontré. Ce jour-là, il fêtait également dans la discrétion le 90e anniversaire de sa mère, avec quelques proches, à la veille de se rendre avec eux au Mont-Saint-Michel. Puis il a vite repris le rythme fou qu’impose la responsabilité d’un diocèse qui compte près de 3 millions de fidèles et la présidence de Caritas Internationalis, réseau qui rassemble 165 organisations catholiques sur tous les continents.
Le parcours épiscopal de ce prélat de 60 ans, que certains voient un jour monter sur le trône de Pierre, est fortement marqué par les trois derniers pontificats. Nommé évêque d’Imus par Jean-Paul II alors qu’il n’a que 44 ans, c’est Benoît XVI qui fait de lui en 2011 l’archevêque de Manille, et qui l’élèvera au cardinalat un an plus tard. Il n’a alors que 55 ans. Aujourd’hui, il est l’un des confidents du pape François, qui voit en lui un allié dans le combat pour les plus faibles, les pauvres en premier lieu.
Peu connu chez nous, le cardinal Tagle a accepté de se livrer, aidant aussi à mieux comprendre la figure du pape François. Comme à son habitude, au fil de l’entretien, il est passé du rire aux larmes.
Éminence, parlons d’abord un peu de vous… Comment, alors que vous vouliez être médecin, êtes-vous finalement devenu prêtre ?
Je participais à un groupe de jeunes insérés dans la vie paroissiale, comme une initiation, mais j’avais en tête mes futures études de médecine. Pourtant le témoignage d’un prêtre, l’aumônier de notre groupe, m’a impressionné. Puis le coup final a été porté par un autre prêtre qui m’a dit qu’il existait une très bonne université jésuite, cependant très coûteuse, pour effectuer mes études de médecine et m’a encouragé à passer un examen pour obtenir une bourse d’études. J’ai passé cette épreuve mais il s’agissait en fait, je ne le savais pas, d’un examen d’entrée au séminaire… et j’ai échoué !