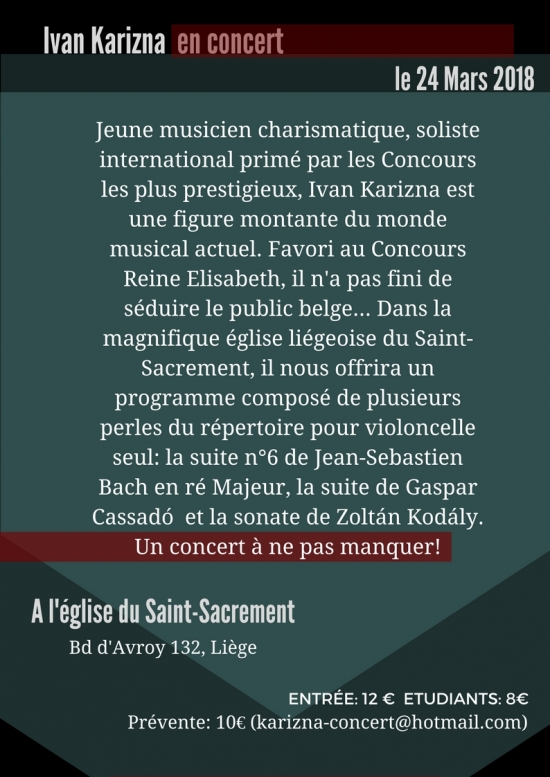De Jeanne Smits sur le site Réinformation-TV :
La majorité des jeunes Européens sont athées, selon le rapport sociologique « Jeunes adultes et religion »
Le christianisme est « moribond » sur les terres de chrétienté de jadis : c’est ce qu’affirme un professeur de théologie et de sociologie de la religion à l’université de St Mary’s à Londres, qui a réalisé une étude d’après les données de l’Enquête sociale européenne 2014-2016. La majorité des jeunes adultes européens de 16 à 29 ans sont désormais athées, constate le rapport sociologique « Jeunes adultes et religion », ce qui annonce la marche rapide vers une société post-chrétienne où l’islam, sur une pente ascendante, gagne presque partout des points dans cette catégorie de la population.
C’est en République tchèque que l’on compte une majorité d’athées parmi les jeunes de 16 à 29 ans : ils sont 91 %, un peu plus qu’en Estonie, en Suède et aux Pays-Bas où ils avoisinent tout de même les 75 % à quelques points près.
En Belgique et en France, tout comme en Hongrie, les jeunes de cette catégorie d’âge qui se disent sans religion sont environ 60 %, un peu plus qu’en Finlande, au Danemark et en Norvège, tandis que l’Espagne, avec quelque 55 % de sans religion, fait partie des 12 pays européens où les sans religion devancent les chrétiens. Mais en Espagne, les chrétiens restent tout de même plus nombreux proportionnellement que les fidèles d’autres religions : en France par exemple, la proportion des « autres religions » représente plus de la moitié de celle des chrétiens.
Le rapport sociologique « Jeunes adultes et religion » estime le christianisme « moribond » en Europe
La Russie compte près de 50 % de jeunes sans religion, devant la Suisse, l’Allemagne, le Portugal, l’Irlande, la Slovénie, l’Autriche, la Lituanie et la Pologne : c’est en Lituanie et en Pologne que la proportion de chrétiens – couplé avec une quasi absence d’« autres religions » – demeure la plus importante, environ 75 % Lituanie et 83 % en Pologne.
La religion britannique établie, l’Eglise d’Angleterre, ne rassemble que 7 % de jeunes adultes qui se définissent comme anglicans – alors que 6 % des jeunes musulmans déclarent adhérer à la religion islamique.
Selon l’auteur de l’étude, Stephen Bullivant, cette tendance vers la disparition de la religion dans les pays européens devrait s’accentuer. « Le christianisme en tant que religion par défaut, en tant que norme, a probablement disparu pour toujours – ou au moins pour les 100 ans à venir », estime-t-il, tout en remarquant que des pays « peuvent être voisins et partager un environnement culturel et une histoire commune tout en affichant des profils religieux complètement divergents ».
La majorité des jeunes Européens ne prie jamais, ou quasi
De fait, les « profils », de jeunes croyants ou pas du tout, sont bien répartis entre les pays de l’ancienne sphère soviétique et les pays libéraux de l’Ouest, avec la République tchèque en tête des athées et la Pologne en queue, avec un rapport inversement proportionnel, grosso modo, entre « sans religion » et chrétiens affirmés. Voisins, l’Allemagne et les Pays-Bas affichent respectivement 45 et 70 % de non-croyants parmi leurs jeunes. C’est dire si les différences nationales, de langue, d’éducation, d’histoire sont bien réelles, quoi qu’on raconte à propos de l’espace européen unique…
Le même rapport « Jeunes adultes et religions » présente la photographie des 16-29 ans quant à leur pratique religieuse. Elle est désastreuse un peu partout en ce sens que la pratique régulière, hebdomadaire, plafonne à peu près partout à moins de 10 %, à l’exception de l’Irlande (environ 20 %), du Portugal (environ 15 %) et de la Pologne (plus de 40 %). Une certaine pratique régulière mais à un rythme moins fréquent concerne de plus nombreux pays ; mais en France plus de 55 % des jeunes ne mettent jamais le pied à l’église (ou au temple, ou à la mosquée, cela n’est pas précisé).
On retrouve des pourcentages importants de jeunes Européens qui ne prient absolument jamais : de 80 % en République tchèque après de 70 % en France ou en Espagne… Polonais et Irlandais sont ceux qui prient le plus souvent : c’est le cas pour un jeune adulte polonais sur deux qui prie une fois par semaine ou davantage, mais c’est là le pourcentage le plus élevé.
Ce rapport sociologique constate la meilleure transmission de l’islam
Comme l’affirme Bullivant, de nombreux jeunes Européens « ont été baptisés mais ne passeront plus le seuil d’une église ».« Les identités culturelles religieuses ne passent tout simplement plus des parents aux enfants. Elles glissent sur eux comme sur la peau d’un canard », observe l’auteur.
Si l’immigration amène aussi des chrétiens – c’est le cas au Royaume-Uni où un catholique sur cinq est né ailleurs – la proportion de musulmans lui paraît importante à considérer. « Nous savons que le taux de naissance des musulmans est plus élevé que celui de la population en général, et qu’ils ont des taux de rétention [religieuse] beaucoup plus élevés », observe-t-il. Il suffit de tirer les conclusions…
Mais globalement, la nouvelle « valeur par défaut », c’est l’absence de religion : « Les rares personnes croyantes se considèrent comme nageant à contre courant », observe-t-il encore : « D’ici à 20 ou 30 ans, les principales Eglises seront plus petites, mais le peu de gens qui y resteront seront fortement engagés. »
A quoi l’on peut ajouter cette question : comment l’Europe, forgée par le christianisme, pourra-t-elle subsister si elle est à ce point coupée de ses racines vivifiantes ? On peut se lamenter face à la montée de l’islam, mais cela ne sert à rien si c’est seulement pour lui opposer du vide.