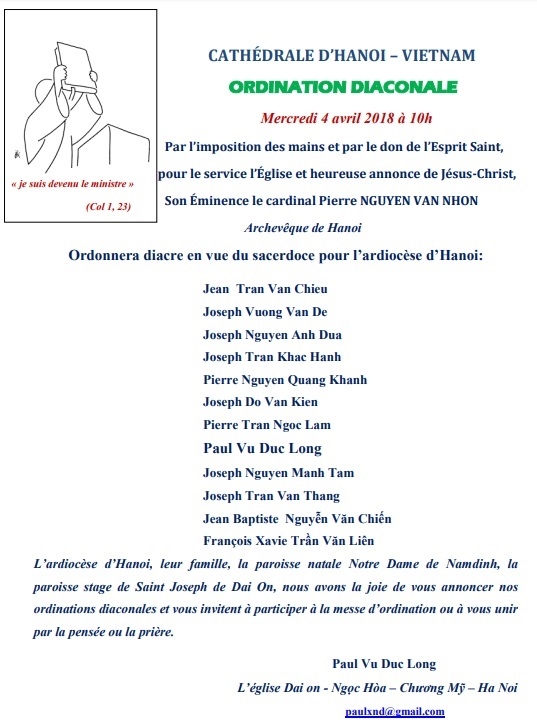
Jeunes - Page 92
-
Vietnam : le communisme a eu beau faire, il n'a pas tari les vocations
-
Belgique : une "légère diminution de fidèles"
Lu sur la Dernière Heure (via le Service presse interdiocesain):
12 églises ont fermé en Belgique en 2017
De nos jours, l’Église attire moins la population en Belgique. Le fait semble établi, même si nous ne l’avons pas spécialement observé hier en l’église Saint-Sébastien de Loyers où, durant la messe du dimanche matin, nous avons pu constater la présence d’une quarantaine de fidèles venus célébrer le troisième dimanche du Carême. Tommy Scholtès, porte-parole de l’Église catholique belge : “Certes, nous constatons une légère diminution de fidèles, mais pas plus. Seulement douze églises ont été désacralisées sur le territoire belge en 2017 pour devenir majoritairement des bibliothèques ou des extensions d’écoles.” Il affirme également que les jeunes ressentent le besoin de se rendre à l’église pour trouver leur foi. “Plusieurs rassemblements sont organisés chaque semaine. Dernièrement, des centaines de jeunes Belges francophones sont allés à l’organisation mondiale de la jeunesse. Ou alors, à l’église Sainte-Croix, se déroule la marche des rameaux, une célébration dynamique où les jeunes ont besoin de se retrouver.” / Article complet
Pourtant, rien que dans la commune de Seraing, cinq églises sur 15 seraient menacées :
Seraing: faire des églises "des maisons du peuple"? (du site de la RTBF)
Faire de l'église Saint Lambert de Jemeppe, une bibliothèque... C'est le souhait du bourgmestre de Seraing. Alain Mathot négocie avec l'Evêché, la réaffectation partielle d'un tiers des 15 églises de la commune dont certaines sont souvent vides. On sait que le bourgmestre socialiste s'oppose depuis des années à l'Evêché à propos de l'entretien des établissements de culte. C'est une obligation légale mais qui, selon lui, coûte trop cher aux finances de la ville. Depuis 2013, il bloque tout financement d'entretien. Et veut négocier un accord global avec l'Evêché et les fabriques d'église. Visiblement, le dossier avance puisque le conseil communal a finalement voté une intervention de 210 000 euros pour réparer la toiture de l'église Saint Lambert. Un geste d'apaisement."Si pas désacraliser, amener au moins une autre activité"
Le bourgmestre Alain Mathot voudrait d'abord "si pas désacraliser, au moins amener une autre activité que l"activité religieuse dans 5 églises de la commune." Par exemple, faire une bibliothèque dans l'église Saint Lambert à Jemeppe. Autre volonté du bourgmestre: "c'est d'avoir un état des lieux de l'ensemble des églises restantes, de partir sur une rénovation, une remise à niveau de l'ensemble de ces établissements et de ces églises et puis alors de négocier une somme annuelle -qui pourrait évidemment être indexée- qui serait versée aux fabriques d'église ou à l'Evêché et qui leur servirait pour entretenir leurs établissements. Nous ne serions plus responsables de l'entretien des églises.""Faire des églises, des maisons du peuple"
"On va faire des églises, des maisons du peuple" lance en boutade Eric de Beukelaer. Accueil de mouvements associatifs, cours de yoga ou réunions de pensionnés... Le vicaire épiscopal n'est pas opposé à l'idée d'étendre les activités des églises: "Elles n'appartiennent pas qu'aux gens qui vont à la messe, elles appartiennent à tous les citoyens. Le tout, c'est que les lieux soient vivants! Comment faire en sorte que dans certaines églises comme Jemeppe par exemple -mais il y en a d'autres qui sont de grandes églises qui nécessitent de grandes réfections qui coûtent quand même relativement cher- comment faire en sorte donc qu'une partie de l'église reste affectée au culte -voire toute l'église- mais qu'en même temps, d'autres utilisations soient possibles. C'est vraiment ça l'idée."Voici la liste 5 églises concernées par une réaffectation :
- Lize – Notre Dame ( située au Pairay, propriété de la Ville)
- Jemeppe Saint-Lambert (propriété Ville)
- Saint Joseph (Place Merlot, propriété Ville)
- Notre Dame de l’Assomption (propriété Ville)
- Val Saint Lambert (propriété fabrique)
10 autres églises maintiennent le culte :
- Boncelles Notre Dame
- Saint Léonard (Chaqueue, propriété fabrique)
- Christ-Ouvrier (propriété fabrique)
- ONR Vierge des Pauvres (fabrique)
- Saint-Eloi (fabrique)
- Saint Antoine (Renory, propriété ASBL décanale)
- Saint-Martin (Ougrée, propriété fabrique)
- Sainte Thérèse (Ougrée, propriété fabrique)
- Notre Dame de Lourges (propriété ASBL décanale)
- Saint Joseph du Ruy (propriété Fabrique)
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Jeunes, Patrimoine religieux, Société 0 commentaire -
France : les écoles des Dominicaines du Saint-Esprit
Lu dans le n° 300 mars 2018 du mensuel « La Nef » :
 « Les Dominicaines du Saint-Esprit ont cinq établissements scolaires en France. Elles ont un ambitieux projet à Nantes qui nous a fourni l’occasion de les rencontrer. La Prieure générale, Mère Marie Pia, nous en parle et évoque sa Congrégation ainsi que sa vision de l’enseignement aujourd’hui.
« Les Dominicaines du Saint-Esprit ont cinq établissements scolaires en France. Elles ont un ambitieux projet à Nantes qui nous a fourni l’occasion de les rencontrer. La Prieure générale, Mère Marie Pia, nous en parle et évoque sa Congrégation ainsi que sa vision de l’enseignement aujourd’hui.La Nef – Commençons par un petit retour en arrière : pourriez-vous nous dire ce que sont les Dominicaines du Saint-Esprit ?
Mère Marie Pia – Dominicaines du Saint-Esprit, nous avons une histoire récente et originale, puisque nées au sein du Tiers-Ordre de saint Dominique, nous sommes actuellement Société de vie apostolique tout en reprenant le mode antique de vie dominicaine de sainte Catherine de Sienne. Notre Institut vit le jour grâce à l’abbé V.A. Berto (+ 17 décembre 1968), prêtre du diocèse de Vannes, lui-même tertiaire dominicain, zélé serviteur de l’Église (1).
Le vocable du Saint-Esprit a été choisi pour honorer la Troisième Personne divine que Jésus appelle l’Esprit de Vérité. Toute l’œuvre des Dominicaines du Saint-Esprit est confiée à la protection de Notre-Dame de Joie.
L’Institut vit ses débuts en 1936, à La Bousselaie, dans le Morbihan, où quelques jeunes filles s’occupaient d’un groupe d’enfants orphelins confiés à l’abbé Berto. En 1939, à Fescal, elles se regroupèrent autour d’une petite règle de vie dans le projet d’une consécration virginale. Elles furent reconnues en 1943 par Mgr Tréhiou, évêque de Vannes, et érigées en Fraternité séculière du Tiers-Ordre de saint Dominique par le R.P. provincial de Lyon. Puis un décret du 19 novembre 1964 érigeait celle-ci en « Sodalité propre à l’Ordre de Saint-Dominique ». Enfin, le 22 février 1990, le Saint-Siège conférait à l’Institut sa forme canonique actuelle de Société de vie apostolique de droit pontifical et, le 24 mai suivant, le Père Maître Général confirmait son agrégation à l’Ordre. Aujourd’hui, l’Institut compte une centaine de sœurs réparties entre la Maison-mère, à Pontcalec, et cinq écoles en France.
Comment caractériseriez-vous le charisme spécifique de votre Congrégation ?
Dans la grande famille dominicaine, le charisme propre de notre Institut, sa « raison d’être intime, est d’honorer le mystère de l’Église en tant qu’elle est l’Épouse du Christ » (Constitutions de l’Institut). Les sœurs mènent la vie commune selon les conseils évangéliques, professés sous la forme du vœu unique de virginité et des promesses d’obéissance et de pauvreté.
Notre vie est celle de vierges consacrées apostoliques. Dans nos maisons comme dans nos écoles, la vie commune, la vie liturgique et l’étude assidue de la vérité, composantes essentielles de la vie dominicaine, sont la source et le moyen de notre sanctification et de notre apostolat : une vie contemplative à titre principal et active à titre secondaire. La docile fidélité à l’Église romaine appartient à la substance même de notre Institut, de cette romanité que l’abbé Berto a puisée dans la Ville éternelle dès l’époque de son séminaire, à l’humble imitation de ce que fut notre sœur, sainte Catherine de Sienne. La vie commune dominicaine est bâtie sur deux éléments : habiter sous un même toit et viser à l’unanimité, selon l’idéal de la première communauté chrétienne, qui ne faisait « qu’un seul cœur et qu’une seule âme ».
Nous attachons une grande importance à la dignité, la piété et la beauté de l’office liturgique au chœur, célébré en latin selon le rite romain, dans sa forme extraordinaire.
L’étude, recherche joyeuse de la vérité, participe de la vie contemplative. Elle est pour nous un devoir d’état quotidien et la source de notre apostolat. Elle porte sur l’Écriture Sainte, le Magistère de l’Église, l’œuvre de saint Thomas d’Aquin, les écrits des Pères de l’Église, l’histoire de l’Église et celle de l’Ordre, et le chant grégorien.Cet aspect contemplatif est inséparablement lié à l’apostolat qui en découle. Formées à la vie apostolique, nous exerçons notre activité au service de la transmission de la vérité, à travers les œuvres de miséricorde spirituelle : éducation et enseignement, développement de la piété liturgique, conférences, etc. La finalité de l’éducation que nous dispensons est de transmettre la foi, de structurer les intelligences et d’épanouir les personnalités en les éduquant à l’exercice de la liberté et de la responsabilité. C’est pourquoi notre apostolat s’est développé principalement à travers nos écoles (cf. la liste ci-dessous).
Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Jeunes, Société, Spiritualité 0 commentaire -
Synode des jeunes : quand l’idéologie remplace la foi
Un « Synode des jeunes » a été souhaité par le pape François. A quoi servira-t-il ? interroge le site « Pro Liturgia » qui répond : à publier des tas de documents qui finiront, comme tant d’autres, dans l’oubli. La désignation d’un membre du MRJC pour faire partie de la délégation française participant à la fabrication de cette usine à gaz réveille les querelles intestines. Lu dans le mensuel « La Nef » relayé par « Riposte catholique » :
« Dans le mensuel La Nef, du mois de mars, Jacques de Guillebon revient sur le scandale du MRJC :
La petite polémique intra-catholique née au mois de janvier autour du MRJC (Mouvement rural des jeunesses chrétiennes) dans le sillage de la Marche pour la vie n’est pas inintéressante pour ce qu’elle révèle d’incompréhensions et d’idéologisation parmi les fidèles de France. Pour qui n’aurait pas suivi l’histoire, le mouvement héritier de la JOC avait publié le 20 janvier un communiqué dénonçant le message « de haine et d’intolérance » véhiculé selon lui par la Marche pour la vie, et affirmant par ailleurs qu’il défendait « le droit fondamental pour les femmes et les couples d’avoir recours à l’IVG ». Une position évidemment en flagrante contradiction avec l’enseignement universel et constant de l’Église catholique à qui le MRJC doit pourtant sa reconnaissance canonique en France.
Nous n’avons pas l’intention ici de nous attaquer aux adhérents de base du mouvement rural, qui accomplissent généralement un travail de terrain, dans ces lieux ô combien désertés que sont les campagnes françaises et plus généralement la France périphérique que peu d’autres réalisent. Mais il est évident, et ce n’est pas neuf, cela date même des années 60, qu’il y a parmi l’encadrement du MRJC une tendance au compagnonnage avec des groupuscules d’extrême gauche qui le poussent à oublier, voire à renier ses origines. On notera en passant que l’ancien premier ministre de sinistre mémoire, ou de bienheureux oubli, Jean-Marc Ayrault, est sorti de ses rangs.
RÉACTIONS DE L’ÉPISCOPAT
Sans remonter aux années 80, il n’est que de voir les récents colloques organisés par le MRJC où se côtoient des Rockhaya Diallo et des militantes d’Osez le féminisme pour prendre le pouls de la superstructure du mouvement. Il n’était donc pas étonnant qu’il finisse par exprimer frontalement des positions opposées à celles de l’Église en matière d’éthique. Les réactions des évêques ont, une fois n’est pas coutume, été vives en la matière : on a entendu la déclaration de Mgr Ginoux, évêque de Montauban, menaçant de couper les vivres à une association qui doit quelques fonds à l’Église de France. Il semble qu’il ait été soutenu par le reste de l’épiscopat, la CEF produisant finalement un communiqué commun avec le MRJC où celui-ci battait sa coulpe et reconnaissait qu’il fallait aider les femmes à ne pas recourir à l’avortement, en ces termes : « en tant que mouvement d’Église il reconnaît que tout doit être mis en œuvre pour éduquer et prévenir les situations d’avortement. »
À l’inverse, on a entendu quelques voix discordantes, comme celle de Mgr Wintzer, plaidant pour une certaine liberté de ton. Liberté de ton des fidèles, on veut bien, et on s’en prive assez peu en général. Mais il nous semblait qu’il existait quelques matières fondamentales en lesquelles la conscience devait plier devant la parole de l’Église. Tout ce qui touche aux mœurs, et particulièrement à la vie, n’est jamais négociable.
ÉCOLOGIE HUMAINE
Encore une fois, nous n’avons pas l’intention de dénoncer qui que ce soit ni d’ajouter de la division à un catholicisme français particulièrement englué dans ses querelles gauloises de chapelle. Et nous ne doutons pas de la bonne foi de ces militants confrontés, comme tout un chacun aujourd’hui, à des situations de détresse de futures mères. Seulement la bonne foi ne suffit pas toujours. Et si la théologie chrétienne reconnaît une place éminente à la voix de la conscience, elle insiste aussi particulièrement sur la nécessité de former celle-ci et de l’éclairer. L’éclairer ne veut pas dire la reformater. Mais, au-delà de la difficulté d’accueillir un enfant, il est pour le moins évident que des fidèles de celui qui est le maître de la vie, et qui a donné sa propre vie pour cela, ne peuvent en aucun cas envisager d’en supprimer une, surtout quand il s’agit du plus faible.
L’idée d’écologie intégrale s’est répandue, à juste titre, parmi les catholiques ces dernières années. Au-delà de l’attention à la nature comme création divine qu’elle réclame, il ne faudrait pas oublier l’éminente dignité de l’être humain, formé à la ressemblance et à l’image de Dieu, contre qui nul ne peut lever la main. Et si nos frères « de gauche » ont raison de nous appeler à ne pas nous caricaturer, qui dans sa bourgeoisie libérale, qui dans sa méfiance vis-à-vis des « migrants », nous avons aussi le devoir de leur rappeler que la volonté émancipatrice de l’époque tourne parfois, et souvent, à une folie anti-humaine qui soumet l’existence de l’autre à son propre désir, tout à l’opposé du message sacrificiel du Christ.
Ref. L’affaire du MRJC révèle l’idéologisation des fidèles de France
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Jeunes, Société 3 commentaires -
José Sanchez del Rio sera le saint patron des JMJ de Panama en 2019
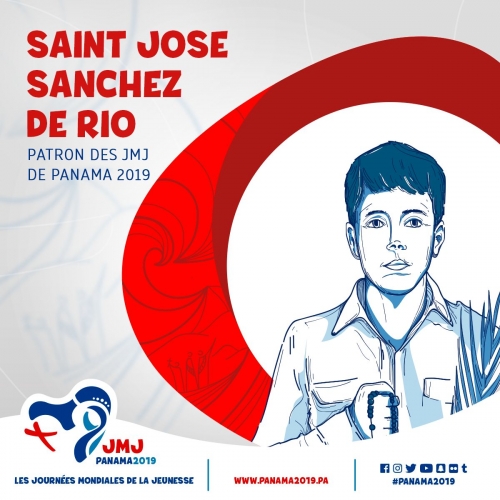 Du site de l'Eglise catholique de France :
Du site de l'Eglise catholique de France :José Sanchez del Rio, « Joselito », meurt martyr à 15 ans lors de la guerre des Cristeros au Mexique. A cette époque, beaucoup de chrétiens se sont soulevés et ont lutté contre la législation anti-chrétienne promulguée en 1926 interdisant le culte public et ordonnant la fermeture des églises.
Sa vie
Né dans la région de Michoacan, l’une des plus religieuses du Mexique, Joselito a 13 ans quand éclate la guerre civile des Cristeros. Il demande la permission à ses parents de se joindre à l’armée des Cristeros. En raison de son jeune âge, sa mère et le général cristero Gorostieta refusent. A force d’insistance, le général l’admet comme porte-étendard de la Vierge de Guadalupe et non comme soldat armé. Il prie le rosaire durant la nuit avec les membres de l’armée improvisée et les encourage à défendre leur foi.
Lors d’un affrontement entre les troupes du gouvernement et les cristeros, le 25 janvier 1928, le cheval du général est tué. Sans hésiter, pour qu’il ne soit pas fait prisonnier, Joselito lui donne le sien : « Mon général, prenez mon cheval et sauvez-vous : vous êtes plus nécessaire et manqueriez plus à la cause que moi ». Le 6 février, Joselito est fait prisonnier. Il est emmené devant le général ennemi. Ce dernier lui reproche de combattre contre le gouvernement. En voyant sa détermination et son courage, pour éviter les problèmes, le général lui propose de rejoindre le camp du gouvernement mexicain. José refuse : « Jamais, jamais ! Plutôt mourir ! Je ne vais pas faire union avec les ennemis du Christ Roi ! Fusillez-moi ! »
Joselito est emprisonné dans l’église de Saint-Jacques de Sahuayo où il a reçu le baptêmeenfant et qui, depuis la guerre, a été transformée en caserne et prison. Il y prie tous les jours le chapelet. Il demande de l’encre et du papier pour écrire à sa mère. Il lui dit : « Ma chère maman, j’ai été fait prisonnier au combat aujourd’hui. Je crois que je vais mourir ici et maintenant, mais peu importe, maman. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Ne te préoccupe pas de ma mort. Avant tout, dis à mes frères de suivre l’exemple que je leur donne. Tu feras alors la volonté de Dieu, sois courageuse et donne-moi ta bénédiction avec celle de mon père. Salue tout le monde de ma part une dernière fois. Tu recevras le cœur de ton fils qui t’aime tant et qui désirais te voir avant sa mort. José Sanchez del Rio ».
Quatre jours plus tard, dans la nuit du 10 février 1928, il est torturé et exécuté. Deux témoins de son martyre ont raconté que les soldats lui ont arraché la peau de la plante des pieds avec un couteau. Ensuite, ils l’ont fait marcher jusqu’au cimetière pendant qu’ils le frappaient. Ils ont voulu l’obliger à apostasier sa foi par la torture, mais ils n’y sont pas arrivés. Seules ses lèvres remuaient pour crier : « Vive le Christ Roi et Sainte Marie de Guadalupe ! ». Au cimetière, il est tué par balles. Sans recevoir de cercueil ni de linceul, des pelletées de terre recouvrent son corps qui reste sans sépulture.
Il repose aujourd’hui dans l’église du Sacré-Cœur de Jésus à Shuayo, son village natal.
Le 20 novembre 2005, José Luis est béatifié. Il est canonisé le 16 octobre 2016 par le pape François.
Spiritualité
Sa foi
Dès son enfance, José Luis vit de sa foi chrétienne. Il participe à la vie de l’Eglise. Il veut donner sa vie à Dieu. Il se donne un objectif : arriver au ciel. « Maman, il n’a jamais été aussi facile de gagner le ciel qu’aujourd’hui, et je ne veux pas perdre cette opportunité », a-t-il répondu à sa mère face au danger lié à la défense de la foi dans la situation que connait le Mexique à l’époque. Le Christ Roi et la Vierge de Guadalupe sont au centre de sa foi qu’il alimente par les sacrements, le chapelet, l’oraison et la catéchèse.Force et courage
Les martyrs sont témoins de la foi. Ils sont capables de donner leur vie pour le Christ et supportent la torture et la souffrance avec Lui. La grâce de Dieu et la puissance de l’Esprit Saint se manifestent dans la faiblesse humaine. La force et le courage du jeune Joselito sont un motif d’admiration et d’imitation du Seigneur. Il est un exemple pour les jeunes d’aujourd’hui. Comme les premiers chrétiens, José n’a pas hésité pas à donner à sa vie pour ne pas renier sa foi. Devant la tombe de l’avocat Anacleto Gonzalez Flores, mort martyr le 1er avril 1927, le garçon demanda à Dieu de pouvoir mourir comme lui en défendant la foi catholique.Générosité
« Il n’y a pas d’amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu’on aime» (Jean 15,13). La parole du Seigneur continue de s’accomplir pour ceux qui offrent leur vie avec une générosité totale au service du Seigneur, de son Evangile et de leurs frères.De bien des manières, à travers des gestes de générosité et de sacrifice, mais en particulier à travers le martyre. Joselito a cédé généreusement son cheval au Général cristero en danger. Il a également donné sa vie pour le Christ par le martyre.
Joselito, un témoin pour la jeunesse :
– Donne sa vie pour le Christ
– Fidèle à l’Église et à son message
– Sens du sacrifice
– Dévotion à la Vierge MariePour aller plus loin :
– Cristeros, film de Dean Wright avec Andy Garcia et Eva Longoria -
L’enseignement chronologique de l’histoire est indispensable
De Bosco d'Otreppe sur le site de la Libre :
"L’enseignement chronologique de l’histoire est indispensable" (FRANC-TIREUR)
Il faudra cependant attendre la fin de l’année 2018, et la rédaction des référentiels qui fixent ce qui sera enseigné dans chaque cours, pour savoir avec précision comment la discipline historique sera envisagée dans nos classes.
Notons du coup que Louis Manaranche, s’il argumente ici sa vision de ce que doit être un cours d’histoire, ne réagit en rien à ce qui est prévu par le Pacte.
"Je crois que l’histoire, avec sa dimension chronologique et progressive, permet d’arrêter sa pensée"
Tout est lié : la manière dont on donne un cours témoigne de la manière dont on le pense et dont on pense ses missions. Pour le cours d’histoire, vous refusez qu’il soit enseigné à travers une approche thématique ("Manger au Moyen Âge", "Être une femme à l’époque des Lumières"…). Vous privilégiez plutôt une approche chronologique. Qu’est-ce que cela veut dire sur la manière dont vous pensez l’enseignement de l’histoire ?
Enseigner l’histoire à travers une approche chronologique impose une certaine humilité, tant cette approche se projette sur un temps assez long. Un tel enseignement considère qu’il faut d’abord passer par la transmission de l’élémentaire, qu’il est indispensable d’offrir aux élèves de saisir les grands jalons de l’histoire, de les ruminer, de les intérioriser, avant de pouvoir passer à l’étude de grandes thématiques. C’est une conception de l’enseignement qui estime que l’assimilation patiente des fondamentaux constitue un socle indispensable au déploiement de la pensée. Aller trop vite vers un enseignement thématique me semble inciter à privilégier une école du zapping, où je donne des informations pêle-mêle que l’élève aura à sa propre charge de remettre en ordre.
L’approche thématique, "qui n’est pas sans intérêt dans la sphère universitaire", dites-vous, est donc risquée quand elle est enseignée trop tôt ?
L’approche thématique de l’histoire peut être intéressante, je ne souhaite pas la jeter aux orties en tant que telle. Mais pour qu’un élève puisse se plonger dans une approche thématique et dans la réflexion qu’elle implique, il faut qu’il ait déjà une grande maturité. Or cette maturité repose sur l’acquisition de savoirs, et sur une histoire comprise dans sa dimension chronologique. Dans les classes, je pense donc que l’approche thématique est intéressante pour susciter l’intérêt, pour faire le lien entre tel aspect de la vie quotidienne, et tel point historique par exemple. Mais une fois passée cette première étape, il est crucial de proposer une réflexion du temps et sur le temps. Aider l’élève à comprendre la dimension chronologique de l’histoire est indispensable.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Enseignement - Education, Histoire, Jeunes, Société 2 commentaires -
Pour que s'épanouisse la foi du tout-petit
POUR QUE S’ÉPANOUISSE LA FOI DU TOUT-PETIT (ouvrage conseillé)
Ce livre de Monique BERGER, écrit surtout à l’attention des parents de jeunes enfants, met l’accent sur la formation spirituelle des tout-petits et la manière de les introduire dans la vue spirituelle.
Il s’appuie sur la grande facilité que les enfants ont, dans les toutes premières années, à « capter le divin ».
20 ans après la parution de « Sur les genoux des mamans », elle a estimé qu’il était indispensable de publier un livre plus complet.
Il contient maintenant une catéchèse pour la petite enfance.
Ainsi les les parents seront guidés pour des entretiens d’âme à âme sur 15 thèmes majeurs …
Monique BERGERPOUR QUE S’ÉPANOUISSE LA FOI DU TOUT-PETIT…
Que faire ?
Que lui dire ?Format 15 x 21 – 166 pages – 19 €
Éditions Sainte-Madeleine 84330 LE BARROUX – 2018
À commander à votre libraire ou en ligne chez l’éditeur.
Sommaire
Préface de Monseigneur Xavier MALLE
PREMIÈRE PARTIE
L’éducation spirituelle commence avec la vieLa petite enfance, âge d’or de la vie spirituelle
La formation religieuse commence par la prière
Le rôle des parents – Importance de l’exemple
Le sens de ma présence de Dieu
Les petits et le sens du sacré
Les petits et le sens du mystère
le silence
La prière des psaumesDEUXIÈME PARTIE
Étapes de la vie spirituelle chez le tout-petit avant 7 ansNotamment : particularités psychologiques ou physiques de l’enfant avant 7 ans
TROISIÈME PARTIE
Une catéchèse pour la petite enfanceLa petite enfance, âge d’or de la vie spirituelle
Quelques recommandations pédagogiques
de la création à la louange de Dieu
Les anges
Le démon
Le péché originel
Premier enseignement sur le mystère
Le mystère de l’Incarnation
Le mystère de la Rédemption
Parler de la Croix aux enfants
La Résurrection et le mystère pascal
L’Ascension
Comment parler du Saint-Esprit aux 4-7 ans
La Pentecôte
La Sainte Trinité
Premier enseignement sur le sacrifice
Faut-il parler de la mort aux enfants ?Confirmation des neurosciences sur l’importance des premières années
ConclusionLien permanent Catégories : Eglise, Enseignement - Education, Foi, Jeunes, Livres - Publications 0 commentaire -
Québec : une Église en crise depuis les années 1960
Un effet de la « révolution tranquille » (un prodrome québécois de mai 68) ou de Vatican II ? C’est un peu l’histoire de la poule et de l’œuf. En quelques années, les catholiques du Québec ont vu leur Église vaciller et la société se séculariser à une vitesse accélérée. D’Yves Chiron sur le site du mensuel « La Nef » ( n° 297):
"Jusqu’au début des années 1960, 88 % de la population du Québec était catholique et l’Église était impliquée dans toutes les œuvres sociales, dans le système hospitalier comme dans l’éducation. La quasi-totalité des « collèges classiques » (l’équivalent de nos lycées) et toutes les universités francophones étaient rattachées à l’Église. Les mouvements, organisations et œuvres liés à chaque paroisse couvraient tous les aspects de la vie religieuse mais aussi de la vie sociale (loisirs, services sociaux, syndicalisme, mouvements coopératifs, culture). À la fin des années 1950, un catholique sur cinq était actif dans un de ces secteurs de la vie paroissiale.
En 1960, par la victoire électorale du Parti libéral québécois et l’arrivée au pouvoir de Jean Lesage s’engage une « Révolution tranquille » qui veut mettre fin à la « Grande Noirceur », terme polémique pour désigner les gouvernements de l’Union nationale qui avaient dirigé le Québec depuis 1944 et la politique conservatrice qui avait été menée avec l’appui de l’Église.
La Révolution tranquille aboutira en quelques années à la création d’un système d’hôpitaux publics, d’un Ministère de l’Éducation et d’un Ministère des affaires sociales, à l’abaissement du droit de vote de 21 à 18 ans, à l’adoption d’un statut légal de la femme mariée, à la mise en vente de la pilule contraceptive dès 1961.
Ces évolutions, peu « tranquilles » en fait, se sont accompagnées d’une transformation du catholicisme québécois, ce qu’on a appelé la « décléricalisation » de la société québécoise. L’Église a perdu le contrôle du système d’éducation, du système hospitalier et du système des aides sociales. Les syndicats se sont déconfessionnalisés. La pratique religieuse a très fortement baissé, passant, entre 1961 et 1971, de 61 à 30 % dans le diocèse très urbanisé de Montréal, et de 90 à 37/45 % dans les petites villes du Québec et des campagnes. Les vocations religieuses et sacerdotales se sont effondrées : quelque 2000 entrées au couvent ou au séminaire en 1946, un peu plus d’une centaine en 1970. Le nombre des ordinations sacerdotales a baissé de plus de 57 % entre 1960 et 1969. Des milliers de prêtres, de religieux et de religieuses sont retournés à la vie laïque.
Certains analystes et commentateurs ont expliqué, a posteriori, cet effondrement comme une conséquence de la Révolution tranquille qui a fait perdre à l’Église son pouvoir institutionnel et qui a laïcisé la société. D’autres explications ont mis en lien la crise du catholicisme québécois avec le concile Vatican II qui se déroulait au même moment (1962-1965).
Lien permanent Catégories : Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Foi, Idées, International, Jeunes, Sexualité, Société 0 commentaire -
RDC : un pays où les ordinations sacerdotales ne manquent pas
Pour un peu changer de la morosité des statistiques belges, quelques images d’une chrétienté vivante : ici à Muanda (au diocèse de Boma) dans le Bas-Congo, on fête les ordinations (avec la présence du gouverneur en prime).
L’Afrique est certainement loin d’être parfaite et on a même dit qu’elle était « mal partie ». Mais il y a une chose que l’Europe peut à coup sûr lui envier : pour les fils de ce continent aujourd’hui « il fait Dieu » de la même façon que l’on constate qu’ « il fait soleil » un beau jour sans pluie: c’est une évidence qui rayonne sur leur foi et l’éloge qu’en fit Benoît XVI lors de sa visite au Bénin en 2011 n'est pas surfait : « L’Afrique représente un immense 'poumon' spirituel pour une humanité qui semble en crise de foi et d’espérance. Cette fraîcheur du oui à la vie qu’il y a en Afrique, cette jeunesse qui existe, qui est pleine d’enthousiasme et d’espérance, et aussi d’humour et de joie, nous montre qu’ici il y a une réserve humaine, il y a encore une fraîcheur du sens religieux et de l’espérance. Je dirais donc qu’un humanisme frais qui se trouve dans l’âme jeune de l’Afrique, malgré tous les problèmes qui existent et qui existeront, montre qu’ici il y a encore une réserve de vie et de vitalité pour l’avenir, sur laquelle nous pouvons compter ».
D’une certaine façon, cette joie spontanée pourrait s'apparenter à celle des premiers chrétiens lorsque le message évangélique les libéra du destin aveugle que les croyances antiques ont fait peser sur les hommes et les dieux. C’est une chose que les vieilles chrétientés bimillénaires ne mesurent pas à sa juste valeur. JPSC
-
Le pape souhaite que le prochain Synode consacré aux jeunes permette un réveil des vocations sacerdotales et religieuses
SALUT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION « PRO PETRI SEDE »
Salle Clémentine - Vendredi 16 février 2018 (source)
Chers amis,
C’est avec joie que je vous accueille aujourd’hui, membres de l’Association Pro Petri Sede, alors que vous êtes venus en pèlerinage au tombeau de l’apôtre Pierre pour raffermir votre foi et vous renouveler dans votre mission de charité envers le prochain.
Votre visite se situe au début du Carême, temps propice pour se recentrer sur le cœur de la foi catholique et sur la mission de l’Eglise, à laquelle chaque baptisé doit prendre part. Devant le constat d’un monde en proie à l’indifférence, à la violence, à l’égoïsme, au pessimisme, il est utile de se demander aujourd’hui s’il ne souffre pas d’un déficit de charité, que ce soit dans les cœurs comme dans les relations avec Dieu et avec les autres. C’est la question que j’ai posée dans le Message pour le Carême 2018: La charité s’est-elle éteinte dans nos cœurs ? ». Il vaut la peine de regarder la vérité en face ! Et d’utiliser des remèdes donnés par Dieu lui-même dans l’Eglise. La prière nous remet sur le chemin de la vérité sur nous-mêmes et sur Dieu ; le jeûne nous fait communier à la situation de tant de personnes confrontées aux affres de la faim et nous rend plus attentifs au prochain ; L’aumôneest une occasion bénie pour œuvrer avec la Providence de Dieu pour le bien de ses enfants. Aussi je vous invite à faire de l’aumône, un style de vie, et à persévérer dans l’aide concrète à ceux qui sont dans le besoin. Votre engagement vous demande d’être toujours attentifs à apporter, en plus de l’aide matérielle, la chaleur de se sentir accueilli, la délicatesse du respect et la fraternité sans lesquelles personne ne peut reprendre courage et espérer à nouveau en l’avenir.
Je vous renouvelle mon appréciation et mes encouragements pour votre mission, vous invitant à la porter chaque jour dans la prière, personnelle et commune, à l’intention des personnes que vous soutenez. Les confier au Seigneur fait aussi partie de votre mission, et vous construisez ainsi la communion ecclésiale, car nous sommes tous enfants d’un même Père. Par l’offrande généreuse que vous apportez au Successeur de Pierre, vous contribuez à la mission de l’Eglise de soutenir toutes personnes, particulièrement les plus pauvres et celles qui ont tout perdu en raison des migrations forcées. Je vous remercie donc chaleureusement en leur nom pour votre aide et votre proximité spirituelle.
Chers amis, demandons au Seigneur de convertir notre cœur afin que grandisse la charité sur notre terre et qu’enfin cessent les conflits, causes de maux innombrables. Puisse ce pèlerinage faire grandir en vous la charité ainsi que le désir de confesser chaque jour votre foi et d’en témoigner là où vous vivez ! Je vous invite aussi à prier pour les jeunes afin que le prochain Synode qui leur est consacré permette en particulier un réveil des vocations sacerdotales et religieuses dans vos pays.
Confiant chacun de vous et vos familles, ainsi que les membres de votre association à l’intercession de la Vierge Marie, à saint Pierre et aux saints de vos pays, je vous accorde de grand cœur la Bénédiction apostolique. Et je vous le demande, n’oubliez pas de prier pour moi.
Ce réveil des vocations sacerdotales serait particulièrement souhaitable dans le BENELUX : "Pays d’origine de l’association, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg souffrent d’une pénurie de vocations. En 1960, la Belgique comptait un peu plus de 10’000 prêtres. Ils ne sont plus que quelque 3’000 en 2015. Par ailleurs, parmi la centaine de séminaristes qui étudiaient il y a trois ans dans le royaume, plus de quarante étaient étrangers." (source)
-
A Esneux, la citoyenneté remplace la religion
C’est la lutte finale…
Ce 14 février, mercredi des Cendres, l’hebdomadaire Vlan (édition Ourthe-Amblève) se fend en première page d’un énorme titre : « A l’athénée d’Esneux, la citoyenneté a remplacé la religion ». La suite du texte nous apprendra qu’elle a également remplacé le cours de morale…
« Si, dans nombre d’établissements scolaires, le cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) a quelque difficulté à trouver sa place dans les grilles horaires, c’est loin d’être le cas à l’athénée d’Esneux. Depuis cette année scolaire, tous les élèves de 4e, 5e et 6e secondaires, tant dans l’enseignement général qu’en technique ou en professionnel, ont en effet opté pour les deux heures de CPC au détriment des cours de morale et de religion. ‘Et nous sommes un des seuls, sinon le seul établissement où c’est le cas’ note Philippe Halleux, professeur de morale à l’athénée d’Esneux depuis 1999 et par ailleurs président de l’Aphil, l’Association des Philosophes Issus de Liège. ‘Chez nous, ça représente environ 300 élèves ‘.
Théoriquement, tous les élèves doivent suivre une heure de CPC obligatoire. Pour la deuxième heure, ils ont le choix : CPC toujours, religion ou morale. Un modèle que voudraient voir évoluer les membres de l’Aphil, qui plaident quant à eux pour le passage automatique à deux heures de CPC et la mise en place d’un cours de religion optionnel. Et l’exemple d’Esneux semble leur donner raison. ‘Tout est plus facile pour tout le monde, continue M. Halleux. A Esneux en tout cas, tout le monde s’en félicite : les horairistes, les professeurs, les élèves…’
Impossible toutefois aujourd’hui d’exporter le modèle esneutois sans la collaboration des parents. C’est eux en effet qui ont le dernier mot dans le choix des options de leurs enfants […] Tous les parents ont opté pour le cours de philosophie et de citoyenneté. ‘Avec ma collègue qui donne le cours de religion, Delphine Jordant, nous avons écrit une lettre à tous les parents d’élèves fin de l’année dernière pour leur annoncer que nous donnerions désormais tous les deux CPC. S’ils voulaient garder leurs professeurs, nous leur suggérions donc d’opter pour le cours de citoyenneté. Mais si une seule personne avait voulu garder religion, il aurait évidemment fallu organiser ce cours […] Dans les faits, il n’y avait déjà plus trop de différences entre nos deux cours, mais maintenant on peut parler de choses communes et on organise des sorties en commun. Tout ça va vraiment dans le sens de ce qui était voulu par le parlement : la mixité et le vivre-ensemble’.
Dans la même veine, « De Standaard » du 16 février laissait Bart Maddens, politologue à la KUL, exprimer les idées suivantes.
Dans les années à venir, l’offensive de la libre-pensée ne deviendra que plus intensive. Il l’illustre par la discussion au sujet de la diffusion de services religieux sur la VRT, la place de la religion à l’école et le traitement des prêtres. Les catholiques sont de plus en plus contraints à la défensive. Les libres penseurs deviennent plus assertifs, pour ne pas dire agressifs. Selon Maddens, dans les années à venir, le camp des non-catholiques essaiera de réaliser ses vœux de laïcisation.
Concluons par ce principe énoncé par Tocqueville : « Plus un phénomène tend à disparaître d’une société, plus son reliquat est perçu comme intolérable ».
P.L.
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Enseignement - Education, Jeunes, Société 1 commentaire -
L'accès aux églises interdit aux mineurs chinois
D'Anne Dolhein sur Réinformation.TV :
Les églises catholiques interdites aux mineurs en Chine depuis le 1er février

« Laissez venir à moi les petits enfants », dit le Christ. « Interdit aux mineurs », répond le pouvoir communiste en Chine où, depuis le 1er février, les parents ont été sommés de ne plus amener leurs enfants à l’église, sous peine de provoquer la fermeture des édifices religieux où l’on contreviendrait à cette règle. Dans certaines provinces, les autorités locales ont déjà demandé aux prêtres d’afficher des avis en ce sens sur les portes des églises. Telle est la « liberté religieuse » en Chine aujourd’hui, à l’heure où le Vatican compose avec le gouvernement pour passer l’Eglise clandestine, fidèle à Rome, sous le contrôle de l’Eglise nationaliste.
C’est en application des nouvelles réglementations des affaires religieuses décidées par le gouvernement de Xi Jinping, partisan du renforcement idéologique du marxisme-léninisme dans le Parti et dans l’éducation, que cette approche est adoptée dans de nombreux endroits en Chine. Un prêtre de la province de Hebei – qui a choisi de rester anonyme, et on comprend pourquoi – a ainsi expliqué à ucanews.com qu’en diverses localités de la région, les prêtres ont été invités à afficher l’interdiction aux mineurs sur l’ensemble des églises, lieux de prière et autres édifices religieux.
La nouvelle réglementation met les églises sur le même pied que les clubs et les bars Internet ou l’entrée des mineurs est interdite.
Depuis le 1er février, la surveillance des catholiques s’accroît en Chine
Un catholique de Chine centrale, Peter, confirme avoir vu les écriteaux et se plaint de ce qu’ils instaurent des interdictions pour lesquelles il n’y a « aucune base légale » en Chine : la constitution ne stipule-t-elle pas que les citoyens ont droit à la liberté religieuse, tandis que les lois ont mis en place la protection des mineurs faces aux discriminations en raison de leurs croyances religieuses ? L’histoire montre pourtant que les garanties constitutionnelles affichées par les pouvoirs communistes à travers le monde n’ont guère de réalité concrète.
Le même croyant, indigné de ce que la police détourne les yeux lorsque des mineurs entrent dans des bars internet mais semble vouloir appliquer très rigoureusement la surveillance des églises, invoque la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit qui y est reconnu aux parents d’élever leurs enfants conformément à leurs croyances religieuses. Encore une garantie très jolie sur le papier mais qui n’est guère prise au sérieux en dictature communiste…
En fait, les catholiques de Chine aujourd’hui sont exposés à une sorte de loterie, attendant de savoir de quelle manière seront mises en œuvre les nouvelles règles en matière religieuse, beaucoup étant laissé à l’appréciation des fonctionnaires communistes de tout rang. Ainsi un prêtre désigné par son seul prénom, Thomas, a-t-il indiqué que tout dépendra des relations entre les églises et les gouvernements locaux. Pour sa part, il est en discussion avec l’administration étatique pour les affaires religieuses afin d’obtenir des garanties de liberté pour assurer la « survie » de l’Eglise, de telle sorte qu’elle puisse être, avec son « personnel », préservée des attaques, pour que « la foi de l’Eglise soit préservée ».
Les églises catholiques interdites aux mineurs : c’est bien la transmission de la foi qui est visée
Ces réglementations touchent l’Eglise patriotique de plus en plus soumise au contrôle du parti communiste central. « Tous les sites religieux doivent être enregistrés ; il est interdit de se livrer à des activités religieuses en dehors de ces lieux enregistrés ; les clercs non enregistrés sont interdits de célébration d’office religieux ; les membres du parti et des mineurs ont également interdiction d’entrer dans une église. L’espace de vie de l’Eglise ne cesse de se rétrécir », a commenté le prêtre.
Un prêtre de l’église clandestine du nord est-de la Chine, le P. John, dont la communauté refuse quant à elle de s’enregistrer auprès du gouvernement, a été interpellé par les autorités à propos des nouvelles règles applicables : on lui a clairement signifié que le pouvoir ne veut plus voir les catholiques demeurer dans la clandestinité. « Ils perdraient notre trace et ne sauraient plus où nous sommes. Si notre foi ne se met pas en travers, tout ira bien. Si le bureau des affaires religieuses et celui de la sécurité publique nous entendent, ils ne s’inquiéteront pas. Si réellement nous nous livrons à des activités clandestines, nous constituerons un vrai problème pour eux. » La pression monte.
Le pouvoir communiste en Chine veut marginaliser la pratique religieuse
Et c’est ce que dénonce un prêtre dont il n’est pas précisé s’il est « patriotique » ou clandestin : « D’aucuns peuvent dire que si les relations entre l’Eglise et les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi sont bonnes, l’Eglise peut être traitée de manière indulgente. Mais en disant cela ils ne font rien d’autre que de nous tromper. Alors que le gouvernement central exige une application stricte, les fonctionnaires locaux vont faire respecter les règles de manière encore plus stricte. »