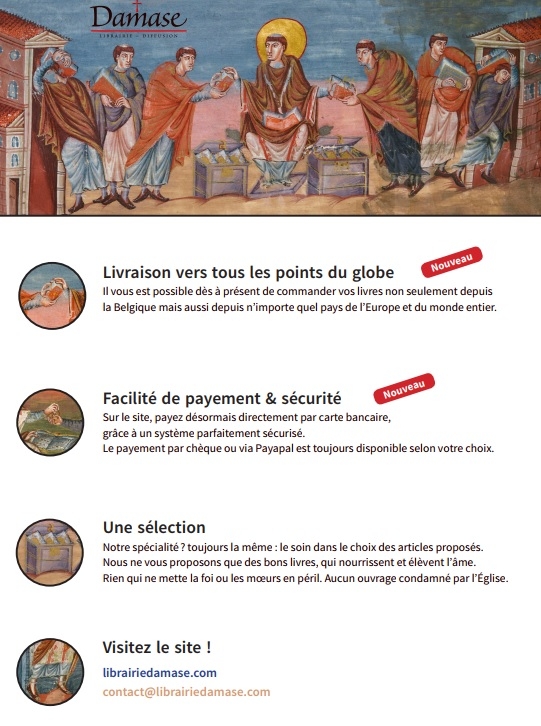Du site "Evangile au Quotidien" :
BBx Martyrs d’Albanie
Vinçens (Kolë) Prennushi et 37 compagnons
(† Albanie, 1945/1974)
Mémoire commune le 5 novembre : jour de la béatification.
Mémoire individuelle : jour du martyre (‘dies natalis’).
Le 5 novembre 2016, le cardinal Angelo Amato s.d.b., préfet de la Congrégation pour les Causes des Saints, à présidé, à la cathédrale Saint-Étienne de Shköder, en Albanie, la messe de béatification de 38 martyrs de la dictature communiste d'Enver Hoxha, président de l'Albanie durant 40 ans, de 1945 à 1985 .
Cette béatification des Serviteurs de Dieu, Vinçens Prennushi, archevêque franciscain de Durrës et primat d'Albanie, mort sous la torture le 19 mars 1949, et de ses 37 compagnons, tués entre 1945 et 1974, marque une étape importante dans la reconstruction spirituelle de ce pays des Balkans, qui a longtemps souffert d'un isolement extrême, et d'une dictature bien plus sévère encore à l'égard des religions que celles des autres nations d'Europe centrale et orientale, où les Églises parvinrent parfois à jouer, dans la mesure du faible espace de liberté qui leur restait, un rôle de contre-pouvoir.
Outre Mgr Prennushi, un autre évêque, Mgr Frano Gjini, des prêtres diocésains, des religieux franciscains et jésuites, un séminariste, une aspirante de 22 ans et trois laïcs figurent parmi les martyrs reconnus.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un régime communiste fermé au monde s'est implanté en Albanie, proclamée en 1967 par Enver Hoxha « premier État athée du monde ». En tant que Primat d'Albanie, Mgr Prennushi avait refusé à Hoxha de créer une Église albanaise distincte de Rome. Torturé, il est mort en prison le 19 mars 1949. Au total, sept évêques, 111 prêtres, 10 séminaristes et 8 religieuses sont morts en détention ou ont été exécutés entre 1945 et 1985. Dans le même temps, 1820 lieux de culte catholiques, orthodoxes et musulmans ont été détruits. Les lieux de culte qui restaient ont été affectés à d'autres usages.
Lors de sa visite en Albanie, le 21 septembre 2014, le Pape François (Jorge Mario Bergoglio, 2013-) avait rendu hommage à la résistance catholique, visiblement ému par le témoignage d'une religieuse et d'un prêtre octogénaires ayant survécu à des décennies de persécutions. Pour l'occasion, il avait délaissé le texte préparé à l'avance pour confier sa consternation devant l'ampleur des persécutions antireligieuses sous le régime de Enver Hoxha. « Comment ont-ils pu résister ? », s'était-il interrogé à propos des martyrs.
Ce prêtre qui avait témoigné devant le Pape, le père Ernest Simoni Ernest Simoni (né le 18 octobre 1928 à Troshan (municipalité de Blinisht, en Albanie), est un prêtre franciscain albanais. Emprisonné et réduit aux travaux forcés par les autorités communistes entre 1963 et 1981, il a été créé cardinal lors du consistoire, convoqué par le Pape François en clôture de l'Année sainte de la Miséricorde, le 19 novembre 2016.
Après les premières élections présidentielles démocratiques d'Albanie en 1992, une nouvelle constitution paraît en 1998, garantissant les libertés individuelles, dont la liberté religieuse. L'archidiocèse de Tirana-Durrës retrouve un archevêque, le siège été vacant depuis la mort de Mgr Prennushi. Dans le même temps, les lieux de cultes rouvrent et les mouvements religieux sont permis de se développer.
Le 10 novembre 2002, l'Archidiocèse de Shkodër-Pult introduit la cause en béatification et canonisation des trente-huit victimes de la persécution religieuse. Représentative de la reconstruction religieuse en Albanie, cette cause est soutenue par le pape François, notamment lors de sa visite apostolique du 21 septembre 2014. Pour l'occasion, le portrait des trente-huit serviteurs de Dieu sont exposés tout le long d'un boulevard leur étant consacré, à Tirana. Le Saint-Père ne manquera pas de leur rendre hommage tout au long de ce voyage.
Le 26 avril 2016, après trois ans d'étude auprès de la Congrégation pour la cause des saints, le pape François reconnaît qu'ils sont morts en haine de la foi, leur attribuant le titre de martyrs. La cérémonie de béatification s'est tenue le 5 novembre 2016 à Shkodër, en Albanie, et a été célébrée par le cardinal Angelo Amato, représentant du pape pour cette occasion.
Liste des 38 Bienheureux en ordre croissant des dates du martyre :
- Lazër Shantoja (*Shkodër, 2 septembre 1892 - † Tirana, 5 mars 1945), prêtre de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Ndre Zadeja (*Shkodër, 3 novembre 1891 - † 25 mars 1945), prêtre de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Giovanni Fausti (* Marcheno, Brescia, 9 octobre 1899 † Shkodër, 4 mars 1946), prêtre de la Compagnie de Jésus.
- Gjon (Kolë) Shllaku (*Shkodër, 27 juillet 1907 † 4 mars 1946), prêtre o.f.m.
- Daniel Dajani (*Blinisht, 2 décembre 1906 † Shkodër, 4 mars 1946)), prêtre de la Compagnie de Jésus.
- Qerim Sadiku (*18 novembre 1919 † 4 mars 1946), laïc de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Mark Çuni (*Bushati, 30 septembre 1919 † Shkodër, 4 mars 1946), séminariste.
- Gjelosh Lulashi (*2 septembre 1925 † 4 mars 1946), laïc de l'Archidiocèse de Shkodër.
- Alfons Tracki (*Bliszczyce, Pologne, 2 décembre 1896 † Shkodër, 18 juillet 1946), prêtre de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Fran Mirakaj (*1917 † septembre 1946), laïc de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Josef Marxen (*Worrigen, Allemagne, 5 août 1906 † Tirana, 16 novembre 1946), prêtre du diocèse de Lezhë.
- Luigj Prendushi (*Shkodër, 24 janvier 1896 † Shelqet, 24 janvier 1947), prêtre du diocèse de Sapë.
- Dedë Maçaj (*Mat i Jushi, 5 février 1920 † Përmet, 28 mars 1947), prêtre de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Mark Gjani (*Pulaj, 10 juillet 1914 † Shën Pal, 1947), prêtre de l'Archidiocèse de Shkodër.
- Serafin (Gjon) Koda (Janjevo, Serbie, 25 avril 1893 † Lezhë, Albanie, 11 mai 1947), prêtre o.f.m.
- Gjon Pantalia (*Prizren, Kosovo, 2 juin 1887 † Shkodër, 31 octobre 1947), religieux de la Compagnie de Jésus.
- Bernardin (Zef) Palaj (*Shllak, 2 octobre 1894 † Shkodër, 2 décembre 1947), prêtre o.f.m.
- Anton Zogaj (*Kthellë, Albanie, 26 juillet 1908 † Durrës, 9 mars 1948), prêtre de l'Archidiocèse de Tirana.
- Frano Gjini (*Shkodër, 20 février 1886 † 11 mars 1948), évêque du diocèse de Rrëshen.
- Mati (Pal) Prennushi (*Shkodër, 2 octobre 1881 † 11 mars 1948), prêtre o.f.m.
- Cyprian (Dedë) Nika (*Shkodër, 19 juillet 1900 † 11 mars 1948), prêtre o.f.m.
- Dedë Plani (*Shiroka, 21 janvier 1891 † Shkodër, 30 avril 1948), prêtre à Shkodër.
- Ejëll Deda (*Shkodër, 22 février 1917 † 12 mai 1948), prêtre à Shkodër.
- Anton Muzaj (*12 mai 1921 † Shkodër, printemps 1948), prêtre à Shkodër.
- Pjetër Çuni (*9 juillet 1914 - 31 juillet 1948), prêtre de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Lekë Sirdani (1er mars 1891 - 29 juillet 1948), prêtre de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Josif Papamihali (*Elbasan, 23 septembre 1912 † Maliq, 26 octobre 1948), prêtre de l'Église grecque-catholique albanaise.
- Vinçens (Kolë) Prennushi (*Shkodër, 4 septembre 1885 † Durrës, 19 mars 1949), prêtre o.f.m., archevêque de Durrës et primat d'Albanie.
- Jak Bushati (*Shkodër, 7 juillet 1890 † 12 septembre 1949), prêtre à Shkodër.
- Gaspër(Mikel) Suma (*Shkodër, 23 mars 1897 † 16 avril 1950), prêtre o.f.m.
- Marije Tuci (*Ndërfushaz, 12 avril 1928 † Shkodër, 24 octobre 1950), laïque de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult
- Jul Bonati (*Shkodër, 24 mai 1874 † Durrës, 15 novembre 1951), prêtre de l'Archidiocèse de Tirana-Durrës.
- Karl (Ndue) Serreqi (*Shkodër, 26 février 1911 † 4 avril 1954), prêtre o.f.m.
- Ndoc Suma (*Nenshat, 31 juillet 1887 † Pistull, 22 avril 1958), prêtre à Shkodër.
- Dedë Malaj (*Dushkul, 16 novembre 1917 † Shkodër 12 mai 1959), prêtre de l'Archidiocèse de Shkodër-Pult.
- Marin Shkurti (*Samrish, 1er octobre 1933 † avril 1969), prêtre à Shkodër.
- Shtjefën Kurti (*Ferizaj, Kosovo, 24 décembre 1898 † 20 octobre 1971), prêtre de l'Archidiocèse de Tirana-Durrës.
- Mikel Beltoja (*Beltoje, 9 mai 1935 † 10 février 1974), prêtre à Shkodër.
Sources principales : fr.radiovaticana.va/news/ ; wikipédia.org (« Rév. x gpm »).