 On a vu, le 1er octobre dernier, le pape François prendre part à un vaste repas organisé dans une église de Bologne pour mieux faire valoir le lien entre ces agapes (au sens étymologique du terme) conviviales et la célébration eucharistique ou, pour reprendre le commentaire de Mgr Zuppi (le nouvel archevêque fraichement nommé par ses soins) « pour aider à mieux comprendre l’Eucharistie, à la sentir encore plus humaine ».
On a vu, le 1er octobre dernier, le pape François prendre part à un vaste repas organisé dans une église de Bologne pour mieux faire valoir le lien entre ces agapes (au sens étymologique du terme) conviviales et la célébration eucharistique ou, pour reprendre le commentaire de Mgr Zuppi (le nouvel archevêque fraichement nommé par ses soins) « pour aider à mieux comprendre l’Eucharistie, à la sentir encore plus humaine ».
La réalité historique est tout de même assez différente. Un texte extrait des « Opera omnia » de Benoît XVI (volume VI/1, pp. 493 et suivantes) nous montre ce qu’il en est du passage de la « Cène » (du mot « cena », repas) à l’ « Eucharistie » du dimanche matin :
« […] Qu’a donc ordonné précisément le Seigneur de répéter? Certainement pas le repas pascal (au cas où la dernière Cène de Jésus ait été un repas pascal). La Pâque était une fête annuelle dont la célébration récurrente en Israël était clairement régulée par la sainte tradition et liée à une date précise. Même si, ce soir-là, ce n’était pas un vrai repas pascal selon le droit juif, mais d’un ultime banquet terrestre avant la mort, cela n’est pas dans l’objectif du commandement de répétition.
Le commandement se réfère donc à ce qui, dans ce que Jésus a accompli ce soir-là, était une nouveauté : le fait de rompre le pain, la prière de bénédiction, et d’action de grâce et avec elle les paroles de la transsubstantiation du pain et du vin. Nous pourrions dire : par ces paroles, notre moment actuel est entraîné dans le moment de Jésus. Ce que Jésus a annoncé en Jean, 12,32 se vérifie : de la Croix, il les attirera tous à lui, en lui […]
Joseph Andreas Jungmann, le grand connaisseur de la Célébration eucharistique et l’un des artisans de la réforme liturgique résume tout cela en disant : ‘ la forme fondamentale est la prière d’action de grâce sur le pain et le vin. C’est de la prière d’action de grâce, après le banquet du dernier soir, que la liturgie de la messe a commencé, et non du banquet lui-même. Ce dernier était considéré aussi peu essentiel et aussi facilement séparable que déjà dans l’Eglise primitive il était omis. La liturgie et toutes les liturgies, par contre, ont développé la prière d’action de grâce prononcée sur le pain et sur le vin. Ce que l’Eglise célèbre dans la messe n’est pas la dernière Cène, mais ce que le Seigneur, durant la dernière Cène, a institué et confié à l’Eglise : la mémoire de sa mort sacrificielle’ (Messe im Gottesvolk, p.24).
Dans la même ligne s’inscrit la constatation historique selon laquelle ‘dans toute la tradition du christianisme, après que l’Eucharistie a été détachée d’un vrai repas (où apparaît l’acte de ‘rompre le pain’ et la ’Cène du Seigneur’) un mot signifiant ‘repas’ n’est jamais utilisé, jusqu’à la Réforme du XVIe siècle, pour désigner la célébration de l’Eucharistie (p.23, note 73).
Dans la formation du culte chrétien, cependant, un autre élément est encore déterminant. Certain d’être exaucé, le Seigneur avait déjà donné à ses disciples, à la dernière Cène, son corps et son sang comme don de la Résurrection : Croix et Résurrection font partie de l’Eucharistie, qui sans cela n’est pas elle-même. Mais puisque le don de Jésus est essentiellement un don enraciné dans la Résurrection, la célébration du sacrement devait nécessairement être relié à la mémoire de la Résurrection. La première rencontre avec le Ressuscité était advenue le matin du premier jour de la semaine –du troisième jour après la mort de Jésus- donc le dimanche matin. Par là, le matin du premier jour devenait spontanément le moment du culte chrétien, le dimanche devenait le « Jour du Seigneur ».
Cette détermination chronologique de la liturgie chrétienne, qui en même temps définit sa nature profonde et sa forme, s’est mise très vite en place. Ainsi le rapport d’un témoin oculaire dans les Actes 20, 6-11 nous raconte le voyage de saint Paul et de ses compagnons vers Troas et il dit : ‘Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain…’ (20, 7). Cela signifie que déjà durant la période des Apôtres le fait de ‘rompre le pain’ avait été fixé pour le matin du jour de la Résurrection – l’Eucharistie était célébrée comme rencontre avec le Ressuscité […]
Un archaïsme qui voudrait retourner avant la Résurrection et à sa dynamique pour imiter seulement la dernière Cène ne correspondrait pas du tout à la nature du don que le Seigneur a laissé à ses disciples. Le jour de la Résurrection est le lieu extérieur et intérieur du culte chrétien, et l’action de grâce, comme anticipation créatrice de la Résurrection de la part de Jésus, est la manière par laquelle, dans son don, il nous bénit et il nous entraîne dans la transformation qui, à partir des dons, doit nous gagner et se répandre sur le monde : ‘jusqu’à ce qu’il vienne’ (1 Co 11,26) ».
JPSC



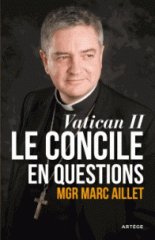 De Franck Abed
De Franck Abed 

