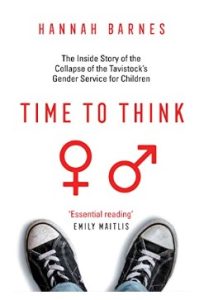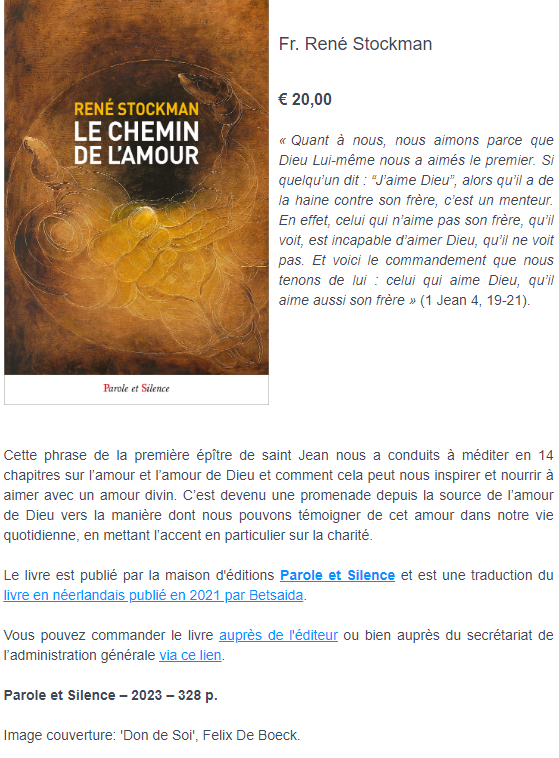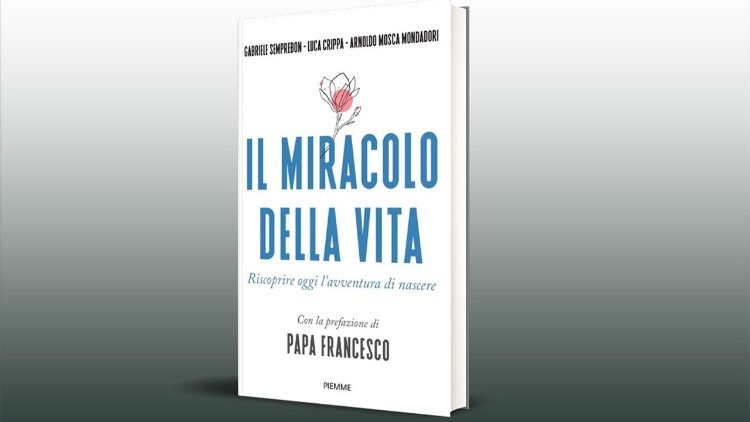De Lorenza Formicola sur le site de la Nuova Bussola Quotidiana :
"Moi, cardiologue, je vous parle des miracles eucharistiques".

10-06-2023
Cinq miracles eucharistiques, du VIIIe siècle à 2013, étudiés avec la technologie la plus sophistiquée d'aujourd'hui. La présence constante de "tissu musculaire myocardique humain - et parfois de sang - présentant des signes de détresse ; et toujours le même groupe sanguin". La Bussola s'entretient avec le cardiologue Franco Serafini.
Les linges les plus importants de la Passion du Christ, à commencer par le Saint Suaire, et cinq miracles eucharistiques, parmi ceux reconnus par l'Église au cours des 13 derniers siècles, partagent un fil conducteur surprenant, constitué de traces de sang du même groupe sanguin et de résidus similaires de tissu musculaire myocardique sur lesquels on peut reconnaître des signes cliniques de stress intense et de violence, que l'on retrouve chez les victimes d'agressions, d'accidents de la route ou d'exécutions. Tel est le résumé des conclusions auxquelles est parvenu Franco Serafini. Le médecin qui, après la publication du livre Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza (Edizioni Studio Domenicano), est devenu pour beaucoup "le cardiologue de Jésus".
Les études révèlent un diagnostic clinique précis, ponctuel et détaillé qui n'est pas en contradiction, mais au contraire en parfaite adéquation avec ce que nous lisons dans les Évangiles et ce qu'annonce la Tradition catholique. Il s'agit d'hosties consacrées d'où se sont échappés du sang et des tissus cardiaques, en différents lieux et à différentes époques, à savoir à Lanciano (VIIIe siècle), à Buenos Aires en Argentine (1992-1994-1996), à Tixtla au Mexique (2006) et en Pologne à Sokółka (2008) et à Legnica (2013).
Dr Serafini, d'où vous est venue l'envie de travailler sur un tel ouvrage ?
Il y a quelques années, j'avais pris conscience de l'existence d'enquêtes de médecine légale sur des tissus miraculeusement remontés à la surface d'hosties consacrées. Cela me semblait un argument très fort : si les miracles étaient authentiques, cela signifiait qu'il y avait eu de vraies biopsies du corps de Jésus de Nazareth. Qui sait quelles données, certainement intéressantes, peut-être choquantes, avaient été trouvées ! Mais ce que j'ai trouvé en librairie ou sur le web, vers 2015-2017, était décevant : des données incertaines, contradictoires, rapportées par des vulgarisateurs plus sensibles à l'aspect dévotionnel qu'à l'aspect médico-scientifique. J'ai donc décidé de m'y intéresser moi-même, en recherchant les dossiers originaux et en me rendant sur place chaque fois que possible pour rencontrer les témoins oculaires des événements et les chercheurs impliqués dans la recherche. Ce fut une merveilleuse aventure intellectuelle et spirituelle, qui a certainement changé ma vie et qui a donné naissance à ce livre.
Peut-on dire, ou est-ce un hasard, que pour la première fois un cardiologue rend visite à Jésus dans cinq endroits différents du monde avec le même diagnostic ?
Même si le titre de mon livre, choisi par l'éditeur, me met dans l'embarras, oui, on peut le dire. Les cinq miracles auxquels je me suis intéressé, cinq événements reconnus par l'Église catholique, mais aussi soumis à une investigation scientifique de qualité, présentent un schéma répétitif.
Lequel ?
Il y a toujours du tissu musculaire myocardique humain - et parfois du sang - qui présente des signes de détresse ; et on retrouve toujours le même groupe sanguin. Cette répétition des mêmes tissus dans différents miracles, à de grandes distances temporelles et spatiales les uns des autres, me réconforte : c'est un signe supplémentaire d'authenticité. Comment des faussaires auraient-ils pu les faire correspondre à ce point ?
Mais revenons au diagnostic : les lames histologiques dans lesquelles le tissu cardiaque est reconnu convergent avec une forte probabilité vers le diagnostic d'un type particulier d'infarctus du myocarde.