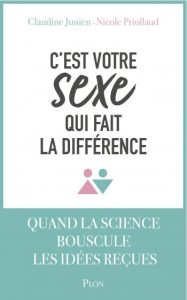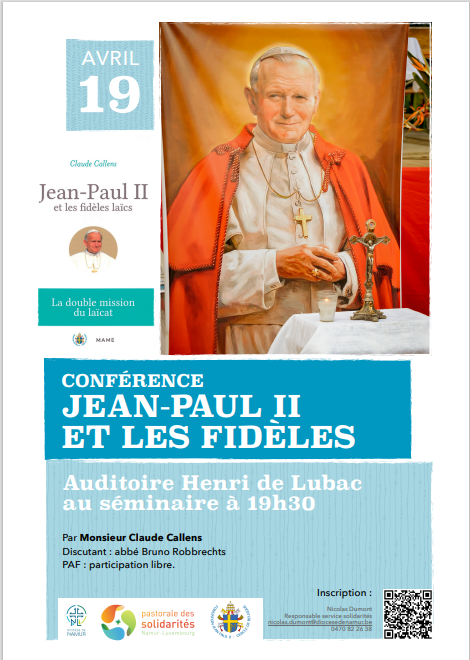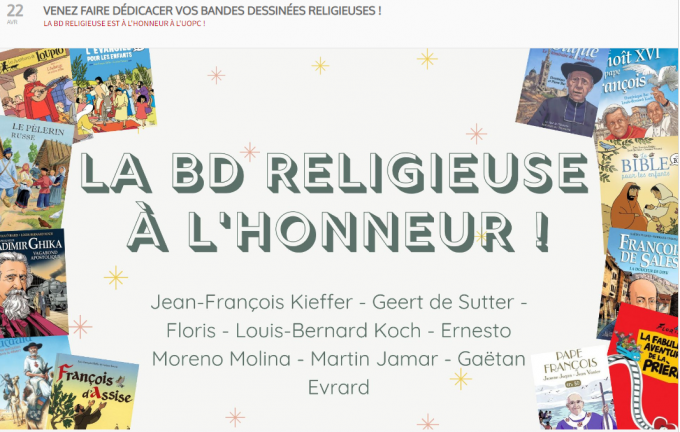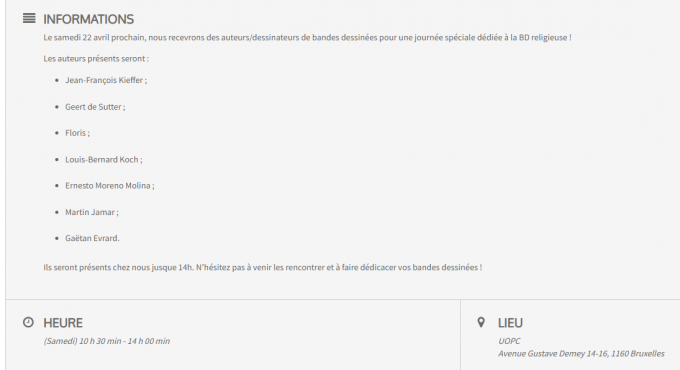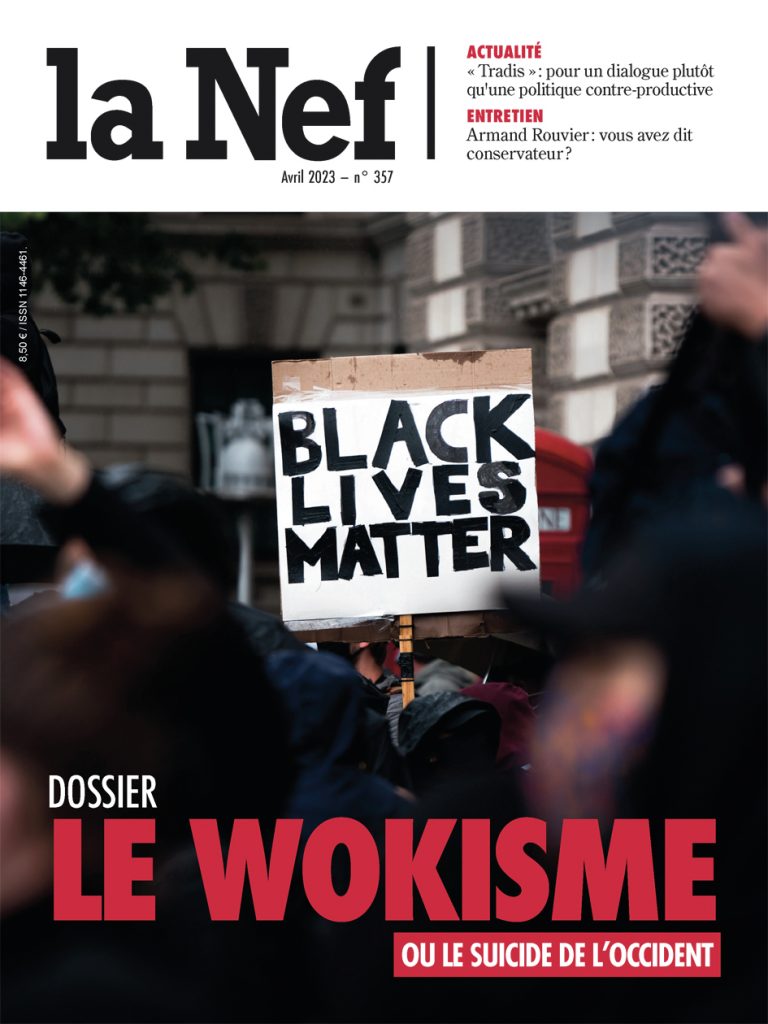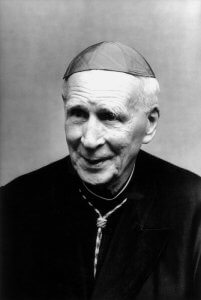Des propos recueillis par Marguerite de Lasa sur le site du journal la Croix :
Rémi Brague : « Dans l’islam, Dieu est au-dessus de l’Histoire »
Le philosophe Rémi Brague publie chez Gallimard Sur l’islam, une présentation générale de l’islam à l’usage des non-musulmans. Catholique, il a longtemps enseigné la philosophie de langue arabe, et suggère aujourd’hui de délaisser nos catégories chrétiennes pour tenter de comprendre l’islam.
14/03/2023
La Croix : Quel est votre objectif avec ce livre ?
Rémi Brague : Je l’ai écrit pour me clarifier les idées. J’ai enseigné pendant vingt ans la philosophie de langue arabe, mais des penseurs comme Avicenne, Averroès et Al Farabi ont un rapport complexe à l’islam.
J’avais donc un but de philosophe : mettre de la clarté, introduire des distinctions là où il y a beaucoup de confusions et de préjugés, dans un sens comme dans l’autre. Surtout, j’ai voulu m’interroger sur nos difficultés à comprendre l’islam tel qu’il se comprend lui-même, car nous avons tous, croyants comme athées, des lunettes chrétiennes.
Vous expliquez que le « véritable islam » peut renvoyer aussi bien au fondamentalisme qu’à l’islam mystique… Pourquoi est-il si périlleux de le définir ?
R. B. : Tout le monde prétend incarner le véritable islam. Les musulmans se critiquent mutuellement à qui mieux mieux. Les gens d’Al-Azhar prennent leur distance – discrètement, d’ailleurs – par rapport aux gens de Daech, lesquels accusent tous les autres musulmans d’être des « vendus » aux Occidentaux. Comme il n’y a pas de magistère, pape ou grand sanhédrin, n’importe qui peut dire ce qu’est l’islam. Personnellement, je n’ai aucune autorité pour dire quel est le véritable islam. Par contre, je peux essayer de montrer la continuité de certaines idées. Du IXe au XIXe siècle, il y a par exemple l’idée que la raison humaine n’est pas capable de dire ce qui plaît à Dieu. La révélation ne porte donc pas sur la nature de Dieu mais sur sa volonté.
C’est une grande différence avec le christianisme
R. B. : Oui, c’est une sorte de chassé-croisé. Le christianisme, avec saint Thomas d’Aquin, dit : « Dieu est difficile à connaître, nous avons besoin de voies pour prouver son existence. » En revanche, pour savoir comment nous comporter, nous avons la raison naturelle. L’islam dit exactement le contraire. L’existence de Dieu est une évidence : il suffit d’ouvrir les yeux, de voir les merveilles de la création, et Dieu est là.
Par contre, pour savoir s’il faut se laisser pousser la barbe ou se la raser, s’il faut que les femmes portent un voile ou non, la raison ne suffit pas. Nous chrétiens, avons du mal à comprendre pourquoi beaucoup de musulmans considèrent que ne pas manger de porc, ou se tailler la moustache, c’est important. Pour nous, cela relève du culturel, voire du folklore.
Et pourquoi est-ce si important pour les musulmans ?
R. B. : Parce qu’ils considèrent que cette loi vient directement de Dieu. Nous, chrétiens, vivons sous l’autorité de la conscience, dont notre civilisation pensait jusqu’à il y a peu que c’était la voix de Dieu. Rousseau s’exclame : « Conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix. » Mais la théocratie en islam, c’est simplement le fait que la loi est censée venir de Dieu. Certes, il y a des médiations : le droit islamique (fiqh) est humain, puisque c’est la manière dont on comprend et applique des injonctions divines.
Mais pour un musulman pieux, si le Coran dit par deux fois que les femmes doivent faire quelque chose – on ne sait trop quoi – avec une pièce de tissu, c’est Dieu qui le dit. Quant aux hommes, un hadith du Prophète leur commande : « Ne faites pas comme les chrétiens, laissez-vous pousser la barbe et taillez votre moustache. » Et le Coran dit que Mohammed est « le bel exemple » (XXXIII, 21). Si Dieu le veut, il faut obtempérer.
Cela a pour conséquence que leurs « valeurs dépendent de l’arbitraire divin », dites-vous.
R. B. : Oui, il y a là une discussion classique en philosophie, dès l’Euthyphron de Platon : Est-ce que certaines pratiques sont bonnes parce que Dieu les commande ? Ou est-ce que Dieu les commande parce qu’elles sont bonnes ? Un chrétien répond : les valeurs font partie de Dieu, elles sont un prisme dans lequel se décompose la lumière divine. C’est la thèse que soutiennent la majorité des philosophes : Dieu commande les choses parce qu’elles sont bonnes. En islam, en revanche, les choses sont bonnes parce que Dieu les a commandées. Si l’on considère que le bien est autre chose que Dieu, on se livre au seul péché que Dieu ne pardonne jamais, à savoir l’association (chirk).
Pour expliquer le moindre développement de la théologie en islam par rapport aux mathématiques ou à l’astronomie, vous affirmez que, « l’islam ayant d’emblée un contenu plausible, il n’a pas connu les défis du mystère chrétien ». Que voulez-vous dire ?
R. B. : La théologie vise à expliciter le mystère à l’aide de catégories d’origine philosophique. En islam, vous n’avez pas besoin de ça : il n’y a qu’un seul Dieu, il a tout créé et envoie des prophètes de temps en temps, dont le message est le même si les peuples auxquels ils ont été confiés ne le trafiquent pas. C’est plausible : il n’y a pas besoin d’un effort intellectuel prodigieux pour dire cela.
En revanche, dire que Dieu est un dans la communion des trois personnes, c’est plus difficile. Même chose pour expliquer qu’il y a dans la personne du Christ la nature humaine et la nature divine. En revanche, dans le kalâm, les traités de théologie islamique, il s’agit de montrer que le dogme est plausible, et les autres croyances absurdes. C’est de l’apologétique, qui ne constitue qu’une partie de la théologie chrétienne.
Quelle est la différence dans la conception de Dieu entre le christianisme et l’islam ?
R. B. : Pour un musulman, Dieu est inconnaissable. Nous pouvons connaître sa volonté, mais n’avons aucune idée de ce qu’il est. D’ailleurs, le christianisme est en partie d’accord : « Si comprehendisnon est Deus » : « Si je peux en faire le tour, c’est que ce n’est pas Dieu », disait saint Augustin. Mais chez les chrétiens, on peut essayer de s’en approcher, parce que Dieu a commencé par s’approcher de nous. Finalement, ce qui distingue vraiment le christianisme et le judaïsme d’un côté, et l’islam de l’autre, c’est la notion d’alliance. Le fait que Dieu ait une aventure avec l’humanité. Dans l’islam, il est au-dessus de l’Histoire.