De SudPresse de ce mercredi 20 mai (p. 27) (via la Revue de Presse de l'Archevêché) :
Un livre sur la vie de Mgr Léonard
Un ouvrage vient de paraître consacré à Monseigneur André Léonard …. Il est intitulé « A l’occasion des 80 ans de Monseigneur André Léonard, de Jambes à Savines-le-Lac ». L’initiative vient de Jacques Toussaint, président de l’asbl « Art Research Institute », un cabinet d’expertises indépendant en matière d’art et de patrimoine, basé à Jambes et né en 2017. … Ce livre comporte 160 pages et 410 photos, officielles et plus privées, qui retracent la vie de Monseigneur Léonard, de sa naissance à Jambes en passant par ses études à Namur, Louvain, Rome, son professorat à l’Université catholique de Louvain et ses charges épiscopales, jusqu’à son actuelle retraite active à Savines-le-Lac, en France. « Il n’y a pas de question d’éthique dans cet ouvrage. Il y a des petites légendes sous les photos mais sinon, c’est un texte continu. Il y a deux préfaces rédigées par les professeurs Francis Delpérée et Hervé Hasquin qui apportent leur témoignage sans concessions.” … La sélection des photos n’a pas été une mince affaire. « Elles proviennent essentiellement des archives de l’évêché de Namur, de l’archevêché de Malines-Bruxelles, et d’une série de personnes qui ont accepté de collaborer. Monseigneur Léonard n’a pas communiqué de photo, mais il a laissé carte blanche.”




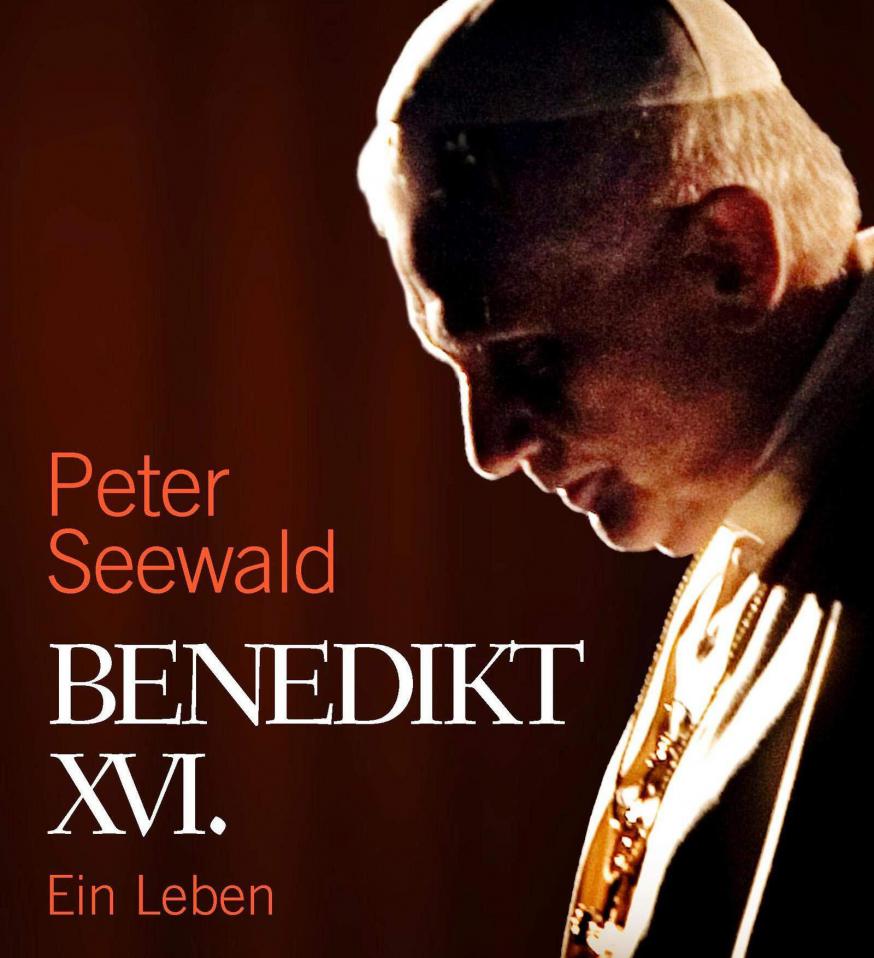

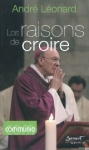 En concluant son essai apologétique « Les raisons de croire » publié chez Fayard (1e édition en 1987) Mgr André Léonard, alors professeur de métaphysique et de philosophie à l’UCL, illustre ces questions que posent déjà des enfants eux-mêmes lorsque leur conscience s’éveille à l’étrangeté de la condition humaine :
En concluant son essai apologétique « Les raisons de croire » publié chez Fayard (1e édition en 1987) Mgr André Léonard, alors professeur de métaphysique et de philosophie à l’UCL, illustre ces questions que posent déjà des enfants eux-mêmes lorsque leur conscience s’éveille à l’étrangeté de la condition humaine :

