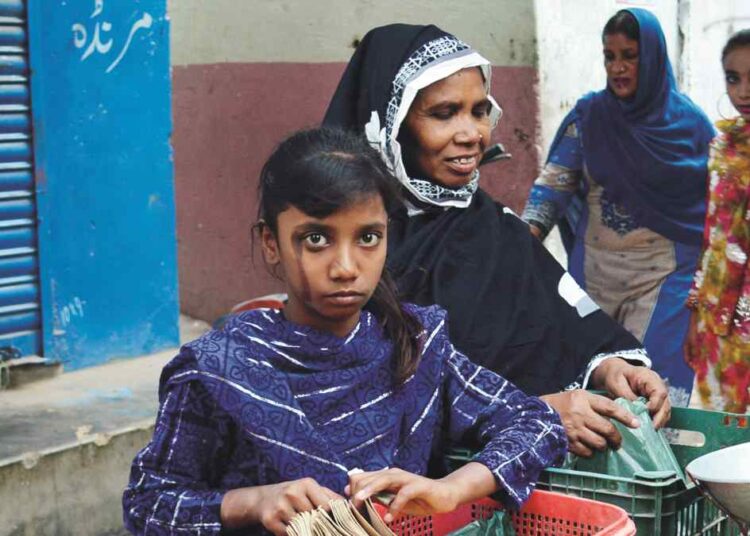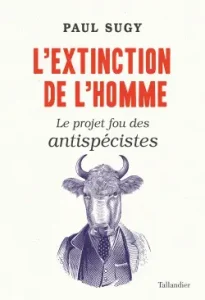D'Eric de Legge sur Aleteia :
Aleteia victime d’une grave campagne de dénigrement

17/01/22
Depuis quelques jours, Aleteia est victime d’une campagne de calomnies à la suite de la publication par un site web américain d’un long article sur le prétendu financement de Aleteia par “l’éditeur de pédopornographie Google, Georges Soros et Bill Gates”, rien de moins.
Aleteia est victime depuis quelques jours d’une campagne de dénigrement visant à discréditer sa singulière liberté de ton et son souci de vérité dans la charité. L’article d’un site web américain, complaisamment relayé en France, nous accuse d’être financé par “l’éditeur de pédopornographie Google, Georges Soros et Bill Gates”, rien de moins, et d’être des promoteurs sans discernement de la vaccination contre le Covid. Confronté à ce tissu de mensonges et d’insinuations malveillantes, nous tenons à donner à tous nos lecteurs et tous nos donateurs, des informations fiables sur nos relations avec Google et sur le traitement par Aleteia des questions touchant aux fameux vaccins. Pour apprécier les procédés, aussi malins qu’insidieux, mis en œuvre dans cette “enquête”, vous pouvez lire ici un décryptage de la direction de Aleteia.
Aleteia est “financé par l’éditeur de pédopornographique Google, le colporteur de vaccins Bill Gates et l’agitateur de gauche George Soros », assurent sans rire les auteurs de cette “enquête”. Cela est faux bien-sûr ! En 2021, Aleteia a mis en place un consortium de “fact checking” concernant le déploiement des vaccins face au Covid 19 et l’a présenté en toute transparence à ses lecteurs. Il nous apparaissait alors pertinent que des médias catholiques participent au concours mondial Google News Initiativeen fédérant une trentaine de titres catholiques de sensibilité diverses et de proposer ainsi une information vérifiée sur la vaccination, ses avantages et ses risques. Les digressions de l’article sur nos liens financiers avec Georges Soros ou Bill Gates tiennent du fantasme sinon du ridicule. Aleteia n’a aucun lien avec eux. Ni la Fondation Gates ni l’Open Society Foundation n’ont été invitées à donner un seul centime aux efforts du consortium, et ni l’une ni l’autre ne l’ont fait. De même, affirmer que Aleteia a conclu une alliance avec Google en 2013 prête à sourire dès lors que l’on s’intéresse à la presse en ligne. Cette année-là, Aleteia a fait le choix d’utiliser des services de Google, notamment liés à la publicité, tout comme l’immense majorité des sites d’informations à travers le monde. L’accumulation d’informations désordonnées produit ici un effet dévastateur. Elle nous fait clairement suspecter une volonté de nuire.
Une accumulation de mensonges
Alors, oui les coûts engagés pour faire fonctionner le consortium de médias catholiques rassemblés par Aleteia ont été en partie pris en charge par Google News Initiative. Mais ce financement n’a créé aucune dépendance idéologique des médias du consortium à l’égard de Google News Initiative, chacun préservant sa ligne propre. Jamais Google News Initiative n’est intervenu auprès de l’un de ses membres, de quelque manière que ce soit et pour quelque raison que ce soit. La trentaine de titres associés à cette initiative a des orientations éditoriales tout à fait représentatives de l’Église universelle, des “progressistes” aux “conservateurs”.
En réalité, l’accumulation de mensonges et d’approximations sur Aleteia nous a d’abord fait hésiter à y répondre. De la composition du conseil scientifique entourant le consortium à la détention de Aleteia par Media-Participations, en passant par la réalité de notre couverture des actualités sur les vaccins… Tout ce qu’avance cet article est faux. Ce site ne s’embarrasse manifestement pas avec les faits et se révèle surtout un champion de l’association d’idées et des insinuations fallacieuses. Il affirme travailler pour la vérité mais il n’en a cure. Il ne prend même pas la peine de vérifier des informations pourtant publiques. Que reproche-t-il à Aleteia ? Son succès missionnaire qui en fait le site catholique le plus visité au monde ? Son parti-pris pour la bienveillance ?
La liberté de Aleteia
Le lancement de ce consortium de médias catholiques de vérification des faits a permis de mieux informer nos lecteurs, tout en demeurant parfaitement libre. Dans la centaine d’articles publiés par Aleteia sur la thématique vaccinale, ma rédaction peut garantir et prouver que cette couverture a été parfaitement équilibrée. Entre d’une part le soutien à la vaccination, notamment telle que promue par le Saint-Père et les principales conférences épiscopales, et d’autre part le souci de publier des informations vérifiées sur les promesses et les risques des vaccins.
Oui, Aleteia a toujours été, est et sera toujours totalement libre de dire la vérité. Aleteia n’appartient à aucune chapelle. Aleteia n’est pas vendu à Google. Aleteia n’est pas un “média du Vatican” : nous n’avons aucun lien ni hiérarchique, ni financier, avec le Saint Siège. Aleteia cherche d’abord et avant tout à faire rayonner le message de l’Evangile. Avec bienveillance envers toutes et tous. Nous sommes un média profondément catholique. Cela signifie que nous respectons le Pape et l’Eglise. Nous savons que sur une question comme celle des vaccins, ils ne sont pas infaillibles. Mais leur parole compte pour nous et, de manière tout-à-fait factuelle, nous diffusons ce qu’ils disent. C’est un service, comme celui de la recherche de la vérité, que nous devons à nos lecteurs.
Si vous souhaitez approfondir tous les points que j’évoque ici, je vous invite à lire le décryptage révélateur que l’équipe de direction a fait de tous les procédés fallacieux dont Aleteia est victime.