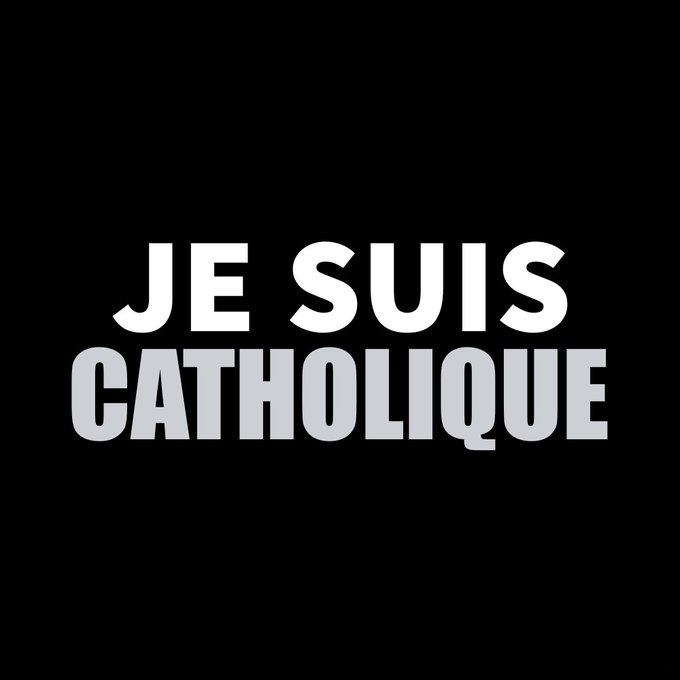Du Figaro via la revue de presse de l'Homme Nouveau ("Au quotidien" 81):
Dans le Figaro du 30 octobre dernier, le philosophe Rémi Brague réagissait à l’attentat de Nice, non seulement en chrétien mais en bon connaisseur de l’islam, démontrant ainsi, par l’exemple, que la question de l’islam ne peut être résolue par une approche laïciste.
Le philosophe Rémi Brague souligne l’opposition entre le système de normes des pays occidentaux, fondé sur la raison et la conscience, et celui des sociétés musulmanes, basé sur le respect de la loi dictée par le Coran.
LE FIGARO.- Quelques jours après la décapitation de Samuel Paty, l’islamisme fait trois nouveaux morts à Notre-Dame de Nice. Que vous inspire ce nouvel attentat?
Rémi BRAGUE.- La même chose qu’à beaucoup de monde, hormis bien entendu les menteurs aux larmes de crocodile, voire ceux pour qui l’assassin est un «martyr»: du chagrin et de la compassion envers les victimes et leurs proches, de la rage envers les meurtriers, davantage envers ceux qui les manipulent, et encore plus envers ceux qui leur trouvent des excuses, de la honte devant la lâcheté de discours martiaux qu’aucun effet ne suit.
En tout cas, guère de surprise. Les causes étant là, comment s’étonner de ce qu’elles produisent des effets? Parmi ces causes, une immigration sans contrôle, des réseaux sociaux et des prêcheurs qui attisent la haine. Et maintenant des chefs d’État étrangers qui en profitent pour laisser le mécontentement de leurs sujets se déchaîner sur des cibles sans risque pour eux. (…) Pour ces gens, la France est fondamentalement une nation chrétienne, et peu importe que beaucoup parmi nous rejettent cet ancrage avec dégoût. De même que nous appelons «musulmans» tous ceux qui vivent dans des pays islamisés ou qui en proviennent, de même ceux-ci perçoivent comme «chrétiens» tous ceux qui vivent en terre chrétienne ou ex-chrétienne. Or le christianisme est depuis le début de la part de l’islam l’objet d’une haine mêlée de mépris. Celui-ci est pour lui une religion dépassée, qui a trahi le message d’Issâ (Jésus), qui a trafiqué l’Évangile (au singulier) pour en effacer l’annonce de la venue de Mahomet, qui associe au Dieu unique deux créatures, par exemple Jésus et Marie. Dans la cité musulmane d’autrefois, le christianisme, comme le judaïsme, était toléré tant que c’était dans l’intérêt de l’islam dominant. Les chrétiens y versaient un impôt spécial et devaient se soumettre à des règles destinées à les humilier (Coran, IX, 29) afin qu’ils comprennent qu’il serait dans leur avantage de passer à la religion «vraie». (…)
Il est révélateur qu’aujourd’hui on décide de fermer les lieux de culte, qui sont surtout des églises, jusqu’à nouvel ordre. On peut en comprendre les raisons, qui relèvent de la santé publique. Reste que, ironiquement, cette fermeture provisoire correspond tout à fait à ce que souhaitent les «islamistes» sur le long terme. Même si ce n’est certainement pas pour leur plaire que la décision a été prise, ils n’auraient pas rêvé mieux… (…)
L’islamisme et l’islam sont en effet différents, mais j’y vois une différence de degré plus que de nature. L’islamisme est l’islam pressé, bruyant, brouillon ; l’islam est un islamisme patient, discret, méthodique. L’islam a pour but avoué, dès le début, non pas la conversion du monde entier, mais sa conquête - pas nécessairement militaire. Il cherche à établir des régimes dans lesquels une forme ou une autre de la loi islamique sera en vigueur, de sorte qu’en un second temps leurs sujets auront intérêt, à long terme, à se convertir.
 « Dans son
« Dans son