D'Anne-Sylvie Sprenger sur le Journal Chrétien :
Depuis 2019, l’Église orthodoxe ukrainienne et l’Église orthodoxe russe se livrent une véritable guerre d’influence aux enjeux résolument politiques. Kiev étant le berceau du christianisme orthodoxe, Moscou ne peut se permettre de perdre pied dans ce pays.
Explications avec Nicolas Kazarian, historien et spécialiste du monde orthodoxe.
Alors que les blindés russes continuent de s’amasser aux frontières de l’Ukraine, les Églises de la région n’ont lancé aucun véritable message de paix. Le métropolite Épiphane, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, a certes appelé à l’unité, mais dans un souci de conservation de l’identité nationale. Quant au patriarche de Moscou, il s’illustre par son silence. C’est que les tensions actuelles ont une forte composante religieuse comme l’explique Nicolas Kazarian, historien et spécialiste du monde orthodoxe.
En quoi la religion contribue-t-elle au conflit entre la Russie et l’Ukraine?
La création en 2019 de l’Église orthodoxe ukrainienne, qui réunit des entités dissidentes du patriarcat de Moscou, a suscité une opposition frontale de la part de l’Église orthodoxe russe. Elle ne lui reconnaît pas de légitimité canonique et voit les Ukrainiens se détourner de son autorité au profit de cette nouvelle Église autocéphale.
Que craint l’Église orthodoxe russe?
D’abord la fin de son hégémonie sur les symboles identitaires et spirituels de l’orthodoxie slave. Kiev est le berceau du christianisme orthodoxe, sa Jérusalem en quelque sorte. Cet ancrage symbolique et historique est déterminant dans la capacité de la Russie à se projeter dans son histoire et sa maîtrise des outils symboliques définissant la narration de son identité nationale. Il est inconcevable pour Moscou d’être séparé du territoire sur lequel le christianisme a donné naissance au monde orthodoxe.
Le deuxième enjeu est d’ordre matériel: c’est celui de la gestion des lieux de culte. Le patriarcat russe redoute d’être dépossédé de ses biens immobiliers et de ses propriétés, notamment des plus grands monastères dont il est en charge aujourd’hui encore, soit la Laure des grottes de Kiev et Saint-Job de Potchaïev, les deux grands centres spirituels de l’Ukraine.
Comment l’Église orthodoxe évolue-t-elle en Ukraine?
Elle pèse toujours plus lourd. La part de ses fidèles est passée de 13 à 24% de la population totale du pays entre 2019 et 2021, selon le rapport 2021 du think tank Razumkov. Or il faut voir l’image dans son ensemble: l’Ukraine représente un tiers des fidèles du patriarcat de Moscou. Sa capacité à peser sur la scène internationale dépend de ces fidèles, car c’est en avançant son poids démographique qu’elle peut prétendre être la première des Églises orthodoxes dans le monde. L’amputation de l’Ukraine lui ferait perdre sa position de leadership au sein de l’orthodoxie, leadership sur lequel elle se base volontiers lorsqu’elle se projette sur la scène mondiale.
Que signifierait cette perte d’influence sur le plan politique?
Les liens entre le patriarcat de Moscou et le Kremlin sont très étroits. Disons que le patriarcat de Moscou fait de la diplomatie parallèle… Si la capacité d’influence du patriarcat de Moscou diminue, cela réduit par voie de conséquence celle du Kremlin. Les effets de cette rivalité ukrainienne dépasse d’ailleurs largement les frontières, et ce jusque sur le continent africain.
Comment cela?
Le patriarcat de Moscou a jugé comme acté la rupture de communion avec les quatre Églises orthodoxes qui ont reconnu l’Église ukrainienne (le patriarcat œcuménique de Constantinople, le patriarcat d’Alexandrie, l’Église de Chypre et l’Église de Grèce). Il se donne donc désormais le droit de pouvoir agir directement sur leurs territoires canoniques. Moscou a ainsi envoyé des prêtres de Russie pour convaincre des prêtres orthodoxes africains de se rallier à l’Église orthodoxe russe. Ils ont fait la Une des journaux, il y a quelques semaines, en annonçant que le patriarcat de Moscou avait été capable de débaucher une centaine de prêtres orthodoxes africains sur le continent. On assiste là à une guerre de chapelles, un véritable conflit de substitution qui a déplacé la question ukrainienne sur le territoire et le continent africain.
Une action de représailles en somme.
C’est surtout une manière de faire pression sur les Églises orthodoxes pour ne pas que l’Église ukrainienne soit reconnue comme légitime. Si elle n’est pas reconnue comme légitime, le patriarcat de Moscou peut continuer d’exister comme la seule entité ecclésiale canonique du territoire ukrainien.
Mais pourquoi précisément en Afrique?
Cette action de représailles est en même temps liée à un agenda diplomatique où la Russie est aujourd’hui en train de monter en puissance sa présence et son action sur le continent africain. On parle souvent aussi de l’action des paramilitaires russes au Mali. Tout cela fait partie d’une seule et même stratégie. Une stratégie où l’action militaire et l’action économique participent à un faisceau d’actions, où la dimension spirituelle n’est pas totalement absente.
Concernant l’Ukraine, comment comprenez-vous l’absence d’appel à la paix claire de la part des représentants des Églises orthodoxes russe et ukrainienne?
Le fait qu’il n’y ait eu aucun véritable appel à la paix tant des autorités ecclésiales russes qu’ukrainienne m’a en effet interpellé. Le métropolite Épiphane, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, a certes appelé à l’unité, mais dans un souci de conservation de l’identité nationale. Quant au patriarche de Moscou, il se fait remarquer par son silence.
Faut-il y voir une connivence entre le religieux et le politique?
Je ne voudrais pas trop m’avancer… Mais je pense que, souvent, le silence en dit beaucoup plus que des mots.
 « Le président congolais Félix Tshisekedi est invisible depuis son atterrissage lundi 7 mars à Bruxelles. Seule certitude, le voyage n’était pas programmé. A l’origine, le président devait être à Kinshasa pour accueillir la délégation royale belge qui aurait dû, sans un enième report de la visite dû cette fois à la situation en Ukraine, débarquer dans la capitale congolaise le dimanche 6 mars en soirée.
« Le président congolais Félix Tshisekedi est invisible depuis son atterrissage lundi 7 mars à Bruxelles. Seule certitude, le voyage n’était pas programmé. A l’origine, le président devait être à Kinshasa pour accueillir la délégation royale belge qui aurait dû, sans un enième report de la visite dû cette fois à la situation en Ukraine, débarquer dans la capitale congolaise le dimanche 6 mars en soirée.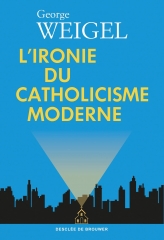 L’Américain George Weigel, auteur d’une biographie de référence de Jean-Paul II, vient de publier en français un essai important défendant une thèse quelque peu iconoclaste : catholicisme et modernité (*) ne s’opposeraient pas. Thèse certes discutable, mais qui mérite assurément d’être présentée ici, car elle ouvre la porte à un nécessaire débat de fond dans l’Église sur cette question essentielle. Le site web du mensuel la Nef qui publie cette analyse de Anne-Sophie Retailleau promet d’y revenir plus en détail dans un prochain numéro de la revue….
L’Américain George Weigel, auteur d’une biographie de référence de Jean-Paul II, vient de publier en français un essai important défendant une thèse quelque peu iconoclaste : catholicisme et modernité (*) ne s’opposeraient pas. Thèse certes discutable, mais qui mérite assurément d’être présentée ici, car elle ouvre la porte à un nécessaire débat de fond dans l’Église sur cette question essentielle. Le site web du mensuel la Nef qui publie cette analyse de Anne-Sophie Retailleau promet d’y revenir plus en détail dans un prochain numéro de la revue….  Retraçant avec brio 250 ans de l’histoire de l’Église, confrontée à l’émergence de la pensée moderne, George Weigel entend réfuter cette historiographie traditionnelle qu’il estime erronée. Ainsi, entreprend-il une analyse originale des rapports entre catholicisme et modernité, et déroule le fil de l’histoire de l’Église dans son rapport avec ce nouveau défi des temps contemporains. Cette relation est d’abord marquée par un rejet originel des nouveaux principes de la modernité issus de la Révolution française. Progressivement, l’enchaînement aboutit à une lente maturation entraînant l’Église, sous l’impulsion de papes visionnaires, au dialogue avec le monde moderne. Cette longue histoire de maturation constitue pour l’auteur « le drame du catholicisme et de la modernité », compris comme le déroulement d’une action scénique divisée en cinq actes. Chacun de ces moments marque les étapes d’un apprivoisement de la modernité par l’Église. Non dans le but de s’y soumettre, mais au contraire de proposer une nouvelle voie de recherche de la vérité qui répondrait aux aspirations les plus nobles auxquelles le monde moderne aspire.
Retraçant avec brio 250 ans de l’histoire de l’Église, confrontée à l’émergence de la pensée moderne, George Weigel entend réfuter cette historiographie traditionnelle qu’il estime erronée. Ainsi, entreprend-il une analyse originale des rapports entre catholicisme et modernité, et déroule le fil de l’histoire de l’Église dans son rapport avec ce nouveau défi des temps contemporains. Cette relation est d’abord marquée par un rejet originel des nouveaux principes de la modernité issus de la Révolution française. Progressivement, l’enchaînement aboutit à une lente maturation entraînant l’Église, sous l’impulsion de papes visionnaires, au dialogue avec le monde moderne. Cette longue histoire de maturation constitue pour l’auteur « le drame du catholicisme et de la modernité », compris comme le déroulement d’une action scénique divisée en cinq actes. Chacun de ces moments marque les étapes d’un apprivoisement de la modernité par l’Église. Non dans le but de s’y soumettre, mais au contraire de proposer une nouvelle voie de recherche de la vérité qui répondrait aux aspirations les plus nobles auxquelles le monde moderne aspire.