Lu sur le site « diakonos.be » :
 « Si pour Benoît XVI, c’est la « diplomatie de la vérité » qui comptait, pour François c’est la « Realpolitik » qui prévaut. Le changement de cap politique et diplomatique est on ne peut plus net entre les deux derniers pontificats, en particulier dans les rapports avec la Chine et l’Islam. C’est ce que souligne Matteo Matzuzzi, rédacteur en chef du quotidien italien « Il Foglio » et vaticaniste chevronné qui vient de publier un ouvrage sur la géopolitique du Vatican, intitulé « Il santo realismo », édité par LUISS University Press.
« Si pour Benoît XVI, c’est la « diplomatie de la vérité » qui comptait, pour François c’est la « Realpolitik » qui prévaut. Le changement de cap politique et diplomatique est on ne peut plus net entre les deux derniers pontificats, en particulier dans les rapports avec la Chine et l’Islam. C’est ce que souligne Matteo Matzuzzi, rédacteur en chef du quotidien italien « Il Foglio » et vaticaniste chevronné qui vient de publier un ouvrage sur la géopolitique du Vatican, intitulé « Il santo realismo », édité par LUISS University Press.
En ce qui concerne la Chine, le changement de cap est sous nos yeux à tous. Celui avec l’Islam l’est moins. Mais c’est précisément sur ce terrain que les deux pontificats suivent des voies divergentes, pour ne pas dire opposées, et que le livre de Matzuzzi reconstruit avec clarté.
*
En ce qui concerne Benoît XVI, on garde en mémoire l’incident de Ratisbonne, lorsque sa critique argumentée du rapport incertain dans l’islam entre la foi et la raison a déchaîné une réaction furieuse et violente dans le monde musulman. Mais bien peu se souviennent que non seulement le Pape Benoît n’a pas reculé d’un pouce sur ce qu’il avait dit à l’époque mais que son discours du 12 septembre 2006 avait permis l’émergence d’un dialogue d’une intensité sans précédent d’abord avec trente-huit et ensuite avec cent-trente-huit personnalités musulmanes faisant autorité, issues de nations et d’orientations diverses, aussi bien sunnites que chiites.
Ce dialogue s’est concrétisé dans de longues lettres au pape signées par ces sages et par la première visite au Vatican du roi d’Arabie Saoudite et gardien des lieux saints de l’islam, ainsi que des émissaires de la plus haute autorité chiite hors d’Iran, le grand ayatollah Sayyid Ali Husaini Al-Sistani. Tandis qu’à son tour, Benoît XVI, après un voyage en Turquie réussi contre toute attente en novembre de cette même année 2006 – avec une prière silencieuse dans la Mosquée bleue d’Istanbul -, en est venu, en dressant un bilan lors de son discours de fin d’année à la Curie romaine, à encourager ouvertement le monde musulman à entreprendre lui aussi cette « longue recherche laborieuse » dans laquelle – disait-il – les chrétiens sont déjà engagés depuis longtemps, c’est-à-dire « accueillir les véritables conquêtes des Lumières, les droits de l’homme et spécialement la liberté de foi et de son exercice, en reconnaissant en eux les éléments essentiels notamment pour l’authenticité de la religion ».
En s’adressant au corps diplomatique, en janvier 2006, le pape Benoît n’avait pas hésiter à reconnaître dans le temps présent le réel « risque de conflits de civilisations » auquel il fallait opposer, disait-il, « l’engagement pour la vérité », notamment « de la part des diplomaties », une vérité que « ne peut être atteinte que dans la liberté » et « dans laquelle l’homme lui-même en tant que tel est en jeu, le bien et le mal, les grands défis de la vie et le rapport avec Dieu ».
En s’en tenant à cette « diplomatie de la vérité » sans jamais en dévier, Benoît XVI en a payé le prix. Le prix fort en 2011, quand une voiture piégée a explosé devant une église remplie de fidèles rassemblés pour la messe à Alexandrie, en Égypte. Il y avait eu des dizaines de morts. Et le 2 janvier, à la fin de l’Angélus, le pape ne s’est pas tu. Pas plus que le grand imam d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, qui avait réagi à « l’ingérence » papale en suspendant tous les rapports avec le Saint-Siège, lui s’était à plusieurs reprises par le passé déclaré favorable aux attentats suicides en territoire israélien.
Les rapports avec Al-Azhar n’avaient repris qu’en 2016, avec une embrassade à Rome entre Al-Tayyeb et le pape François. Mais justement, beaucoup de choses avaient déjà changé avec ce nouveau pape.
*
Entretemps, le dialogue profond sur la foi et la raison avec les cent-trente-huit sages musulmans avait tout de suite été interrompu. Parce que les initiatives du pape François envers l’islam obéissaient à des critères totalement différents et bien plus pragmatiques.
Son premier geste, à grand renfort de jeûne pénitentiel, fut l’offensive publique contre l’attaque occidentale imminente contre la Syrie de Bachar Al-Assad. Les hiérarchies orthodoxes et catholiques de ce pays étaient résolument dans le camp du régime alaouite, qui faisait office de bouclier contre l’hostilité d’autres tendances islamiques. Mais l’initiative de François était à bien plus large spectre. Parmi ceux qui étaient opposés à une intervention militaire en Syrie, il y avait Vladimir Poutine. Et c’est ce qui avait incité le pape à écrire au leader russe une lettre-appel, en guise de drapeau blanc. Cette initiative avait atteint son but et à partir de ce moment, les rapports entre François et Poutine ont été au beau fixe, jusqu’à donner lieu, le 12 février 2016, à la rencontre historique à l’aéroport de La Havane entre le pape et le patriarche de Moscou, Cyrille, avec la signature conjointe d’un document – souligne Matzuzzi – « qui n’avait pas grand-chose à voir avec le Vatican et semblait avoir été écrit au Kremlin ».
Cette volte-face pro-russe, plus encore que pro-syrienne, a conduit à sacrifier l’Église catholique d’Ukraine, rattachée, y compris militairement, à Moscou sur son territoire. Mais au jugement de François, la balance des intérêts penchait naturellement en faveur d’une entente avec Moscou.
Quant à l’islam, François a rapidement montré qu’il entendait poursuivre une « fraternité » interreligieuse générique, même au prix de se taire sur les actes d’agression perpétrés au nom d’Allah, qu’il est même allé jusqu’à parfois justifier.
Le 7 janvier 2015, à paris, des islamistes radicaux massacrent des dizaines de journalistes et de dessinateurs de la revue satyrique « Charlie Hebdo », accusés de tourner leur foi en dérision. Et huit jours plus tard, au cours de la conférence de presse dans l’avion pendant le vol entre le Sri Lanka et Manille, le pape a fait ce commentaire textuel, en mimant avec le poing serré vers son majordome Alberto Gasbarri :
« C’est vrai que l’on peut réagir violemment, mais si M. Gasbarri, un grand ami à moi, dit une grossièreté contre ma mère, il recevra un coup de poing! C’est normal! C’est normal! […] Beaucoup de personnes parlent mal des religions, se moquent d’elles, disons qu’elles transforment en jouet la religion des autres, ces personnes provoquent et il peut arriver ce qui arrive si M. Gasbarri dit quelque chose contre ma mère ».
Le 26 juillet 2016, en France, nouvel assassinat au nom d’Allah, et un prêtre âgé, Jacques Hamel, est décapité sur l’autel. Cinq jours plus tard, dans l’avion de retour de Cracovie, interrogé sur cette question, voici comment a répondu François :
« Je n’aime pas parler de violence islamique, car tous les jours, quand je feuillette les journaux je vois des violences, ici en Italie : celui qui tue sa fiancée, un autre qui tue sa belle-mère… Et il s’agit de catholiques baptisés violents ! Ce sont des catholiques violents… […] Je crois qu’il n’est pas juste d’identifier l’islam avec la violence. Cela n’est pas juste et cela n’est pas vrai ! J’ai eu un long dialogue avec le grand imam de l’université d’Al-Azhar et je sais ce qu’ils pensent : ils cherchent la paix, la rencontre. […] Le terrorisme grandit quand il n’y a pas d’autre option, quand au centre de l’économie mondiale il règne le dieu argent et non la personne, l’homme et la femme. Cela est un terrorisme de base contre toute l’humanité ».
Et effectivement, le « long dialogue » cité par le pape avec le grand imam d’Al-Azhar avait bien eu lieu deux mois auparavant, le 23 mai 2016, à Rome, en réparation de la fracture qui avait eu lieu en 2011 avec Benoît XVI. Et cette nouvelle entente a connu au cours des années qui suivirent des développements spectaculaires, de la signature conjointe d’un document sur la « fraternité humaine » à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis le 4 février 2019, à l’encyclique « Fratelli tutti » du 3 octobre 2020, que le pape a ouvertement déclaré avoir écrit « motivé de manière particulière par le grand imam ».
Toutefois, dans le même temps, il y a un régime musulman avec lequel François entre en froid : la Turquie de Recep Tayyip Erdogan.
En effet, Erdogan était irrité depuis l’initiative du pape en défense du régime syrien d’Al-Assad, son rival régional. Et François en avait soigneusement tenu compte, en faisant profil bas lors de sa visite en Turquie de novembre 2014.
Mais ensuite, après avoir choisi le grand imam d’Al-Azhar comme son compagnon de route, il abandonna Erdogan avec toutes les précautions diplomatiques. Le 12 avril 2015, à la messe en mémoire du martyre du peuple arménien, François a pour la première fois dans la bouche d’un pape désigné ce martyre comme un véritable « génocide » à proprement parler, perpétré par la Turquie cent ans auparavant, « le premier génocide du XXe siècle ».
Que n’avait-il fait là ! Les réactions courroucées n’ont pas tardé à fuser depuis la Turquie et d’Erdogan en personne. L’ambassadeur auprès du Saint-Siège a été rappelé à Ankara et ne reviendra à Rome qu’un an plus tard. Mais François n’en démord pas. En 2016, il visite l’Arménie et dénonce à nouveau le « génocide », en ajoutant par-dessus le marché – lors de la traditionnelle conférence de presse sur le vol du retour » – n’avoir jamais eu d’autre mot pour désigner l’extermination des Arméniens, pendant toutes ses années passées en Argentine.
Le 5 février 2018, à Rome, Erdogan est reçu en audience par le pape François, et finissent par trouver un terrain d’entente anti-israélienne temporaire en condamnant la décision de Donald Trump de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, en tant que véritable capitale de l’État hébreu. Mais les désaccords avec le pape François reprennent de plus belle le 12 juillet 2020, quand François se déclarera publiquement « très affecté » par la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée.
Mais entretemps, la seconde opération de bon voisinage avec les musulmans prenait forme, ce qui pour François revient à tisser des rapports non pas avec des États mais avec des personnes individuelles particulièrement représentatives. Après l’entente avec le sunnite Al-Tayyeb, le pape mise sur une rencontre avec le grand ayatollah chiite Al-Sistani. Et il réussit à la concrétiser le 3 mars 2021, au cours d’un voyage en Iraq audacieux et bien conçu, le premier jamais effectué par un pape.
Et en effet, Al-Sistani est une personnalité d’une envergure exceptionnelle, y compris au niveau géopolitique. Il est né en Iran, mais il est antithétique aussi bien au régime politique qu’à la volonté de puissance de sa nation d’origine, que surtout à la version de l’islamisme chiite incarnée par Khomeini et ses successeurs. En Iraq, où il vit depuis plusieurs dizaines d’années, Al-Sistani prêche une coexistence pacifique entre sunnites et chiites et conteste à la racine la « wilayat al-fahiq », le théorème khomeiniste qui assigne aux docteurs de la loi islamique le pouvoir politique en plus du pouvoir religieux.
L’un des effets de la rencontre entre le pape François et Al-Sistani sera que bientôt le grand imam sunnite d’Al-Azhar se rendra lui aussi en Iraq, à Najaf, pour rencontrer pour la première fois le grand ayatollah chiite. Les préparatifs de ce voyage sont déjà bien avancés et auront un impact important sur les ententes et les rivalités qui sont en pleine évolution dans le monde musulman.
En effet, l’opposition séculaire entre sunnites et chiites ou entre arabes et perses, dans laquelle le Vatican a traditionnellement tendance à privilégier l’entente avec Téhéran, fait aujourd’hui place à une configuration plus complexe avec d’un côté l’Iran, la Turquie, le Qatar, les libanais du Hezbollah et les palestiniens du Hamas et de l’autre l’Égypte, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Maroc et en partie l’Iraq également, avec des sunnites et des chiites mélangés sur l’un et l’autre front.
Par ses initiatives, François s’est dans les fait alignés au second front, qui est également celui qui est le plus ouvert à Israël et le plus hostile à l’idéologie des Frères Musulmans et des réseaux terroristes connexes. Il a même contribué lui-même à le construire en favorisant le rapprochement entre Al-Tayyeb et Al-Sistani. Miraculeusement, même ses battements d’aile finissent par influer sur l’équilibre mondial.
Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.
Ref.François, Al-Tayyeb, Al-Sistani. Le miracle de la triple entente
 Selon les informations de La Libre Afrique.be, le pasteur Dodo Kamba (photo) a été imposé en septembre 2020 à la tête de l’Eglise du Réveil du Congo par le pasteur Jacques Kangudia, membre du cabinet du président Félix Tshisekedi et « coordinateur pour le changement des mentalités ». Avant cela, Israël Dodo Kamba, faisait des prédications sur YouTube au nom de la Mission sacerdotale Royale (sic). Son accession à la tête de l’Eglise du Réveil du Congo avait nécessité la destitution – en contravention avec les statuts légaux, selon lui – de son président, le Général Sony Kafuta Rockman. Le président Tshisekedi est lui-même un adepte de l’Eglise de Réveil du Congo depuis sa conversion au pentecôtisme en 2015, sous l’influence du pasteur Jacques Kangudia. »
Selon les informations de La Libre Afrique.be, le pasteur Dodo Kamba (photo) a été imposé en septembre 2020 à la tête de l’Eglise du Réveil du Congo par le pasteur Jacques Kangudia, membre du cabinet du président Félix Tshisekedi et « coordinateur pour le changement des mentalités ». Avant cela, Israël Dodo Kamba, faisait des prédications sur YouTube au nom de la Mission sacerdotale Royale (sic). Son accession à la tête de l’Eglise du Réveil du Congo avait nécessité la destitution – en contravention avec les statuts légaux, selon lui – de son président, le Général Sony Kafuta Rockman. Le président Tshisekedi est lui-même un adepte de l’Eglise de Réveil du Congo depuis sa conversion au pentecôtisme en 2015, sous l’influence du pasteur Jacques Kangudia. »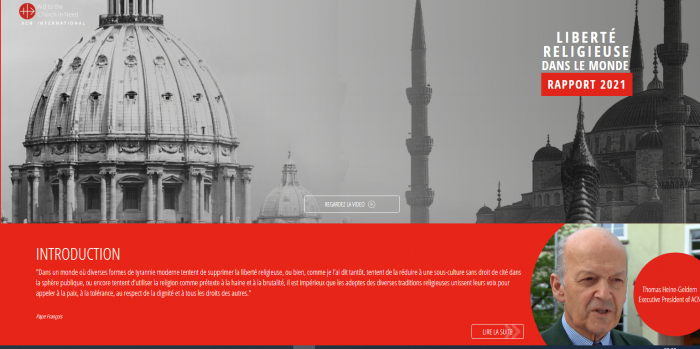
 « Si pour Benoît XVI, c’est la « diplomatie de la vérité » qui comptait, pour François c’est la « Realpolitik » qui prévaut. Le changement de cap politique et diplomatique est on ne peut plus net entre les deux derniers pontificats, en particulier dans les rapports avec la Chine et l’Islam. C’est ce que souligne Matteo Matzuzzi, rédacteur en chef du quotidien italien « Il Foglio » et vaticaniste chevronné qui vient de publier un ouvrage sur la géopolitique du Vatican, intitulé « Il santo realismo », édité par LUISS University Press.
« Si pour Benoît XVI, c’est la « diplomatie de la vérité » qui comptait, pour François c’est la « Realpolitik » qui prévaut. Le changement de cap politique et diplomatique est on ne peut plus net entre les deux derniers pontificats, en particulier dans les rapports avec la Chine et l’Islam. C’est ce que souligne Matteo Matzuzzi, rédacteur en chef du quotidien italien « Il Foglio » et vaticaniste chevronné qui vient de publier un ouvrage sur la géopolitique du Vatican, intitulé « Il santo realismo », édité par LUISS University Press.