 A l'occasion de la Conférence des évêques de France, lundi 9 avril au soir, Emmanuel Macron a prononcé un discours au ton hasardeux et aux thématiques multiples, dans lequel on retrouve davantage de questions que de réponses. Sur le site web « Atlantico », le point de vue de Bertrand Vergely, philosophe et théologien :
A l'occasion de la Conférence des évêques de France, lundi 9 avril au soir, Emmanuel Macron a prononcé un discours au ton hasardeux et aux thématiques multiples, dans lequel on retrouve davantage de questions que de réponses. Sur le site web « Atlantico », le point de vue de Bertrand Vergely, philosophe et théologien :
« Quand on l’écoute attentivement, le discours que le chef de l’État a prononcé hier soir aux Bernardins à l’invitation des évêques de France suscite plus de questions qu’il n’apporte de réponses.
En premier lieu, le ton général du discours pose question. Celui-ci n’a pas tant été un discours qu’une homélie, le chef de l’État invitant les catholiques sur le ton de l’exhortation à « faire un don de leur sagesse, de leur engagement et de leur liberté ».
Exhortation pour le moins singulière, comme si les catholiques n’avaient pas déjà l’habitude du don d’eux-mêmes.
Dans le projet par ailleurs, annoncé d’emblée, là encore on s’interroge. « Réparer le lien entre l’Église et l’État ». Le chef de l’État, sur ce point, est demeuré sibyllin en n’expliquant pas ce qui a été gâté entre l’Église et l’État, pourquoi cela l’a été et comment il entendait réparer ce qui a été gâté. Avec cette formule, il avait pourtant un boulevard qui s’ouvrait afin de redéfinir ce que doit être l’attitude de la laïcité à l’égard des religions en général et de l’Église catholique en particulier et ce que doit être en retour l’attitude des religions en général et de l’Église catholique en particulier à l’égard de la laïcité. Ce qui n’a pas été fait. À un moment du discours, il a été question de donner un cap. Celui-ci a été donné : sous la forme d’un appel à la dignité de l’homme et au sens. Ce qui ne répond guère à la question de savoir ce qu’est la laïcité et ce que doivent être les relations de la République laïque à l’égard des religions et l’attitude des religions à l’égard de la République laïque. Est-ce d’ailleurs la question des relations entre l’Église et l’État dont il convient de parler ? Cette référence à la loi de 1905 est-elle pertinente ? Le lien entre l’Église et l’État a été rompu et nul ne songe à vouloir le rétablir. C’est bien plutôt celle des relations entre la République et le religieux en général ainsi que l’Église catholique en particulier qui pose problème. Ainsi, quand il est expliqué que les valeurs de la République résident dans la liberté et que la liberté réside dans le droit au blasphème, n’y a-t-il pas urgence à redéfinir ce que sont les principes de la République, le sens de la liberté ainsi que ses limites ? Le chef de l’État est demeuré étrangement silencieux sur ce problème pourtant crucial. En lieu et place d’une réflexion sur le sens de la liberté aujourd’hui, de façon kierkegaardienne, il a été surtout question d’un appel à vivre de façon déchirée, dans l’inconfort et l’incertitude. En un mot, il a été question, pour les catholiques, d’aller sur la croix et d’y rester en souffrant.
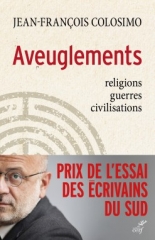 Jean-François Colosimo, directeur des Éditions du Cerf, essayiste, a consacré l’ensemble de ses recherches aux métamorphoses contemporaines de Dieu.
Jean-François Colosimo, directeur des Éditions du Cerf, essayiste, a consacré l’ensemble de ses recherches aux métamorphoses contemporaines de Dieu.  "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime".
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime".
 Dans le bi-mensuel
Dans le bi-mensuel