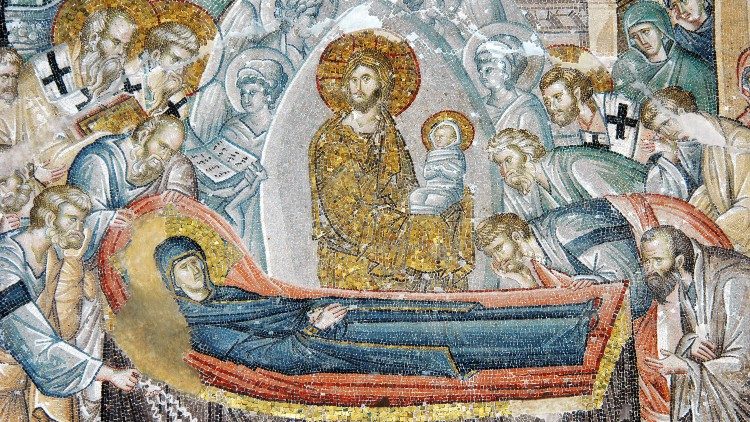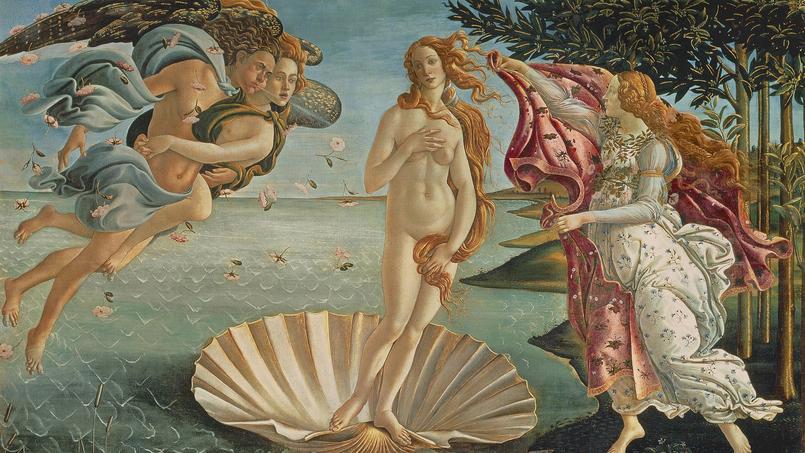De Romain Mazenod sur le site du Pèlerin :
« La présence chrétienne au Liban, un trésor à préserver »
Après la double explosion survenue le 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, le directeur Liban de l’Œuvre d’Orient, Vincent Gelot, souligne l’impact de la catastrophe sur les communautés chrétiennes du pays.
13 août 2020
Quelles sont les conséquences du drame pour les communautés chrétiennes que vous soutenez ?
Nous déplorons d’abord des pertes humaines. Plus d’une centaine de morts, des milliers de blessés, plus de 300 000 personnes déplacées… Le bilan est terrible. Une religieuse des Filles de la Charité a été tuée. Plusieurs infirmières sont mortes dans les hôpitaux. L’éparchie* de Beyrouth, qui se situe à 1 km du lieu de l’explosion, n’a pas été épargnée. Un employé y est mort, un gardien a perdu un œil. Quant à l’archevêque maronite de Beyrouth, Mgr Boulos Abdel Sater, il a été légèrement blessé. Plusieurs édifices chrétiens sont touchés, comme le couvent franciscain du quartier de Gemmayzé. Mais la plupart de ces bâtiments sont debout. Il s’agira davantage de réhabilitation que de reconstruction.
Quelles priorités vous fixez-vous ?
L’urgence est que les hôpitaux et les centres de santé fonctionnent à nouveau. Trois grands hôpitaux appartenant à des Églises ou des congrégations ont été en partie détruits. Il nous faut aider à remettre en route les services d’urgence. Il y a ensuite les écoles chrétiennes francophones. Elles sont presque 400 dans le pays. Il faut qu’elles puissent rouvrir pour qu’ait lieu la rentrée scolaire, même si la date de reprise des cours est incertaine en raison de la Covid-19. Enfin, nous devrons réhabiliter des maisons pour les si nombreuses personnes dont le logement n’est plus habitable. Aujourd’hui, un grand nombre d’entre elles ont trouvé refuge chez des amis, dans la famille ou ont regagné leur village natal où elles possèdent souvent une autre résidence.
Pourquoi les chrétiens sont-ils si précieux pour la société libanaise ?
Il ne faudrait pas qu’ils émigrent en nombre, ce qui mettrait en danger l’équilibre confessionnel avec les chiites et les sunnites. Leur présence est capitale. À travers leurs institutions – écoles, hôpitaux, centres de santé –, ils sont une force vive de ce pays. C’est aussi un enjeu pour la France car, dans leurs écoles, les élèves suivent des cours en français sur la citoyenneté, la laïcité, le vivre-ensemble… Et ce sont les seuls établissements confessionnels au Liban qui accueillent des élèves de toutes confessions, de tous milieux sociaux, de toutes provenances géographiques. Cette présence au Liban est un trésor qu’il faut plus que jamais préserver.
* Archevêché maronite
Venons en aide au Liban !
Un immense élan de solidarité s’est levé pour aider un pays sous le choc. Mais la récolte de fonds des bailleurs internationaux ne suffira pas pour reconstruire Beyrouth. Chacun peut, selon ses moyens, venir en aide au pays du Cèdre en faisant un don à une association.
Fondée à Paris il y a plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient a fait ses preuves dans le soutien aux communautés chrétiennes de la région. Mais au Liban son rôle s’avère plus large. Par exemple, en venant en aide à des centaines d’écoles chrétiennes francophones, c’est à tout le pays que l’association rend service. En effet, ces établissements accueillent des élèves de toutes confessions et de tous milieux sociaux. En donnant à l’Œuvre d’Orient c’est donc la cohésion de la société libanaise dans son ensemble que l’on contribue à renforcer. Car ce pays, comme l’a encore rappelé le pape François récemment, est le « fruit de la rencontre de différentes cultures, qui a émergé au fil du temps comme un modèle du vivre ensemble. Bien sûr, cette coexistence est maintenant très fragile, mais je prie pour […] qu’elle puisse renaître libre et forte ».
L’appel aux dons lancé par l’Œuvre d’Orient concerne aussi l’aide d’urgence pour les hôpitaux et les dispensaires, considérée comme « la priorité numéro un », ainsi que la réhabilitation des églises et des couvents. Il est aussi possible de soutenir une communauté ou un établissement en particulier. Dans ce cas, il suffit de le mentionner dans votre courrier ou votre courriel, afin que le don soit fléché.
Une aide cruciale
Par ailleurs, le quotidien libanais francophone L’Orient-Le Jour a lancé une grande campagne de récolte de fonds intitulée « Ensemble, reconstruisons Beyrouth ». Une initiative prise en partenariat avec la plate-forme Impact Lebanon (Impact Liban), qui répartira les sommes perçues entre des ONG triées sur le volet. Par souci de transparence, cette plate-forme exigera de chacune d’elles qu’elle précise le détail des dépenses, le nombre de bénéficiaires et leurs origines géographiques. Quatre ONG ont pour l’instant été identifiées : La Croix-Rouge libanaise ; Arcenciel ; Offre Joie, qui conduit des projets sociaux avec Asmae, l’association de sœur Emmanuelle ; enfin, Beit el-Baraka, très active dans l’un des quartiers les plus touchés par la double explosion. Ces associations pourront, entre autres missions, aider à assurer la sécurité alimentaire. La moitié des cinq millions de Libanais – sans compter 1 million de réfugiés – rencontraient en effet déjà des difficultés pour se nourrir avant le drame du 4 août dernier.
POUR FAIRE UN DON
À l’Œuvre d’orient :
→ Sur Internet : secure.oeuvre-orient.fr
→ Par La Poste : L’Œuvre d’Orient – 20LIB – 20 rue du Regard, 75006 Paris. Préciser que vous souhaitez donner pour le Liban.
À impact Lebanon via le le quotidien libanais francophone L’Orient-Le Jour :
→ Sur Internet : lorientlejour.com