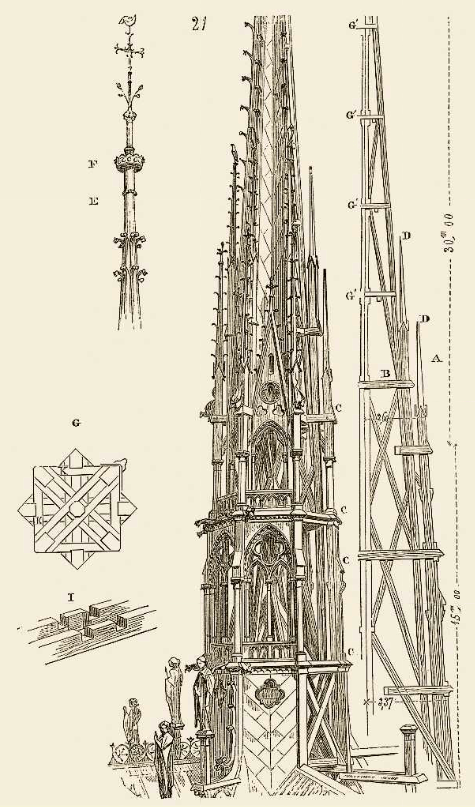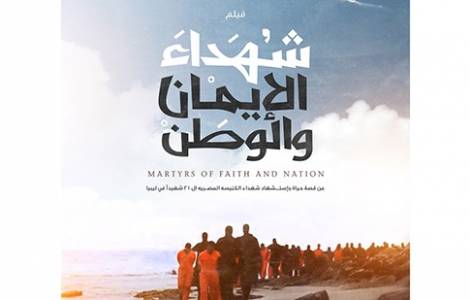De
Sainte-Sophie : le pape François "très affligé" par la décision turque de convertir l'ex-basilique en mosquée
Le pape s'est exprimé pour la première fois sur la question à l'issue de la prière de l'Angélus, dimanche 12 juillet.
Le pape François s'est dit "très affligé", dimanche 12 juillet, par la conversion de l'ex-basilique Sainte-Sophie en mosquée, décidée par la Turquie. "Ma pensée va à Istanbul, je pense à Sainte-Sophie. Je suis très affligé", a dit brièvement le pape argentin, sortant du discours prévu. Les paroles du pape représentent le premier commentaire du Vatican à la décision turque.
L'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican, avait rapporté la veille de manière factuelle les événements, citant les principales réactions internationales, mais sans commenter.
Une des principales attractions touristiques d'Istanbul
Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle par les Byzantins qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au patrimoine mondial par l'Unesco, et l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul avec quelque 3,8 millions de visiteurs en 2019.
Siège du patriarche (chrétien orthodoxe) de Constantinople a été transformé, la basilique a été convertie en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, puis en musée en 1934 par le dirigeant de la jeune République turque, Mustafa Kemal, soucieux de "l'offrir à l'humanité".
Plusieurs pays, notamment la Russie et la Grèce, qui suivent de près le sort du patrimoine byzantin en Turquie, ainsi que les Etats-Unis et la France, avaient notamment mis en garde Ankara contre la transformation de Sainte-Sophie en lieu de culte musulman, une mesure pour laquelle le président turc Recep Tayyip Erdogan, issu d'un parti islamo-conservateur, milite depuis des années.
Vendredi, après la révocation par le Conseil d'Etat (plus haut tribunal administratif turc) du statut de musée de l'ex-basilique, Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'elle serait ouverte aux prières musulmanes en tant que mosquée le vendredi 24 juillet. Il a rejeté en bloc le lendemain les condamnations internationales.
La directrice de l'organisation de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Audrey Azoulay, a déploré cette décision "prise sans dialogue préalable" concernant "un chef d'oeuvre architectural et un témoignage unique de la rencontre de l'Europe et de l'Asie au cours des siècles".
Le gouvernement grec a condamné "avec la plus grande fermeté" la décision turque, la ministre de la Culture Lina Mendoni la qualifiant de "provocation envers le monde civilisé".
Outre "son impact dans les relations gréco-turques, ce choix "affecte les relations d'Ankara avec l'Union européenne, l'Unesco et la communauté mondiale", a fustigé le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.
Les Eglises orthodoxes réagisssent
Du côté des chrétiens orthodoxes, le patriarche Bartholomée de Constantinople a averti le mois dernier que la transformation de Sainte-Sophie en mosquée pourrait "tourner des millions de chrétiens dans le monde contre l'islam".
"Nous constatons que l'inquiétude des millions de chrétiens n'a pas été entendue", a renchéri le porte-parole de l'Eglise orthodoxe russe Vladimir Legoïda. Le patriarche russe Kirill avait dénoncé dès lundi dernier "toute tentative d'humilier ou de piétiner l'héritage spirituel millénaire de l'Eglise de Constantinople" dont la Russie se considère comme la principale héritière avec la Grèce.
Le Kremlin avait pour sa part relevé que Sainte-Sophie avait "une valeur sacrée" pour les Russes, tout en jugeant que la question de la reconversion ou non du lieu relevait "des affaires intérieures de la Turquie".
Washington s'est dit "déçu" et Paris "déplore" la décision turque, tandis que le Conseil oecuménique des Eglises, qui réunit environ 350 églises chrétiennes, notamment protestantes et orthodoxes, a exprimé samedi son "chagrin et consternation".
Ces nombreuses critiques n'ont cependant pas fait bouger d'un millimètre le président turc. "Ceux qui ne bronchent pas contre l'islamophobie dans leurs propres pays (...) attaquent la volonté de la Turquie d'user de ses droits souverains", a déclaré M. Erdogan samedi au cours d'une cérémonie en visio-conférence. "Nous avons pris cette décision non pas par rapport à ce que les autres disent mais par rapport à nos droits, comme nous l'avons fait en Syrie, en Libye et ailleurs", a-t-il ajouté.