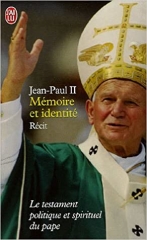 En relisant « Mémoire et Identité » qui constitue le testament spirituel (l’ouvrage fut publié chez Flammarion en 2005) de ce grand pape, on comprend mieux encore ses affinités avec son proche collaborateur le futur Benoît XVI, et la distance qui les sépare, l’un et l’autre, des intellectuels post-modernes sévissant aujourd’hui, plus que jamais, en Europe. Extraits choisis d’une pensée qui fâche un monde qui a cessé d’être chrétien :
En relisant « Mémoire et Identité » qui constitue le testament spirituel (l’ouvrage fut publié chez Flammarion en 2005) de ce grand pape, on comprend mieux encore ses affinités avec son proche collaborateur le futur Benoît XVI, et la distance qui les sépare, l’un et l’autre, des intellectuels post-modernes sévissant aujourd’hui, plus que jamais, en Europe. Extraits choisis d’une pensée qui fâche un monde qui a cessé d’être chrétien :
1.- Descartes et les Lumières : à la source de l’enracinement des idéologies du mal dans la pensée philosophique européenne (pp. 19 à 25).
« Je dois me référer ici, déclare le pape Jean-Paul II, à certains faits liés à l’histoire de l’Europe, et de manière particulière à l’histoire de sa culture dominante.
Quand fut publiée l’encyclique sur l’Esprit-Saint [« Dominum et vivificanten, en 1986] certains milieux en Occident ont réagi négativement, et cela d’une manière plutôt vive. D’où venait une telle réaction ? Elle provenait des mêmes origines que celles dont étaient nées, plus de deux cents ans auparavant, les Lumières européennes – en particulier françaises, sans pour autant exclure les Lumières anglaises, allemandes, espagnoles et italiennes. […]
Pour mieux illustrer un tel phénomène, il faut remonter à la période antérieure aux Lumières, en particulier à la révolution de la pensée philosophique opérée par Descartes.
Le « cogito, ergo sum » (« je pense, donc je suis ») apporta un bouleversement dans la manière de faire de la philosophie. Dans la période pré-cartésienne, la philosophie, et donc le « cogito », ou plutôt le « cognosco » (je connais), étaient subordonnés à l’« esse » (être) qui était considéré comme quelque chose de primordial. Pour Descartes, à l’inverse, l’« esse » apparaissait secondaire, tandis qu’il considérait le « cogito » comme primordial.
Ainsi, non seulement on opérait un changement de direction dans la façon de faire de la philosophie mais on abandonnait de manière décisive ce que la philosophie avait été jusque là, en particulier la philosophie de saint Thomas d’Aquin : la philosophie de l’ «esse». Auparavant, tout était interprété dans la perspective de l’ «esse» et on cherchait une explication de tout selon cette perspective. Dieu, comme Être pleinement autosuffisant (ens subsistens) était considéré comme le soutien indispensable pour tout « ens non subsistens », pour tout « ens participatum », c’est-à-dire pour tout être créé, et donc aussi pour l’homme.
 « La pandémie que nous vivons actuellement est un événement qui pose un immense défi à l’Église.
« La pandémie que nous vivons actuellement est un événement qui pose un immense défi à l’Église.


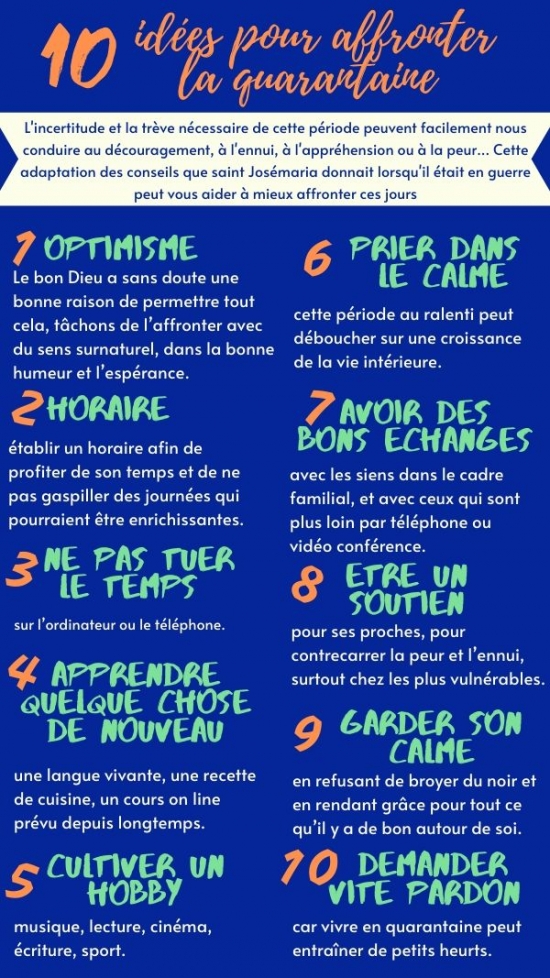
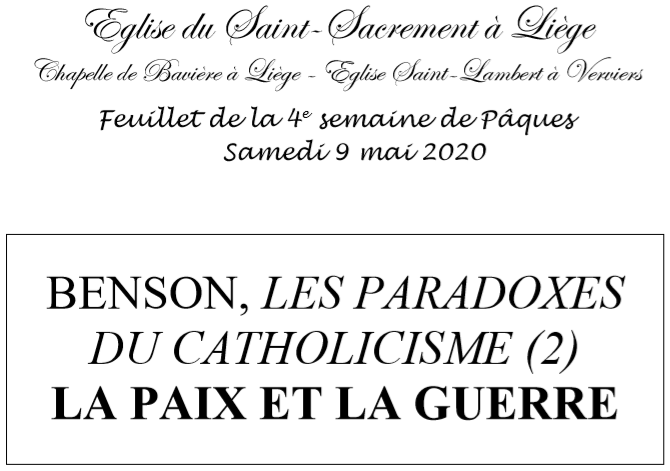
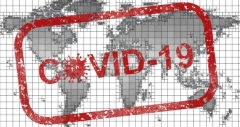 La pandémie de Covid-19 (coronavirus) pousse à s’interroger : comment Dieu peut-il permettre de telles calamités ? La présence du mal, en effet, est l’un des arguments le plus souvent avancés pour refuser l’existence de Dieu. Aucune réponse n’est totalement satisfaisante si l’on n’admet pas une part de mystère. De Paul Clavier sur le site web du mensuel « La Nef » :
La pandémie de Covid-19 (coronavirus) pousse à s’interroger : comment Dieu peut-il permettre de telles calamités ? La présence du mal, en effet, est l’un des arguments le plus souvent avancés pour refuser l’existence de Dieu. Aucune réponse n’est totalement satisfaisante si l’on n’admet pas une part de mystère. De Paul Clavier sur le site web du mensuel « La Nef » :