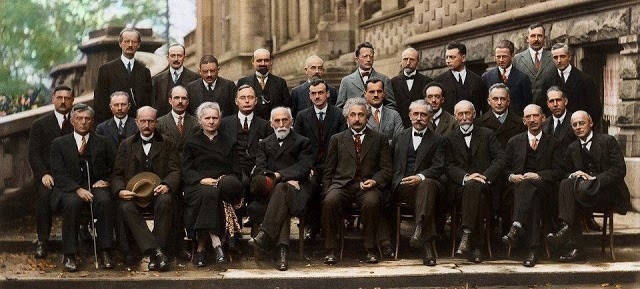De Stefano Fontana sur le site de la Nuova Bussola Quotidiana :
Le drame d'une Église qui s'exile et d'un Dieu inutile
10-08-2020
"Il Mulino" constate que l'Eglise est devenue inutile. Mais pour la revue bolognaise, c'est une qualité car ce n'est plus le salut du Christ qui compte, mais une "proximité religieuse de l'humain" suffit.
Le numéro 509 du magazine "Il Mulino", distribué actuellement, est entièrement consacré à "Et maintenant ? L'Italie de la post-émergence". Comme on le sait, la revue bolognaise est une expression du progressisme en général et du catholicisme en particulier et a derrière elle le "pouvoir" des Editions del Mulino : par là passe plus ou moins toute l'intelligentsia qui compte. Marcello Neri, théologien et professeur à l'Institut des Sciences Religieuses G. Toniolo de Modène, a écrit un article au titre intéressant : "La religion inutile" (pp. 489-496). Voyons pourquoi "inutile" selon lui (et selon nous).
Pendant l'urgence du coronavirus, beaucoup, y compris la Nuova Bussola Quotidiana, avaient critiqué l'Église italienne précisément pour cela : avoir manifesté la futilité de la religion (catholique). Elle a fermé les églises avant que le gouvernement ne le lui demande, elle a accepté la législation civile dans le domaine liturgique, elle a accepté la violation du Concordat, elle n'a pas bronché devant des règles manifestement absurdes et illogiques, elle n'a pas réagi bien qu'elle ait été traitée bien plus mal que les pizzerias, elle a appliqué des règles encore plus strictes que celles émises en devenant ainsi l'Église de l'État, elle n'a pas critiqué la fausseté instrumentale de l'appel politique aux soi-disant experts, elle a indiqué, dans le respect de la distance sociale, la manière de témoigner de l'amour du prochain sans penser qu'elle collaborait ainsi aux conséquences négatives des mesures elles-mêmes, elle a accepté les décisions administratives comme une vérité absolue et, surtout, elle a déclaré que Dieu n'avait rien à voir avec la pandémie.
Mon curé a répété plusieurs fois depuis l'autel que Dieu ne punit pas avec des épreuves mais nous donne la force de les affronter. Ainsi, Dieu n'est plus le Tout-Puissant mais devient un animateur moral et social. Tout ce qu'Il peut faire, Il le fait à travers nous, mais ensuite Il ne peut rien faire. Il s'agit en fait d'un Dieu immanent et non plus transcendant. Ainsi qu'un Dieu impuissant : le salut ne vient pas de Dieu mais des médecins et du gouvernement. La religion s'est donc exilée : églises fermées, pas de processions propitiatoires, pas de prières.
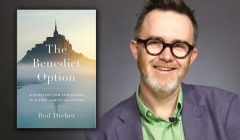 Rod Dreher est un journaliste et écrivain américain, éditorialiste à l’American Conservative. Il a publié
Rod Dreher est un journaliste et écrivain américain, éditorialiste à l’American Conservative. Il a publié 





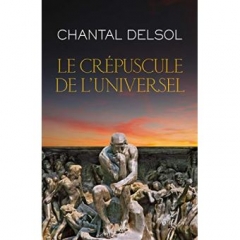 « Chantal Delsol, bien connue de nos lecteurs, a publié Le crépuscule de l’universel, essai remarquable dont elle nous parle ici. Entretien :
« Chantal Delsol, bien connue de nos lecteurs, a publié Le crépuscule de l’universel, essai remarquable dont elle nous parle ici. Entretien :