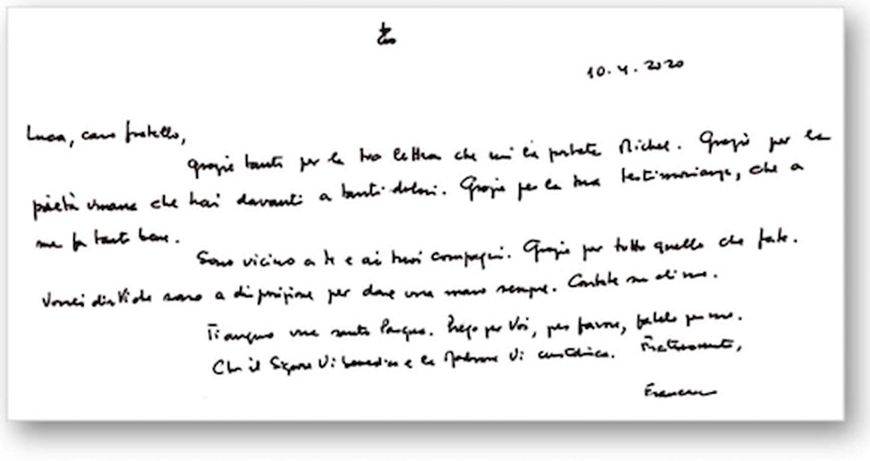De Paris.Catholique.fr :
Homélie de Mgr Michel Aupetit - Vigile pascale à St Germain l’Auxerrois (Paris 1er) (à huis-clos)
Samedi 11 avril 2020
– Solennité de la Résurrection du Seigneur – Vigile pascale – Année A
- 7 lectures de la Vigile ; Rm 6, 3b-11 ; Mt 28, 1-10
Une pierre roulée, un tombeau vide ? C’est tout ? Ah non, c’est un peu court jeune homme, on espère bien d’autres choses en somme. Il nous faut du concret, du palpable, du démontrable. Depuis toujours il nous faut des certitudes, des réponses certaines. Et nous avons l’impression que le Seigneur ne nous laisse qu’avec des questions. Où est-il ce corps ? Comment peut-on le rencontrer ce Jésus ressuscité ? Comment le saisir ? Car nous avons besoin de saisir les choses pour être sûr qu’elles existent. Le Seigneur ne nous a laissé comme signe objectif de sa présence que ce morceau de pain sur lequel il a dit « Ceci est mon corps ». Mais nous voudrions pouvoir le vérifier, le soumettre à l’analyse chimique, savoir comment la matière organique de ce pain est devenu le corps de Jésus ressuscité.
C’est la grande question éternelle que Pilate pose : « Qu’est-ce que la vérité » ? Pour nous, la vérité doit être enfermée dans nos capacités de connaître, dans notre cerveau. S’il n’en est pas ainsi nous ne pouvons pas croire aux réalités qui nous entourent. C’est toute la démarche du positivisme et du scientisme du 19e siècle qui reléguaient la religion dans le domaine des superstitions. La science des hommes pourrait tout expliquer, disait-on. Beaucoup pensent encore ainsi. Et pourtant…
Il a fallu qu’un scientifique nous démontre que l’objet observé est modifié par l’observateur. Le temps et l’espace ne sont plus absolus mais varient en fonction de la vitesse de l’observateur. C’est la loi de la relativité restreinte d’Einstein. Nous pensions pouvoir tout connaître de la matière en particulier dans ses particules les plus minuscules. Or, Heisenberg a démontré qu’il nous est impossible de connaître en même temps la masse et la vitesse de cette particule. C’est le principe d’incertitude. Comment est-il possible qu’il y ait de l’incertitude dans les matières scientifiques ? Il faut donc se reporter sur les équations qui, elles, ne nous trompent pas. Hélas, il a fallu qu’un petit Autrichien vienne nous dire, en le démontrant avec des équations mathématiques, qu’il y a des réalités qui sont indémontrables. C’est le théorème de Godël qu’on appelle aussi le théorème d’incomplétude. Même l’astrophysique nous dit scientifiquement que nous n’avons aucune idée de 96 % du contenu de l’univers. Force est de constater qu’il nous est impossible d’enfermer le réel dans le tout de nos connaissances. Où est la vérité ?
C’est qu’il nous faut découvrir que la vérité n’est pas un concept. Non, la vérité, c’est une personne. Pilate était en face de la vérité. Il ne l’a pas connue. La vérité ne s’enferme pas dans un cerveau humain, la vérité se découvre dans une personne : « Je suis la vérité ». Autrement dit, la vérité ne peut se découvrir que dans une relation. Cette relation, dans la Bible, nous venons de l’entendre, s’appelle une alliance. C’est l’histoire de cette alliance que nous venons d’entendre et qui révèle la vérité de la création, la vérité de l’homme, la vérité de Dieu.
Il y a une alliance initiale qui relie la créature à son créateur. Cette alliance est décrite dans le récit de la création. Elle donne à l’homme d’accueillir la vie divine. C’est le sens même de l’arbre de la vie auquel il a accès. Mais, dans une relation chacun doit rester à sa place. Quand la créature veut se faire « créateur » et que l’homme veut « devenir comme Dieu » décrétant lui-même le bien et le mal, la rupture est consommée et la vérité n’entre pas en lui.
Alors Dieu va proposer une alliance avec un homme, Abraham. Une rencontre qui va permettre de refonder la vérité et la vie. Alors que les Cananéens sacrifient leurs enfants au dieu Moloch Baal et que tant de civilisations, comme les Aztèques, pensent que la fécondité ne peut naître que de la mort, Dieu va arrêter le bras d’Abraham en lui montrant que seule la confiance totale en lui est source de vie. Pourtant, cette tentation de supprimer la vie naissante demeure encore aujourd’hui avec l’avortement généralisé. Non plus en raison d’une recherche hypothétique de la fécondité, mais au nom de la liberté. « O liberté que de crime on commet en ton nom » disait déjà Madame Rolland en montant à l’échafaud.
« La vérité vous rendra libre ». C’est une nouvelle rencontre avec la vérité, une alliance de Dieu avec un peuple guidé par un homme choisi, Moïse, qui va nous révéler comment la liberté nous conduit à la vie. Ce peuple conduit par Moïse va sortir de l’esclavage en traversant les eaux de la mer. Ces eaux qui, traditionnellement, sont le signe de la mort, vont s’écarter pour laisser passer la vie. C’est la figure du baptême où nous sommes plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui (Rm 6).
Car c’est bien lui, le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Après la rencontre d’un peuple avec le Seigneur, c’est bien l’alliance ultime de Dieu avec l’ensemble de l’humanité que va réaliser la rencontre sublime des deux en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme. C’est lui, et lui seul, qui est le chemin qui mène à la vérité pour que jaillisse la vie.
Cette compréhension fondamentale de la fête de Pâques nous permet de comprendre enfin qui nous sommes. Chacun de nous devient une vérité pour lui-même. Ma vérité, c’est que je suis né d’une relation d’amour de mes parents. M’ont-ils désiré ? Ont-ils souhaité que cette relation fût fécondante ? Peu m’importe. Si je suis né d’une relation d’amour, normalement je ne peux être qu’aimé. C’est ainsi que j’ai compris un jour que je suis né d’une relation d’amour encore plus fondamentale : la Trinité. La communion d’amour entre le Père, le Fils et le Saint Esprit est l’acte d’amour premier de mon existence et de la vôtre. C’est notre vérité fondatrice et fondamentale.
Ceci éclaire d’une lumière fulgurante ce que nous fêtons cette nuit. La vie indestructible ne peut jaillir que d’un amour infini. C’est la Pâque du Seigneur, la révélation ultime de notre vocation.
+Michel Aupetit, archevêque de Paris.
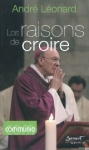 En concluant son essai apologétique « Les raisons de croire » publié chez Fayard (1e édition en 1987) Mgr André Léonard, alors professeur de métaphysique et de philosophie à l’UCL, illustre ces questions que posent déjà des enfants eux-mêmes lorsque leur conscience s’éveille à l’étrangeté de la condition humaine :
En concluant son essai apologétique « Les raisons de croire » publié chez Fayard (1e édition en 1987) Mgr André Léonard, alors professeur de métaphysique et de philosophie à l’UCL, illustre ces questions que posent déjà des enfants eux-mêmes lorsque leur conscience s’éveille à l’étrangeté de la condition humaine : L’Église catholique doit sortir de son confinement spirituel, estime Tomás Halík, prêtre issu de l’ « Eglise clandestine » tchèque créée sous le régime communiste (*) et professeur de sociologie à l’Université Charles de Prague . Concernant les effets sociaux de la pandémie du coronavirus, le site web du magazine « La Vie » publie la traduction d’un article du professeur Halik, suscitant déjà le débat en Europe et aux Etats-Unis :
L’Église catholique doit sortir de son confinement spirituel, estime Tomás Halík, prêtre issu de l’ « Eglise clandestine » tchèque créée sous le régime communiste (*) et professeur de sociologie à l’Université Charles de Prague . Concernant les effets sociaux de la pandémie du coronavirus, le site web du magazine « La Vie » publie la traduction d’un article du professeur Halik, suscitant déjà le débat en Europe et aux Etats-Unis :