
À l’occasion des manifestations en hommage à l’Afro-américain George Floyd, plusieurs statues ont été déboulonnées ou vandalisées. La sociologue Isabelle Barbéris (*) y voit "l’expression psychodramatique de la culpabilité devenue folle", au détriment de la complexité des événements historiques. Une interview réalisée par Marine Carballet et publiée sur le site web « Figarovox » :
FIGAROVOX.- Des vidéos de manifestants déboulonnant ou taguant des statues un peu partout dans le monde fleurissent sur les réseaux sociaux...
Isabelle Barbéris.- Vandalisme et déboulonnage font forcément polémique et sont des épisodes classiques des périodes de guerre (le régime de Vichy a fondu plus de 1000 statues pour en récupérer le métal) ainsi que des changements de régime. Les gestes destructeurs sont ceux qui soulèvent le plus d’émotion mais il faut les appréhender dans un contexte plus large de recomposition des imaginaires: ces statues dont on oublie le nom, que bien souvent l’on ne voit plus et dont certaines sont à l’abandon, peuvent aussi se recharger de sens politique: l’on a vu de nombreuses statues, de gloires locales ou de Jeanne d’Arc, revêtir un gilet jaune.
Les statues nous rappellent le caractère fragile de l’unité nationale.
Il existe aussi un vandalisme permanent, comme celui qui s’en prend aux effigies de Du Guesclin, cible régulière des autonomistes bretons. Les statues nous rappellent le caractère fragile de l’unité nationale. Contrairement à ce qu’elles pourraient laisser penser, l’histoire n’est pas inscrite dans le marbre et la victoire de la République sur les anti-Lumières n’est jamais acquise.
On veut effacer du domaine public la représentation des hommes à la gloire de qui les statues ont été érigées. Mais est-ce que ces revendications ne dépassent-elles pas la statuaire?
Les manifestations actuelles expriment une polarisation religieuse et identitaire du vandalisme. La globalisation a entrainé de nouveaux phénomènes d’iconoclasme: la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan précéda de peu le 11 Septembre. L’affaire de la statue du Général sécessionniste Lee à Charlottesville en 2017 avait déjà mis en lumière un contexte nord-américain très tendu opposant le mouvement Black Lives Matter à des suprémacistes blancs trumpistes. Récemment dans l’Hérault, des militants d’Objectif France se sont enquis de «redresser» la croix du Pic Saint Loup dessoudée par un groupuscule se présentant comme laïque. Tous ces exemples sont des symptômes variés du nouvel âge identitaire. Dans le cas du déboulonnage des statues de Victor Schœlcher, l’expression identitaire s’est substituée au débat mémoriel, en réduisant l’histoire de l’abolition à la couleur de peau et en imposant une conception dévoyée, indigéniste, de l’antiracisme. Cette conception avilie refuse d’envisager l’antiracisme comme un processus historique, et cherche à alimenter les tensions ethniques en absolutisant la dimension forcément imparfaite des épisodes passés de l’émancipation des peuples.
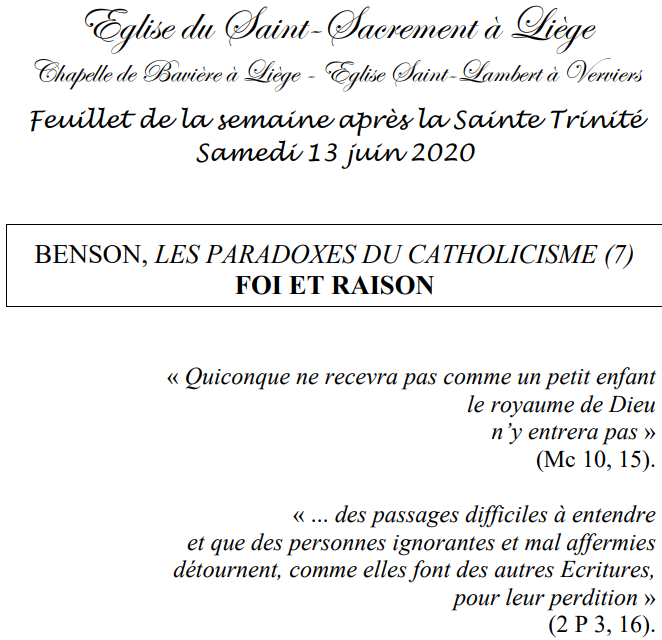


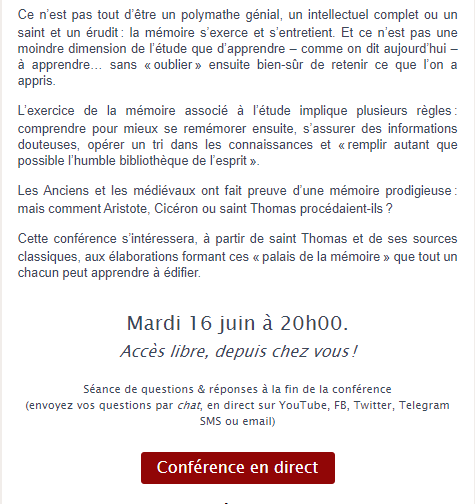



 « 29 mai 2020 ( LifeSiteNews ) - Mgr Georg Bätzing, Président de la Conférence épiscopale allemande, a insisté sur le fait que le rejet des femmes prêtres par les papes récents n'est pas concluant et qu'il doit y avoir plus de discussions «car la question est présente, au milieu de l'Église »!
« 29 mai 2020 ( LifeSiteNews ) - Mgr Georg Bätzing, Président de la Conférence épiscopale allemande, a insisté sur le fait que le rejet des femmes prêtres par les papes récents n'est pas concluant et qu'il doit y avoir plus de discussions «car la question est présente, au milieu de l'Église »!