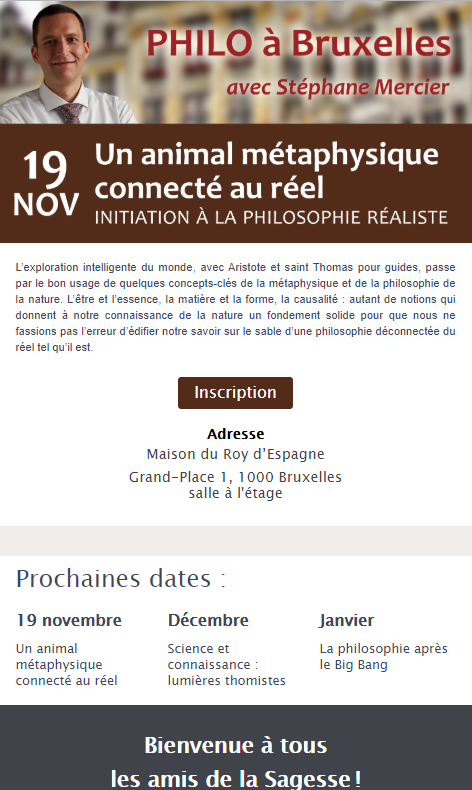Jean Ferré, le fondateur de Radio Courtoisie, conseillait à ses « patrons d’émission » de n’organiser des débats qu’entre des interlocuteurs partageant les mêmes convictions. Suggestion qui peut sembler paradoxale, voire burlesque d’un premier abord, mais qui mérite réflexion. Alasdair MacIntyre, le grand penseur qui a donné un nouveau souffle à la philosophie morale, a montré avec une argumentation serrée que le débat n’est réellement possible qu’à l’intérieur d’une tradition de pensée, elle-même incarnée dans une communauté de pratique. Plus simplement, disons que sans un accord minimal sur les principes (tel que la loi naturelle), les normes, les langages, un échange rationnel est illusoire.
L’une des caractéristiques de la vie politique moderne est qu’elle exclut tout débat sur les principes fondateurs. Recherche intellectuelle et débat politique sont aujourd’hui antinomiques. Les professionnels de la politique excluent toute confrontation avec des questions fondamentales (par exemple la valeur d’un mode de vie) risquant de remettre en cause l’organisation de systèmes oligarchiques qui fonctionnent sous apparence de démocraties. MacIntyre remarque : « Les débats contemporains au sein des systèmes politiques modernes opposent presque exclusivement des libéraux conservateurs, des libéraux centristes et des libéraux de gauche. Cela ne laisse que peu de place pour la critique du système lui-même, c’est-à-dire pour la remise en question du libéralisme » (1). La pluralité des intérêts, la compétition entre groupes rivaux, l’absence d’un niveau suffisant de culture partagée sont telles que toute réflexion sur les finalités et les limites du politique est désormais impossible. Faute d’une poursuite d’un bien commun, ne subsistent que des rapports de force et des jeux de pouvoir.
Le cas exemplaire de la bioéthique
De fait, l’exemple des controverses sur la réforme des lois de bioéthique illustre cette thèse. Il n’y a eu que des simulacres de débats manipulés par l’appareil idéologique d’État (Comité consultatif national d’éthique, États généraux de la bioéthique, Conseil d’État, Parlement…) et les gros médias qui s’y rattachent n’ont en rien modifié le projet de loi initial voulu par le pouvoir sous la pression des groupes féministes/homosexualistes. On a constaté une incompréhension radicale sur des notions pourtant élémentaires – comme la paternité – qui paraissaient jusqu’à peu relever d’un gros bon sens unanimement partagé.
L’impossibilité d’un débat authentique – et non d’une joute rhétorique – se constate par la multiplication des procédés diffamatoires. Comme le déclarait justement Alain Finkielkraut, « si aujourd’hui vous trouvez à redire à la procréation médicalement assistée pour toutes et tous, vous êtes immédiatement désigné comme réactionnaire. Mais c’est un coup très dur porté à la démocratie au premier sens, parce que comment voulez-vous déployer une véritable conversation civique si l’un des deux points de vue est immédiatement discrédité en tant qu’antidémocratique ? C’est toujours la démocratie contre ses ennemis » (2). Et d’évoquer les listes noires qui s’allongent sans cesse de penseurs qui mettent plus ou moins en cause la vision progressiste de l’histoire – vieux procédé stalinien, si l’on se souvient des imprécations communistes contre les « bourgeois » et « réactionnaires », mais que pratiquaient déjà les Jacobins sous la Terreur. Deviennent ainsi réactionnaires des penseurs insuffisamment à gauche comme les Girondins au temps des sans-culottes.
Si le débat entre tenants de traditions de pensée rivales est impossible, il conviendrait que les évêques comprennent que la production de documents tels que ceux de la commission de bioéthique animée par Mgr Pierre d’Ornellas est inefficace ad extra, en dehors de la communauté chrétienne. Évidemment, cela ne signifie pas pour autant que l’effort intellectuel soit superflu car, pourvu qu’elle soit correctement menée, la réflexion peut être utile ad intra, pour enrichir les catholiques. Une tradition de pensée, pour demeurer vivante, doit d’ailleurs évoluer, se confronter à ses propres difficultés (MacIntyre explique que lorsqu’elle n’y parvient plus, elle meurt). Il est d’ailleurs fort souhaitable que les chrétiens retrouvent le goût et la pratique du débat intellectuel, philosophique et théologique, en évitant les méthodes injurieuses de la police de la pensée.
Denis Sureau
(1) Quelle justice ? Quelle rationalité ? Puf, 1993, p. 423.
(2) Répliques, France culture, 28 septembre 2019.
Denis Sureau est directeur de la lettre Chrétiens dans la Cité et du mensuel de catéchèse Transmettre. Il est aussi l’auteur de Pour une nouvelle théologie politique (Parole et Silence, 2008).


 On peut presque toujours prévoir les limites, l’objet et le langage particulier des synodes. Mais un nouveau terme susceptible d’être significatif a émergé lors des derniers jours du Synode de l’Amazonie. Selon certains les participants au synode ont parlé de changement de mentalité : nous ne penserions plus être les seigneurs et maîtres de la nature, mais ne serions que des ”visiteurs” en ce monde.
On peut presque toujours prévoir les limites, l’objet et le langage particulier des synodes. Mais un nouveau terme susceptible d’être significatif a émergé lors des derniers jours du Synode de l’Amazonie. Selon certains les participants au synode ont parlé de changement de mentalité : nous ne penserions plus être les seigneurs et maîtres de la nature, mais ne serions que des ”visiteurs” en ce monde.