En très haut lieu, on a sans doute cru que l'expression de la volonté pontificale suffirait à faire accepter la refonte de l'Institut mais il n'en va pas ainsi comme le montre cet article publié sur le site du journal La Croix :
L’Institut Jean-Paul II pour la famille au cœur d’une vive polémique
Le pape a approuvé le 18 juillet de nouveaux statuts qui entérinent la refonte de cet institut voulu par le pape polonais pour promouvoir la recherche théologique sur le mariage, la famille et la sexualité.
Une refonte complète qui a suscité de vives réactions parmi les étudiants et les enseignants dont certains ont été écartés.
- Céline Hoyeau,
- le 02/08/2019
Une centaine d’articles en quelques jours sur des sites Internet italiens et américains principalement. La publication des nouveaux statuts de l’« Institut pontifical théologique Jean-Paul-II pour les sciences du mariage et de la famille », approuvés par le pape François le 18 juillet, a déclenché une salve de critiques sans précédent, qui dénoncent une « épuration » des professeurs et ce qui est vu comme la liquidation de l’héritage de Jean-Paul II. Un« nouveau sac de Rome », ose même le célèbre biographe nord-américain du pape polonais, George Weigel, fustigeant le « vandalisme intellectuel en cours ».
En cause, le départ de plusieurs figures phares de l’institut, notamment les deux professeurs de théologie morale fondamentale, Mgr Livio Melina, l’ancien président de l’institut dont la chaire est supprimée, et le père José Noriega. Et la « perte d’identité » de l’Institut dont s’inquiètent les étudiants dans une lettre adressée le 25 juillet à la direction.
« Bien que le pape François exprime (…) son désir de continuer avec l’inspiration originale de Jean-Paul II, (…) nous sommes surpris parce que, dans le nouveau système d’étude, il n’y a ni discussion ni cours sur la théologie du corps ou sur l’enseignement de Jean-Paul II », peut-on lire dans cette lettre qui a recueilli sur Internet 535 signatures, dont 119 étudiants.
L’intuition « originale et toujours féconde » du pape polonais
L’institut a aussitôt réagi par un long communiqué, le 29 juillet, reprenant point par point les critiques, et dénonçant « une information distordue, partiale et parfois de mauvaise foi, qui n’a même pas cherché une vérification à la source des informations ».
Les nouveaux statuts veulent simplement donner une « nouvelle vigueur » à l’intuition « originale et toujours féconde » du pape polonais. La suppression de l’enseignement de théologie morale fondamentale est justifiée par le fait qu’elle appartient au premier cycle des études théologiques et que l’institut, qui a vocation à s’intégrer davantage dans le système universitaire, accueillera des étudiants de niveau licence et doctorat. Le projet académique du nouvel Institut, assure encore le communiqué, se configure comme « un élargissement de la réflexion sur la famille et non comme une substitution de thèmes ». Le communiqué réfute en outre les accusations de centralisation des pouvoirs dans les mains du chancelier, Mgr Vincenzo Paglia, « à qui des tâches précises sont attribuées ».
Sur le fond, cette polémique cristallise les tensions nées autour de la réflexion menée par l’Église, depuis le double synode de 2014-2015, sur la famille, le mariage et la sexualité humaine. De fait, la refonte de l’institut exprime clairement l’infléchissement de la ligne théologique voulue par François.
Tenir étroitement unies « l’intelligence de la foi » et le « principe de réalité »
Il y a deux ans, le pape appelait cet institut, axé sur la théologie morale et sur une approche métaphysique soupçonnée d’idéalisme abstrait, à renouveler son regard pour mieux prendre en compte la complexité de l’existence et les situations concrètes, en intégrant davantage les sciences humaines.
S’il n’y a pas de « prise de distance avec les inspirations de Jean-Paul II », expliquait alors Mgr Paglia, François « élargit la perspective, d’une focalisation seulement sur la théologie morale et sacramentelle à une vision biblique, dogmatique et historique qui tient compte des défis contemporains ». Si elle ne veut pas être « idéologique ou autoréférentielle », mais « libre de rester rigoureusement cohérente avec le témoignage de la vérité », la recherche théologique doit tenir étroitement unies « l’intelligence de la foi » et le « principe de réalité », confirmait ainsi son nouveau directeur, le théologien milanais Pierangelo Sequeri, en présentant les nouveaux statuts le 18 juillet.
Une refonte menée « de manière improvisée, sans consultation des enseignants »
Mais les héritiers de Jean-Paul II redoutent un « changement de paradigme » sur la famille et la sexualité, où la prise en compte de la complexité des parcours se substituerait à la « doctrine » et à des normes morales « absolues ». Certains critiques n’hésitent pas à opposer une vision dogmatique – et « orthodoxe » – de Jean-Paul II à une vision existentielle de François, incarnée dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia.
« Sur cette réorientation, on peut être d’accord ou non, mais la manière dont cette réforme est effectuée d’un point de vue humain est affligeante », déplore un enseignant de l’institut. Vécue violemment, cette refonte, menée « de manière improvisée, sans consultation des enseignants », dont certains en ce début août, en charge de famille, ignorent toujours si leurs cours seront maintenus à la rentrée, risque de passer tout aussi mal que celle de Radio Vatican menée, à ses débuts, avec pertes et fracas.
---
Des antennes sur tous les continents
1981 : Jean-Paul II crée l’Institut pontifical Jean-Paul-II d’études sur le mariage et la famille, pour promouvoir la recherche théologique sur le sujet.
L’institut qui publie la revue Anthropotes a des antennes sur tous les continents : Rome, Washington, Cotonou (Bénin), Salvador de Bahia (Brésil), Melbourne (Australie)...
19 septembre 2017. Par une lettre apostolique (Summa familiae cura), le pape François redéfinit la mission de l’institut rebaptisé «Institut pontifical théologique Jean-Paul-II pour les sciences du mariage et de la famille». Avec pour objectif de mêler davantage dans ses travaux théologie et sciences sociales.

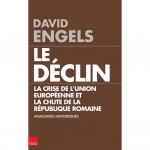 Dans un cycle de conférences organisé en 2017 à l’ULg par le Groupe de réflexion Ethique sociale et l’Union des étudiants catholiques de Liège sur le thème « L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain », David Engels avait déjà présenté au public réuni dans la salle des professeurs de l’ "Alma Mater" liégeoise un premier livre, intitulé « Le Déclin », pour mettre en lumière des analogies historiques entre la crise de l’Union européenne et la chute de la république romaine à la fin du 1er siècle avant J.C.
Dans un cycle de conférences organisé en 2017 à l’ULg par le Groupe de réflexion Ethique sociale et l’Union des étudiants catholiques de Liège sur le thème « L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain », David Engels avait déjà présenté au public réuni dans la salle des professeurs de l’ "Alma Mater" liégeoise un premier livre, intitulé « Le Déclin », pour mettre en lumière des analogies historiques entre la crise de l’Union européenne et la chute de la république romaine à la fin du 1er siècle avant J.C. 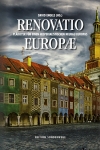 l’U.L.B., avant d’être appelé à l’Institut Zachodni de Poznan, en tant que professeur chargé de recherche pour l’analyse de l’histoire intellectuelle de l’Occident.
l’U.L.B., avant d’être appelé à l’Institut Zachodni de Poznan, en tant que professeur chargé de recherche pour l’analyse de l’histoire intellectuelle de l’Occident. 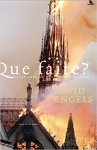 l’avenir et, surtout, léguer notre héritage en danger à nos descendants…
l’avenir et, surtout, léguer notre héritage en danger à nos descendants… 

