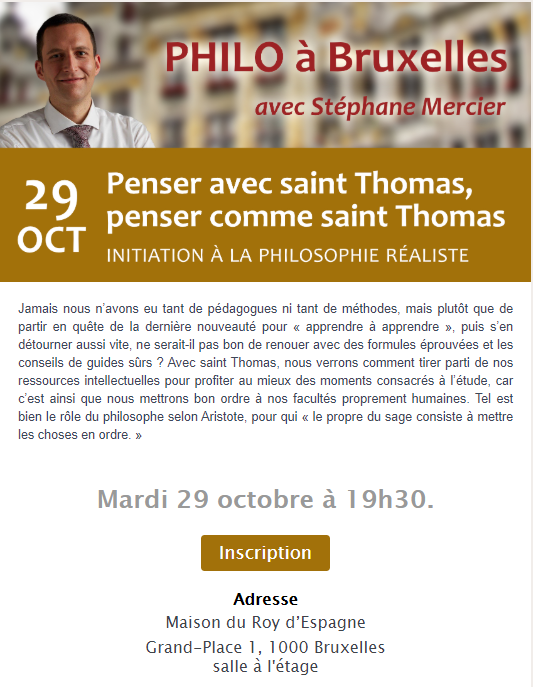Les scénarios les plus pessimistes prévoient une hausse des températures de l'ordre de 6,5 à 7°C à l'horizon 2100, ce qui ne manquera pas de bouleverser les fragiles équilibres de la Terre et du vivant. Selon les derniers rapports de l'ONU, près d'un million d'espèces seraient aujourd'hui menacées d'extinction.
Et pendant ce temps, les députés français parlent procréation médicalement assistée, filiation et parentalité, tri des embryons. Nous pourrions légitimement nous demander, si ces sujets valent bien le temps que nous passons à en débattre, en France comme en Belgique. Après tout, quel pourcentage de la population est véritablement concerné par ces enjeux? Qui fait appel à la procréation médicalement assistée ou à la gestation pour autrui? 1% de la population? Peut-être moins. Et pourtant...
Les chrétiens se portent souvent en première ligne sur ces délicates questions sociétales. La notion de dignité humaine, dans l'anthropologie chrétienne, entre en contradiction violente avec la technicisation/marchandisation de la procréation telle qu'on l'observe dans les enjeux bioéthiques. Lorsqu'on considère l'être humain comme infiniment digne, on ne peut tolérer que sa naissance devienne l'objet d'un contrat de vente, on ne peut tolérer que l'utérus d'une femme, lieu sacré entre tous, devienne moyen de production. L'opposition aux pratiques de la PMA et de la GPA va cependant bien au-delà du monde chrétien.
Sylviane Agacinski, philosophe, féministe de gauche et femme de Lionel Jospin, déplore dans un livret synthétique publié aux éditions Gallimard ce passage dans la conscience moderne d'une conception de l'homme incarné à la vision d'un homme fabriqué. La députée française Agnès Thill (La République en Marche) s'est, elle aussi, engagée tout au long des discussions sur la PMA pour redire "qu'on ne s'offre pas un être humain. Un être humain n'est pas un objet ni un projet".
Chez nous en Belgique, Viviane Teitelbaum (MR), députée bruxelloise engagée de longue date pour la cause féministe, dénonce l'aliénation de la femme inhérente à la pratique de la gestation pour autrui. Elle l'a redit ce week-end, à l'occasion de la "bourse aux bébés" qui se tient maintenant chaque année à Bruxelles.
En vérité, les nouvelles pratiques entourant la procréation amenées sous les pressions conjointes du droit, du marché et de la technique dessinent ou imposent une nouvelle anthropologie : une conception d'un corps modulable à souhait, un corps vu comme matière première que la technique peut utiliser ou transformer. Et tout l'enjeu est là : il est question d'un bouleversement anthropologique de grande ampleur. Peut-on dès lors, comme nous l'avons fait en Belgique, s'octroyer le luxe de laisser de côté cette question cruciale?
Cette rupture anthropologique s'observe, et depuis plus longtemps, dans de tout autres domaines que le champ de la bioéthique. Les dérives de notre économie ou le dérèglement climatique ne procèdent-ils pas, eux aussi, d'un rapport dégradé de l'homme avec son environnement et avec lui-même?
Nous avons cru trop longtemps que la nature constituait uniquement un gigantesque réservoir de ressources laissées à notre libre disposition. Par la technique et le marché, nous avons ainsi transformé le monde qui nous entourait en le mettant au service de nos désirs et besoins les plus divers, sans souci des équilibres du vivant ou de la régénération des ressources.
Transformée, la matière première extraite de notre environnement est devenue marchandise et bien de consommation. Nature consommée, nature consumée : la mise en servitude du monde par l'Homme en vient aujourd'hui à menacer les équilibres de notre biosphère... et les conditions d'une vie authentiquement humaine sur Terre.
Notre système économique a longtemps été aussi, et est toujours dans trop d'endroits et trop souvent, un lieu d'aliénation de la personne, exploitée, instrumentalisée, marchandée : bafouée dans son intime dignité d'être humain. Exploitation des ressources et des personnes au profit d'un petit nombre de firmes et de personnes, mais aussi et souvent d'un grand nombre de consommateurs de par le monde : ce sont là les conséquences d'un système, qui a certes amené son lot de progrès sociaux et scientifiques, mais qui révèle aujourd'hui ses insuffisances.
Ce que révèlent ces mécanismes, c'est le rapport dégradé que nous entretenons avec le monde et avec nous-mêmes, un rapport qui se fonde sur le contrôle, l'appropriation et l'instrumentalisation. On peut parler, pour reprendre un terme utilisé par Heidegger dans sa critique du monde de la technique, d'un arraisonnement du monde.
Les enjeux actuels en bioéthique ne sont-ils pas le prolongement ou l'affleurement de cette vision techniciste du monde, de ce rapport que nous entretenons avec le monde sur le mode de l'arraisonnement? La bioéthique serait alors le lieu par excellence où s'observe cette dégradation de la relation de l'Homme avec lui-même et avec son monde. L'arraisonnement du corps n'est finalement que l'ultime étape d'un processus de mise en servitude du monde et du vivant. Un corps que nous pouvons utiliser comme moyen de production, vendre, louer ou fabriquer, à l'instar de tout le reste. La bioéthique nous révèle ce qu'il y a de faussé dans notre approche du monde. Voilà pourquoi ces enjeux sont cruciaux et pourquoi il convient d'y apporter une réponse ferme et cohérente.
De même que le monde qui nous entoure ne devrait pas être considéré comme un fournisseur de ressources à exploiter, mais d'abord et avant tout comme un lieu à habiter et à bâtir, de même notre corps ne peut être simplement vu comme un bien dont on dispose et dont on use pour assouvir ses désirs. Nous avons à habiter le corps, non comme une enveloppe extérieure qui ne serait pas nous, non comme un artifice ou un accessoire qu'on possède, mais comme une part inhérente de qui nous sommes.
En écologie comme en bioéthique, il nous faut redire la beauté du monde et revenir à une attitude d'émerveillement face à la vie et ses mystères. Il nous faut redire la dignité inaliénable de chaque être humain. Il nous faut redire, tout simplement, qu'il y a en l'Homme quelque chose de grand et de merveilleux à sauver et à préserver et que cela n'a pas de prix.
[1]https://www.franceculture.fr/oeuvre/lhomme-desincarne-du-corps-charnel-au-corps-fabrique
[2]https://www.7sur7.be/famille/manifestation-contre-le-commerce-de-la-gestation-pour-autrui~a746278e/?fbclid=IwAR2lgjGG2meOgeMuU-U24dNsuCkRWIOHrIHDa7b4d_u3ihX-CrHgcnPdfAs
 Le mythe rousseauiste du bon sauvage a-t-il fait long feu au synode sur l’Amazonie ? Lu sur le site de l’agence Kathnet (via une traduction):
Le mythe rousseauiste du bon sauvage a-t-il fait long feu au synode sur l’Amazonie ? Lu sur le site de l’agence Kathnet (via une traduction): 


 Lu sur le site web « atlantico » cette salve d’Edouard Husson publiée le 6 octobre 2019 contre le document préparatoire du "synode amazonien ", le jour même ou le pape François ouvre les portes de cette assemblée à Rome:
Lu sur le site web « atlantico » cette salve d’Edouard Husson publiée le 6 octobre 2019 contre le document préparatoire du "synode amazonien ", le jour même ou le pape François ouvre les portes de cette assemblée à Rome: