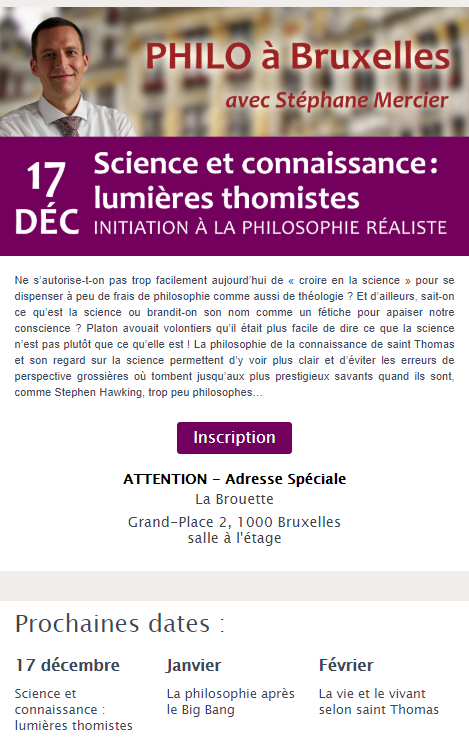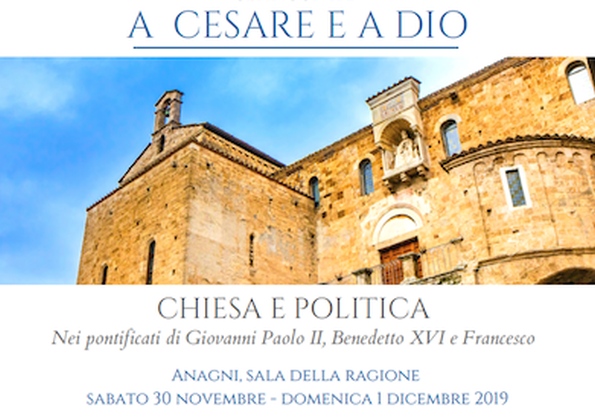Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’Éditorial du bimensuel l’ «Homme Nouveau» sous le titre prudent « Y a-t-il un rapport entre le bien-vivre, l’Onu et l’Amazonie ? » revient en fait sur le culte de la Pachamama, symbole de la Terre-Mère, Gaia, un avatar du new age invité au curieux synode amazonien réuni voici quelques semaines à Rome :
Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’Éditorial du bimensuel l’ «Homme Nouveau» sous le titre prudent « Y a-t-il un rapport entre le bien-vivre, l’Onu et l’Amazonie ? » revient en fait sur le culte de la Pachamama, symbole de la Terre-Mère, Gaia, un avatar du new age invité au curieux synode amazonien réuni voici quelques semaines à Rome :
« Dans le document final du synode sur l’Amazonie (paragraphe 9), il est dit que « la recherche de la vie en abondance chez les peuples autochtones d’Amazonie se concrétise dans ce qu’ils appellent le “bien-vivre” et se réalise pleinement dans les Béatitudes. Il s’agit de vivre en harmonie avec soi-même, avec la nature, avec les êtres humains et avec l’être suprême, car il existe une intercommunication entre le cosmos tout entier, là où il n’existe ni excluants ni exclus. Une telle compréhension de la vie est caractérisée par le lien et l’harmonie des relations entre l’eau, le territoire et la nature, la vie communautaire et la culture, Dieu et les différentes forces spirituelles. »
Le lien avec la Pachamama
Cette référence explicite au bien-vivre des peuples autochtones d’Amazonie donne consistance à l’idée évoquée précédemment (cf. L’HN n° 1699) du lien étroit qui unit ce concept au culte de la Pachamama. De multiples publications universitaires sur les mutations politiques et idéologiques actuellement observables de l’autre côté de l’Atlantique confirment ce lien. Les enjeux s’étendent d’ailleurs bien au-delà du seul cas restreint de l’Amazonie… et même de l’Amérique du Sud. Il en ressort qu’il existe de fortes convergences intellectuelles et militantes enre les paradigmes actuels de la théologie de la libération et la cause mondialiste écologiste, convergences auxquelles la politique onusienne accorde son crédit à travers plusieurs résolutions.
En s’appuyant sur les populations indigènes du monde rural, la théologie libérationniste s’applique à modifier son approche subversive, en faisant de l’écologie son principal thème de revendication. Il est remarquable de trouver la promotion du culte de la Pachamama dès 1988, dans un livre intitulé Théologie de la Terre, écrit par un moine brésilien, toujours très à la mode, Marcelo Barros : « La Pachamama, en tant que représentation symbolique de Dieu, n’est pas idolâtrie, car elle ne sert pas à dominer les pauvres. Elle n’est qu’une médiation du Dieu de la vie. Les fruits de la Terre sont conçus comme le visage de Dieu. Quand on vénère la Terre on vénère Dieu. La Pachamama est en faveur des pauvres, protectrice des faibles. Elle est la mère qui nourrit les hommes »1. Les convergences entre la théologie libérationniste et « l’écologie des pauvres » portent essentiellement sur la dénonciation de l’exploitation de la Terre et de l’idéologie de la croissance, ainsi que sur une approche holistique du monde2. La notion de bien-vivre offre ainsi une base conceptuelle à un projet politique révolutionnaire, présenté comme une alternative au « vivre mieux » matérialiste occidental, capitaliste et colonialiste.

 « Le pape François persiste dans son message progressiste. Lors de ses traditionnels vœux de Noël, l’évêque de Rome a tenu à mettre en garde les chrétiens contre la « rigidité » avec laquelle ils vivaient leur foi, dans un monde où le christianisme est de moins en moins influent, rapporte notamment le mensuel québécois
« Le pape François persiste dans son message progressiste. Lors de ses traditionnels vœux de Noël, l’évêque de Rome a tenu à mettre en garde les chrétiens contre la « rigidité » avec laquelle ils vivaient leur foi, dans un monde où le christianisme est de moins en moins influent, rapporte notamment le mensuel québécois 

 « Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, théologien dogmatique, a été évêque de Ratisbonne (2002-2012), en Allemagne, puis préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi de 2012 à 2017. Il a été chargé par Benoît XVI de l’édition de ses œuvres complètes. Il nous parle ici du synode sur l’Amazonie et de la situation de l’Église en Allemagne. Entretien exclusif.
« Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, théologien dogmatique, a été évêque de Ratisbonne (2002-2012), en Allemagne, puis préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi de 2012 à 2017. Il a été chargé par Benoît XVI de l’édition de ses œuvres complètes. Il nous parle ici du synode sur l’Amazonie et de la situation de l’Église en Allemagne. Entretien exclusif. Une provocation de plus dans l’agitation qui déstabilise l’Eglise universelle ? Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, responsable des affaires religieuses, a suivi tout le synode sur l’Amazonie à Rome. Il témoigne pour le mensuel « La Nef » dans son numéro de décembre 2019 :
Une provocation de plus dans l’agitation qui déstabilise l’Eglise universelle ? Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, responsable des affaires religieuses, a suivi tout le synode sur l’Amazonie à Rome. Il témoigne pour le mensuel « La Nef » dans son numéro de décembre 2019 :