Idées - Page 88
-
Le Manifeste du courant "Pour une écologie humaine"
Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Doctrine Sociale, Economie, environnement, Ethique, Idées, Politique, Société, Solidarité 0 commentaire -
Synode : l’histoire de Vatican II se répète
De Gérard Leclerc sur le site de « France catholique » :
« On ne peut contester sérieusement le fait que ce second synode du pontificat, consacré à la famille, soit traversé de tensions qui impliquent de profondes divergences de vue sur des questions graves. C’est le Pape lui-même qui a souhaité ces affrontements, en encourageant la liberté d’expression des participants. Il n’y a là rien en soi qui doive nous surprendre ou même nous alarmer. Les synodes des précédents pontificats avaient été gérés de telle façon que les dissentiments cèdent le pas à la logique du consensus ecclésial. François a pensé que la nature du sujet traité exigeait des débats plus ouverts, au risque de manifester au-dehors des clivages et même des divisions qui alimentent les spéculations sur le binôme conservatisme/progressisme. Il n’est pas certain que ce dernier soit toujours le plus pertinent, ni même le plus opérationnel pour éclairer les enjeux doctrinaux et pastoraux. C’est sans doute la rançon de la transposition sur le terrain politique des procédures synodales.
Au cours du déroulement de Vatican II, nous avions assisté déjà au même genre de phénomènes, considérablement amplifiés par leur orchestration médiatique. Tout se ramenait aux désaccords entre une majorité et une opposition dont on annonçait la défaite, ainsi qu’il convenait au processus qui commande la victoire du camp du progrès sur celui du passé. Mais du même coup, le véritable travail de fond de l’assemblée se trouvait complètement occulté et le contenu des textes élaborés méconnu. C’était surtout le fait d’une réduction idéologique de ce qu’on a appelé le péri-concile. Cela explique d’ailleurs pour partie la crise post-conciliaire dont la cause première fut le défaut de pédagogie pour exposer la doctrine et les acquis de Vatican II. Rares furent les diocèses qui, à l’instar de celui de Cracovie, déployèrent leurs efforts pour que les principaux documents soient compris et intériorisés.
Il est encore trop tôt pour déterminer si les deux synodes sur la famille déboucheront sur une éclaircie doctrinale analogue à celle du concile. Un échec est même plausible. Certes, il serait douloureusement ressenti, mais il est possible que certaines questions abordées ne soient pas solubles dans les conditions actuelles. On peut également penser que l’assemblée synodale pourrait ouvrir plus facilement des perspectives quant à un investissement supérieur, pour tous les continents en dépit des différences culturelles, dans le domaine de la préparation des jeunes gens au mariage. Plutôt que de se polariser sur les traumatismes de l’échec, conviendrait-il de se mobiliser pour créer les conditions d’un meilleur engagement pour la grande aventure de la vie. Il faudrait pour cela tirer toutes les leçons de l’expérience pastorale, là où elle est le plus ardemment déployée. «
Ref. Un synode difficile
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Idées 0 commentaire -
Vers le meilleur des mondes : nouvel espace pour un adieu "dans la dignité"
Les églises et les messes d’enterrement disparaissent? Tranquillisez-vous. Que demande le peuple ? Voici la solution séduisante, beaucoup plus appropriée à la mentalité pluraliste de l’ère post-moderne: l'espace pour un adieu "dans la dignité". Et de plus, à en croire l'article, « ce type d’espace deviendra probablement bientôt obligatoire dans les communes ». JPSC
Lu sur le site de « La Libre Belgique » :
 « L’échevine en charge des Cimetières de Tournai, Laetitia Liénard (PS), a présenté ce mardi soir le nouvel espace multiphilosophique présent à l’entrée du cimetière du Sud à Tournai. C’est le premier du genre en Belgique.
« L’échevine en charge des Cimetières de Tournai, Laetitia Liénard (PS), a présenté ce mardi soir le nouvel espace multiphilosophique présent à l’entrée du cimetière du Sud à Tournai. C’est le premier du genre en Belgique.Entouré de bambous , l’espace, blanc, est élégant et apaisant. Il est couvert, semi-ouvert, offre une capacité d’accueil de 300 personnes, avec des bancs. Deux pupitres permettent une prise de parole, ainsi que l’écriture des condoléances sur un ordinateur. Cinq écrans et des enceintes permettent la diffusion de photos, de musique et de vidéos. Grâce à cinq caméras, la cérémonie peut être filmée, permettant une diffusion en direct par internet, de telle sorte que des proches retenus à l’étranger, par exemple, peuvent eux aussi participer à l’adieu. Le prix de la location du site est fixé à 150€.
"C’est l’ancien bourgmestre de Tournai, Roger Delcroix, un socialiste mais qui était aussi catholique, qui avait songé à un tel projet car il avait regretté de se retrouver sous une averse bien belge lors d’une cérémonie laïque dans un cimetière", explique Jacky Legge, président de la commission des cimetières de Tournai. "L’idée d’un espace, qui pouvait être multiphilosophique finalement, a ensuite mûri. Le projet a été mis sur pied quand Ludivine Dedonder était alors échevine."
Un appel à projets a été lancé et c’est l’architecte Jacques Desablens qui l’a emporté. "Cet espace est un concept novateur. Le premier en Belgique. Cela permet une cérémonie d’adieu, sans passer nécessairement par un lieu de culte", note encore Jacky Legge.
"C’est un espace de prise de parole, de commémorations, de souvenirs", explique Laetitia Liénard. "Soit on vient avec un cercueil et on fait une cérémonie avant l’inhumation ou une crémation. Soit on vient après la crémation avec l’urne. C’est ouvert à tous les Tournaisiens, mais également aux personnes extérieures de l’entité de Tournai."
L’échevine conclut : "Nous avons été avant-gardistes en la matière. Ce type d’espace deviendra probablement bientôt obligatoire dans les communes."
Ref. Tournai: Un nouvel espace pour un adieu dans la dignité
-
"Foi et philosophies"; s'inscrire aux "Samedis philo" avec Monseigneur Léonard
Samedis philo
Inscrivez-vous au cours de Monseigneur Léonard : "Foi et philosophies" le samedi matin de 9h à 12h d'octobre à février.
Envoyez un mail à l'adresse :

Pour les jeunes (de 18 à 30 ans) Monseigneur Léonard donne un cours de philosophie : "Foi et philosophies"
Il aura lieu à Bruxelles les samedis de 9h à 12h
-le 3 octobre
-le 17 octobre
-le 24 octobre
-le 14 novembre
-le 28 novembre
-le 5 décembre
-le 20 février
-le 27 février
-le 5 mars
-le 12 mars
L'idée générale est de parcourir de manière logiquement organisée les grands courants de la pensée philosophique moderne et contemporaine, d'en discerner les points positifs et moins positifs et d'examiner, de manière critique, leur incidence sur la manière de comprendre la foi et d'élaborer une théologie, c'est-à-dire une compréhension articulée de la révélation chrétienne. Ce qui permet de se situer de manière responsable dans le vaste domaine des courants de pensée actuels.
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Eglise, Enseignement - Education, Idées, Jeunes 0 commentaire -
De Corydalle à Lérins
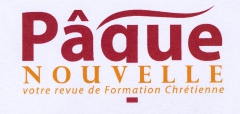
Dans l'homélie du pape, prononcée à la cathédrale de la Havane, lors des vêpres de dimanche dernier, on peut retenir ce passage qui introduit opportunément l’article que voici, à paraître dans le magazine trimestriel « Vérité et Espérance-Pâque nouvelle » (sursumcorda@skynet.be) le 30 septembre prochain : « Il est fréquent de confondre l’unité avec l’uniformité, avec le fait que tous font, sentent et disent la même chose. Cela n’est pas l’unité, c’est l’homogénéité. C’est tuer la vie de l’Esprit, c’est tuer les charismes qu’il a distribués pour le bien de son peuple. L’unité se trouve menacée chaque fois que nous voulons faire les autres à notre image et ressemblance. C’est pourquoi l’unité est un don, ce n’est pas quelque chose que l’on peut imposer de force ou par décret »
« Qu’il soit fidèle, plutôt que
minutieusement profilé... »
(Cf. V&E n° 95, Pâque Nouvelle, p. 16)
 Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...
Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...Plus évocateur que Corydalle sera probablement le nom de Procuste qui y sévissait. Au dire des Anciens, il offrait avenante hospitalité au voyageur de passage ; mais ce n’était là que tromperie : quelqu’un venait-il en effet frapper à sa porte, après un accueil peint d’affabilités, notre homme plaquait soudain le malheureux sur un lit et s’employait aussitôt à l’étirer ou bien à le rogner, dans sa brutale incapacité à le trouver convenable, qu’il ne l’eût mis au gabarit de cette couche idéale.
-
Monseigneur Rey : dialoguer aussi avec Marion Maréchal Le Pen est dans la ligne de l’enseignement de l’Eglise
L’évêque de Fréjus-Toulon ferait-il désordre dans les milieux cléricaux qui aiment les
 périphéries dans les limites de la bien-pensance politiquement correcte ? Réponse du prélat "non conformiste" sur le site web de son diocèse :
périphéries dans les limites de la bien-pensance politiquement correcte ? Réponse du prélat "non conformiste" sur le site web de son diocèse :« Communiqué de Presse du 29 Août 2015
Les réactions de certains medias à propos de l’Université d’été de l’Observatoire socio-politique (OSP) de Fréjus-Toulon conduisent à rappeler les éléments suivants.
Les universités d’été, ouvertes sur inscription, ont été lancées il y a 5 ans par l’OSP de Fréjus-Toulon en lien avec les Dominicains de la Sainte-Baume. Elles sont bâties autour du triptyque suivant : d’abord, la prière, avec la participation aux offices ; ensuite, la formation à la doctrine sociale de l’Eglise avec l’enseignement de Pères dominicains et, cette année, la participation de Mgr Charles Morerod ; enfin, des échanges lors de tables rondes réunissant parmi d’autres des hommes et des femmes politiques de toutes les sensibilités.
Le dialogue est intrinsèque à l’expression de notre Foi. L’actualité mondiale le montre bien : tout refus de dialogue entretient le fanatisme et attise la guerre. Le refus de dialoguer constitue aussi un symptôme de faiblesse de la pensée. Que ce soit dans l’ordre politique, social et religieux, la paix et le vivre ensemble requièrent le dialogue. Jésus Lui-même a engagé un dialogue avec ses contradicteurs et ses adversaires tout au long de Sa vie publique. Sans dialogue, on tombe dans l’invective, le lynchage, le procès d’intention et la diabolisation.
Un dialogue authentique exige la réunion de plusieurs conditions : la liberté d’expression, l’écoute mutuelle jusqu’à la disponibilité à changer d’avis, et dans les matières qui regardent les universités d’été, la quête du bien commun qui transcende les intérêts particuliers. Inviter des personnalités politiques ne signifie pas cautionner leurs positions mais les conduire à accepter d’êtres interpellées, voire critiquées, dans le cadre d’échanges francs et sereins. On peut noter que ce dialogue est régulièrement organisé dans d’autres cadres, plateaux TV, débats publics ou tables rondes.
C’est dans cet état d’esprit que les universités d’été de l’OSP ont été conçues.
Cet été, Marion Maréchal Le Pen est l’une des personnalités politiques invitées à débattre avec d’autres personnalités politiques dans le cadre d’une table ronde sur le thème de l’engagement des chrétiens en politique. Le Front national a obtenu près de 40% des votes aux dernières élections départementales dans le Var. Il s’agit d’une réalité. Que l’on soit d’accord ou pas avec les positions du FN, nier cette réalité serait faire preuve d’autisme. Blacklister un mouvement quel qu’il soit courrait le risque de l’enfermer dans ses positions, de contribuer à le radicaliser et à l’exclure de débats où les électeurs l’ont eux-mêmes introduit sur des sujets brûlants aujourd’hui : l’Europe, l’identité nationale et l’immigration… La dénonciation par la Conférence des évêques de France, qui vient d’être rappelée par son secrétaire général, à l’encontre de certaines positions et postures politiques du Front National, nous invite non seulement à contester mais aussi à dialoguer avec l’ensemble des acteurs de la vie politique, y compris le FN, sur ces questions disputées qui traversent et divisent l’opinion publique. Ce dialogue se déploie à partir des valeurs évangéliques de justice et de solidarité, et à partir des fondements du pacte social que rappelle l’Eglise depuis toujours: Le respect de la vie depuis son origine jusqu’à sa fin naturelle, la protection de la famille, l’accueil de l’étranger, le souci prioritaire du pauvre, la reconnaissance de la valeur du travail, les principes de solidarité entre les peuples, la liberté de conscience et d’expression et la liberté religieuse…
L’accueil de représentants du FN dans un débat organisé par l’Eglise est une nouveauté dans sa forme, mais ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la Doctrine Sociale de l’Eglise sur lesquels nous nous appuyons.
La question fondamentale à laquelle nous renvoie cette polémique porte sur notre capacité à dialoguer avec tous les mouvements politiques, quels qu’ils soient, sur la base des principes d’humanité qui nous viennent de la doctrine sociale de l’Eglise et de son Magistère. Ces principes d’humanité fondent l’engagement des chrétiens en politique et le dialogue avec la société pour offrir un discernement, critiquer si nécessaire, et concourir à la promotion du bien commun et d’une écologie intégrale. »
Ref. Communiqué de Mgr Rey au sujet des Universités d’Eté de la Sainte Baume
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine Sociale, Eglise, Enseignement - Education, Idées, Médias, Société 7 commentaires -
Migrants: l’Italie entre «casse-couilles» et «politicards»
Lu dans "Famille chrétienne":
 " En Italie la questions des migrants oppose l'Eglise et la classe politique. En 2014, plus de 165.000 migrants clandestins ont débarqué sur les côtes italiennes. Cet afflux crée des tensions de l'autre côté des Alpes. Mgr Galantino (photo), secrétaire général de la conférence épiscopale italienne dénonce l'inefficacité de la politique gouvernementale et l'indigence du débat politique sur la question migratoire.
" En Italie la questions des migrants oppose l'Eglise et la classe politique. En 2014, plus de 165.000 migrants clandestins ont débarqué sur les côtes italiennes. Cet afflux crée des tensions de l'autre côté des Alpes. Mgr Galantino (photo), secrétaire général de la conférence épiscopale italienne dénonce l'inefficacité de la politique gouvernementale et l'indigence du débat politique sur la question migratoire.Benjamin Coste
Certaines villes tenues par la Ligue du Nord refusent d’accueillir des migrants. Pour Matteo Salvini, chef du parti populiste, « un évêque doit s’en tenir à son rôle d’évêque et arrêter de casser les couilles (sic) à ceux qui administrent les villes. » À défaut d’élégance, le propos a le mérite d’être clair. Dans sa réponse, Mgr Galantino ne donne pas dans la langue de buis. S’en prenant aux élus de la Ligue du Nord qui jugent l’Église responsable de « l’africanisation de l’Italie », le secrétaire de la Conférence épiscopale italienne a, lui, dénoncé « les populistes qui prônent des mesures indignes » et qui « se comportent comme des politicards de quatre sous ».
Accéder au site : RFI
http://www.rfi.fr/europe/20150817-migrants-refugies-italie-eglise-vatican-ligue-nord-nunzio-galantino-colaninnoMgr Galantino estime que le gouvernement de Matteo Renzi « est totalement absent du débat sur l’immigration ». Ami du pape, l’évêque italien se trouve conforté par les appels à l’Europe de François à « ouvrir ses portes ». De plus, pour la journaliste Marcelle Padovani, l’Église est légitime sur cette problématique de l’immigration puisqu’« un migrant sur trois est reçu en Italie dans des structures liées au monde catholique » (Caritas, communauté de Sant’Egidio…).
Accéder au site : L'Obs http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150817.OBS4236/italie-face-aux-migrants-matteo-renzi-coince-entre-l-eglise-et-les-populistes.html
Pour Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant’Egidio et ancien ministre, « les factions politiques jouent une vilaine guerre électoraliste, réduisant un phénomène global, complexe et inarrêtable à la seule urgence des débarquements (...). Il faut à tout prix raisonner ». Du côté des politiques, on accuse le coup et on se défend : le premier ministre Matteo Renzi estime « injuste » et « démotivante » les critiques dont son gouvernement est l’objet. Son ministre de l’Intérieur juge, lui, que « nous sauvons des vies et rapatrions ceux qui ne fuient pas la guerre ou les persécutions. Nous faisons un métier différent de l'Église. »
Accéder au site : Le Point
http://www.lepoint.fr/monde/immigration-le-torchon-brule-entre-l-eglise-et-les-politiques-en-italie-19-08-2015-1957795_24.phpLe Service des Jésuites pour les réfugiés – Prix international de la paix 2014 pour son action en Syrie – appelle l’Europe à un consensus sur la question des migrants. Si la question est « certes complexe », le père Costa, responsable portugais de l’organisation, estime qu’« un effort s’impose au nom du respect des droits de l’homme et de la protection de la vie humaine. Il faut donc donner la priorité à l’accueil, à l’intégration sociale et culturelle et à l’insertion professionnelle des réfugiés et si possible au développement économique des pays de départ ».
Accéder au site : Radio Vatican
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/08/18/le_jrs_appelle_les_europ%C3%A9ens_%C3%A0_lhospitalit%C3%A9_pour_les_migrants/1165781Ref. En Italie, la question des migrants oppose l’Église et la classe politique
Même si rien n’est « inéluctable », la comparaison avec l'histoire des invasions de peuples germaniques fascinés par l’empire romain est-elle irréaliste ? Sous une forme ou une autre, avec ou sans accord officiel, ils y ont immigré toujours plus massivement jusqu’à franchir le seuil critique : la romanité s’est « barbarisée », et non l’inverse. Est-ce le sort qui attend l’Europe décadente où la natalité des populations anciennes ne cesse de diminuer ? La nature a horreur du vide et finit toujours par l’emporter sur les « limes » policier, militaire ou autres qu’on prétendrait lui opposer. Mais cela ne s’est pas fait en vingt-quatre heures comme dans le "Camp des saints", roman prémonitoire (1973) de Jean Raspail. Sur le fond de la question, nous renvoyons à l'article de Pierre Mélon, publié dans un récent numéro de la revue "Vérité et Espérance-Pâque nouvelle". On peut le lire sur le site web de l'église du Saint-Sacrement à Liège, en cliquant ici: "l'immigré est-il mon prochain? charité personnelle et charité politique".
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine Sociale, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Europe, Foi, Idées, Justice, Politique, Société, Solidarité 0 commentaire -
Liège : un colloque consacré à Monseigneur Van Bommel (1790-1852)
* * *
Publié le jeudi 20 août 2015 par Céline Guilleux
RÉSUMÉ
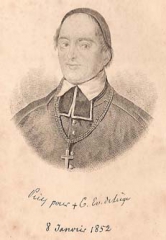 Corneille Van Bommel (1790-1852) a profondément marqué son temps comme pédagogue d’avant-garde et comme militant pour la liberté de l’enseignement ecclésiastique avant d’occuper pendant vingt-deux ans le siège épiscopal de Liège. À l’occasion du 225e anniversaire de sa naissance, il a semblé opportun de réunir, dans les lieux mêmes où le grand évêque a vécu, un colloque où seront examinés plusieurs aspects de son activité ainsi que l’environnement religieux, politique, économique, social et culturel où elle s’est déployée.
Corneille Van Bommel (1790-1852) a profondément marqué son temps comme pédagogue d’avant-garde et comme militant pour la liberté de l’enseignement ecclésiastique avant d’occuper pendant vingt-deux ans le siège épiscopal de Liège. À l’occasion du 225e anniversaire de sa naissance, il a semblé opportun de réunir, dans les lieux mêmes où le grand évêque a vécu, un colloque où seront examinés plusieurs aspects de son activité ainsi que l’environnement religieux, politique, économique, social et culturel où elle s’est déployée. ANNONCE
Argumentaire
Corneille Van Bommel (1790-1852) a profondément marqué son temps comme pédagogue d’avant-garde et comme militant pour la liberté de l’enseignement ecclésiastique avant d’occuper pendant vingt-deux ans le siège épiscopal de Liège. À l’occasion du 225e anniversaire de sa naissance, il a semblé opportun de réunir, dans les lieux mêmes où le grand évêque a vécu, un colloque où seront examinés plusieurs aspects de son activité ainsi que l’environnement religieux, politique, économique, social et culturel où elle s’est déployée.
Les Actes de ce colloque seront publiés dans le Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège.
Programme
-
En visite au Paraguay, le pape François tance le président
 Au Paraguay, le président ne s’appelle pas Moralès mais Horacio Cartes. Il n’est pas dirigeant syndicaliste ni chef de file du mouvement vers le socialisme mais ingénieur en aéronautique et homme d’affaire, démocratiquement élu. Il a fait les frais de la rencontre avec François. Le journal « Le Monde » commente (JPSC) :
Au Paraguay, le président ne s’appelle pas Moralès mais Horacio Cartes. Il n’est pas dirigeant syndicaliste ni chef de file du mouvement vers le socialisme mais ingénieur en aéronautique et homme d’affaire, démocratiquement élu. Il a fait les frais de la rencontre avec François. Le journal « Le Monde » commente (JPSC) :« Avis aux présidents qui seraient tentés de tirer un bénéfice politique de la venue d’un pape très populaire dans leur pays : avec François, l’expérience pourrait au contraire leur en cuire. C’est la mésaventure qui est arrivée, samedi 11 juillet, au président du Paraguay, Horacio Cartes, un conservateur au pouvoir depuis deux ans. Une rencontre publique à laquelle participait le pape argentin a tourné à l’humiliation publique pour le chef de l’Etat, conspué par la salle, morigéné en public par Jorge Mario Bergoglio.
La veille, la visite au Paraguay, troisième et dernière étape de la tournée pontificale en Amérique du sud, avait pourtant bien commencé pour cet ancien élève des jésuites, à l’aéroport puis au palais présidentiel, en compagnie de tout ce que la République paraguayenne compte d’officiels. Mais samedi, au palais des sports Leon Condou, le public était différent. Réunies par le recteur de l’université catholique, Narciso Velazquez, cinq mille personnes représentants différentes associations et acteurs de la société civile attendaient de François un encouragement pour faire face aux multiples maux du pays, de la pauvreté à la marginalisation de populations indigènes en passant par la corruption.
Lire : Le pape au Paraguay, ancienne terre de mission jésuite
« La dictature, c’est fini ! »
Pour faire patienter la salle, chants et danses alternent avec des prises de parole dans une atmosphère fervente et bon-enfant. Mais des sifflets commencent à surgir lorsqu’une économiste vante longuement les succès économiques du pays. Elle doit s’arrêter sous les huées lorsqu’elle affirme que son taux d’endettement est le plus faible de la région. La salle s’échauffe un peu plus encore lorsque des membres du service d’ordre veulent s’emparer d’une banderole rappelant un affrontement entre policiers et paysans sans terre qui a fait 17 morts il y a trois ans. « La dictature, c’est fini », crie la salle. Le calicot passe de main en main et est mis à l’abri au dernier rang, bien visible.
-
Bolivie : le pape François a galvanisé les mouvements populaires et demandé pardon pour l'Eglise
Lu sur le site du « Figaro » ce compte rendu de Jean-Marie Guénois :
«Notre foi est révolutionnaire, notre foi défie la tyrannie de l'idole argent.» Au cœur de son périple en Amérique latine, François (ici à côté du président socialiste Morales: photo) a décidé de tirer les conséquences concrètes de cette vision. Jeudi en fin d'après-midi (vendredi à minuit heure de Paris), à Santa Cruz en Bolivie, devant la deuxième «rencontre mondiale des mouvements populaires» - instance dont il est à l'origine -, le Pape a prononcé un long discours très décapant contre l'économie de marché et la finance internationale.
Reprenant une citation de Basile de Césarée, un père de l'Église primitive, François a fustigé «l'ambition sans retenue de l'argent qui commande» parce qu'elle répandrait selon lui sur la terre l'odeur du «fumier de diable».
Il a donc appelé - en leur apportant son soutien total - tous les mouvements qui «luttent» pour les «droits sacrés», les «trois T», «terre, toit, travail» à s'unir sur un plan international - et pas seulement en Amérique Latine - pour faire partout entendre «le cri des exclus». Et exiger «un changement de structures» parce que «l'on ne peut plus supporter ce système» qui «porte atteinte au projet de Jésus».
«Il est indispensable que, avec la revendication de leurs droits légitimes, les peuples et leurs organisations sociales construisent une alternative humaine à la globalisation qui exclut.»
Un objectif sur lequel le Pape a martelé: «J'insiste, disons-le sans peur: nous voulons un changement, un changement réel, un changement de structures. On ne peut plus supporter ce système, les paysans ne le supportent pas, les travailleurs ne le supportent pas, les communautés ne le supportent pas, les peuples ne le supportent pas.»
Et «ne vous sous-estimez pas», a-t-il lancé à ces «semeurs de changement» car «l'avenir de l'humanité est dans une grande mesure entre vos mains». Surtout «ne vous résignez pas, en opposant une résistance active au système idolâtrique qui exclut, dégrade et tue» car «il est indispensable que, avec la revendication de leurs droits légitimes, les peuples et leurs organisations sociales construisent une alternative humaine à la globalisation qui exclut».
Une «économie idolâtre»
Pour le Pape, en effet, il importe de «dire non aux vieilles et nouvelles formes de colonialisme» car les peuples «ne veulent pas de tutelles d'ingérence où le plus fort subordonne le plus faible». Mais il faut aussi refuser, devait insister François, «l'économie idolâtre» qui «exploite les marginalisés comme des esclaves par le marché formel».
En un mot, «la première tâche est de mettre l'économie au service des peuples: les êtres humains et la nature ne doivent pas être au service de l'argent. Disons non à une économie d'exclusion et d'injustice où l'argent règne au lieu de servir. Cette économie tue. Cette économie exclut. Cette économie détruit la Mère Terre». Il faut tendre vers une «économie vraiment communautaire».
Autre définition de cette «dictature subtile» de l'économie: «Quand le capital est érigé en idole et commande toutes les options des êtres humains, quand l'avidité pour l'argent oriente tout le système socio-économique, cela ruine la société, condamne l'homme, le transforme en esclave, détruit la fraternité entre les hommes, oppose les peuples les uns aux autres et, comme nous le voyons, met même en danger notre maison commune.»
S'adressant ensuite plus particulièrement aux chrétiens, François a rappelé que «la juste distribution des fruits de la terre et du travail humain n'est pas de la pure philanthropie. C'est un devoir moral. Pour les chrétiens, la charge est encore plus lourde: c'est un commandement. Il s'agit de rendre aux pauvres et aux peuples ce qui leur appartient».
En effet, a-t-il argumenté: «La destination universelle des biens n'est pas une figure de style de la doctrine sociale de l'Église. C'est une réalité antérieure à la propriété privée. La propriété, surtout quand elle affecte les ressources naturelles, doit toujours être en fonction des nécessités des peuples.»
L'image du processus
Conscient de la difficulté de mettre en œuvre une telle réforme, François a aussi fait part de sa philosophie du changement: «C'est un processus de changement. Le changement conçu non pas comme quelque chose qui un jour se réalisera parce qu'on a imposé telle ou telle option politique ou parce que telle ou telle structure sociale a été instaurée. Nous avons appris douloureusement qu'un changement de structures qui n'est pas accompagné d'une conversion sincère des attitudes et du cœur finit tôt ou tard par se bureaucratiser, par se corrompre et par succomber. Voilà pourquoi me plaît tant l'image du processus, où la passion de semer, d'arroser sereinement ce que d'autres verront fleurir, remplace l'obsession d'occuper tous les espaces de pouvoir disponibles et de voir des résultats immédiats. Chacun de nous n'est qu'une part d'un tout complexe et divers, interagissant dans le temps.»
En conclusion de ce discours qui marquera son pontificat, le Pape, en reprenant les paroles de Jean-Paul II, est allé encore plus loin, dans la repentance: «Je demande humblement un pardon, non seulement pour les offenses de l'Église même, mais pour les crimes contre les peuples autochtones durant ce que l'on appelle la conquête de l'Amérique.»
Ref. En Bolivie, le pape François dénonce «l'idole argent»
JPSC
-
Laudato Si : juste un mot sur la portée doctrinale de l’encyclique
 Le site du bimensuel « L’Homme Nouveau » publie le point de vue d’un moine de l’abbaye bénédictine de Triors:
Le site du bimensuel « L’Homme Nouveau » publie le point de vue d’un moine de l’abbaye bénédictine de Triors:« Le Pape vient de publier sa deuxième encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Juste un mot sur la portée doctrinale de l’encyclique.
Comme toujours, il s’agit d’un document du magistère ordinaire solennel du Pontife romain de sorte que tout ce qui y est dit touchant la foi et les mœurs et qui serait déjà défini, est infaillible. C’est le cas pour la doctrine sur la création (nn. 62-100). Le reste bénéficie d’une assistance prudentielle : le Pontife romain ne pouvant induire en erreur grave le lecteur, on est assuré que le contenu dans son ensemble est bon pour les âmes ; ce qui n’exclut pas qu’une meilleure expression soit possible, par exemple pour la première partie concernant les changements climatiques (nn. 11-61). En conformité donc avec le n. 25 de Lumen gentium et la pensée de nombreux théologiens, il faut accueillir cette encyclique avec foi et docilité, en « sachant recueillir des lèvres et du cœur de l’Église la pensée de Dieu », (dom Delatte).
La réaction des papes
De Léon XIII jusqu’à Paul VI, l’enseignement social de l’Église s’était surtout intéressé au développement industriel, sans pour autant nier la valeur du travail agricole. Pour s’en convaincre, il suffirait de lire les enseignements pontificaux de Solesmes. Depuis la lettre Octogesima adveniens de Paul VI en 1971, l’Église, par la force des choses et pour répondre aussi aux dérives d’une écologie marxiste, dénonça avec courage et de plus en plus les infractions commises à l’égard de la création, dont les changements climatiques sont peut-être une conséquence. Après Paul VI, Jean-Paul II publia en 1990 son Message pour la journée mondiale de la paix sur le thème de l’écologie : « La paix avec Dieu Créateur, la paix avec toute la création ». Benoît XVI eut sur ce sujet de remarquables interventions. Ainsi, son Message pour la journée mondiale de la paix de 2010 : « Si tu veux construire la paix, protège la création », qui renforçait son encyclique Caritas in veritate sur le développement et la solidarité.
-
La place de l'homme au coeur de l'écologie : le rappel du pape François
ENCYCLIQUE LAUDATO SI :
LE PAPE RAPPELLE LA PLACE DE L'HOMME AU COEUR DE L'ÉCOLOGIE
Le pape François a publié sa 2e encyclique, ce 18 juin 2015, "sur la sauvegarde de la maison commune", brossant un tableau sans concession et appelant à une conversion des lois du marché, au service de la personne humaine. De toute personne. Gènéthique s'est intéressé aux points qui correspondent aux enjeux bioéthiques que l'écologie doit prendre en compte.
« Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap – pour prendre seulement quelques exemples - , on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est lié » (§ 117) prévient le pape François dans l'encyclique « laudato si ». Un texte fort, écrit au terme d'une vaste consultation, auprès de nombreux experts et aux quatre coins du monde.
« Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule, parce qu'au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature' » poursuit le pape, avant de dénoncer « une schizophrénie permanente qui va de l'exaltation technocratique (…) à la réaction qui nie toute valeur particulière à l'être humain » (§ 118).
Une situation grave qui requiert une juste anthropologie pour être efficace dans la lutte de la sauvegarde de la planète : « on ne peut pas exiger de l'être humain un engagement respectueux envers le monde si on ne reconnaît pas et ne valorise pas en même temps ses capacités particulières de connaissance, de volonté, de liberté et de responsabilité » (§ 118). Le Pape reprend en ce sens la pensée de la tradition chrétienne, à l'opposé de certains courants actuels qui dénient à l'homme sa spécificité spirituelle.
« Si la crise écologique est l'éclosion ou une manifestation extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité, nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l'environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain » (§ 119) pointe le pape qui, au passage, s'oppose à l'avortement (§ 120) : « un chemin éducatif pour accueillir les personnes faibles de notre entourage, qui parfois dérangent et sont inopportunes, ne semble praticable si l'on ne protège pas l'embryon humain ». Et de s'en prendre au libéralisme économique qui relativise la dignité de l'homme, de tout homme, aux lois du marché et de la finance : « N'est-ce pas la même logique relativiste qui justifie l'achat d'organes des pauvres dans le but de les vendre ou de les utiliser pour l'expérimentation, ou le rejet d'enfants parce qu'ils ne répondent pas au désir des parents ? » (§ 123).
Sans refuser le progrès et ses bienfaits, le souverain pontife met en garde contre ses excès, rappellant les avertissements de ses prédécesseurs, en particulier saint Jean-Paul II, sur « une manipulation génétique menée sans discernement ». C'est pourquoi il invite à être clair sur les objectifs de telles recherches et à poser un cadre éthique à « cette activité humaine qui est une forme de pouvoir comportant de hauts risques » (§ 131). Et là encore, le pape souligne la dignité de l'embryon humain : « Il est préoccupant que certains mouvements écologistes, qui défendent l'intégrité de l'environnement et exigent avec raison certaines limites à la recherche scientifique, n'appliquent pas parfois ces mêmes principes à la vie humaine. En général, on justifie le dépassement de toutes les limites quand on fait des expérimentations sur les embryons humains vivants » déplore le pape en relevant la contradiction de nombreux mouvements écologiques qui restent dans une vision parcellaire des problèmes, alors que l'encyclique a l'ambition de proposer une « écologie intégrale »
Fidèle à lui-même et à l'Evangile, jamais le pape ne perd de vue les plus pauvres, au cœur d'une société mercantile qu'il embrasse dans toutes ses composantes, offrant une synthèse qui semble créer une onde de choc et devrait s'inviter à la 21è conférence sur le climat qui s'ouvrira le 30 novembre prochain à Paris.
Lien permanent Catégories : Actualité, Doctrine Sociale, Eglise, environnement, Ethique, Idées, Livres - Publications, Politique, Société, Solidarité 0 commentaire
