#JeSuisCharlie : En état de choc, on fait n’importe quoi (source)
« En état de choc, on fait n’importe quoi » : Guillaume de Prémare livre son décryptage du choc « Charlie Hebdo » et du mouvement « Je suis Charlie ».
Que pensez-vous de ce que nous vivons autour du choc « Charlie Hebdo » ?
Il faut partir du fait générateur qui est le terrorisme. La France a déjà connu, dans un passé récent, des vagues de terrorisme. Mais elles n’étaient pas de la même nature. Je vois deux différences profondes.
La première différence est que les vagues de terrorisme des années 1980 et 1990 étaient principalement destinées à faire pression sur la politique internationale de la France, qu’il s’agisse du conflit israélo-palestinien ou de l’Algérie. Aujourd’hui, les terroristes cherchent aussi à faire pression sur la France par rapport à ses engagements militaires à travers le monde, mais ils poursuivent plus largement un objectif de conquête politico-religieuse à l’échelle mondiale, ce qui est nouveau, appuyé sur une idéologie politico-religieuse qui est ancienne.
La deuxième différence, c’est que les terroristes venaient jusqu’ici le plus souvent de l’extérieur. Aujourd’hui, l’islam radical s’appuie principalement sur des musulmans qui vivent en France, et sont même de nationalité française. Les jeunes sont radicalisés en France, font leurs armes à l’étranger puis reviennent en France pour combattre. C’est un élément-clé de la stratégie terroriste en France : mener une guerre de l’intérieur qui s’appuie sur des troupes déjà sur le sol français.
Selon vous, quelle est la stratégie de ces terroristes ?
Leur stratégie est de semer le chaos, de provoquer un état de choc global de notre société, pour créer une fracture irrémédiable entre les musulmans français et le reste de la population. Ils commettent donc des attentats pour faire grimper à son paroxysme la peur de l’islam et l’hostilité envers l’islam, jusqu’à la psychose, à un point tel que les musulmans ressentent cette hostilité, y compris, si possible, en raison de représailles contre la communauté musulmane. Il nous faut donc impérativement éviter les délires identitaires agressifs.
Ils misent sur l’aspect très communautaire de la religion musulmane pour gagner l’opinion musulmane. Celle-ci, se sentant en terrain hostile, se communautariserait toujours davantage et serait mûre pour d’abord éprouver de la sympathie pour le djihadisme, ensuite leur apporter un soutien. Cela ne signifie pas qu’une majorité des millions de musulmans qui vivent en France deviendrait terroriste – dans une guerre les combattants sont toujours minoritaires -, mais les islamistes pourraient recruter de jeunes musulmans sur un terreau de plus en plus favorable et évoluer, dans les quartiers musulmans, en terrain ami. Je ne dis pas qu’ils vont réussir, mais je pense que c’est leur projet.
Pour accentuer ce processus de séparation des musulmans de la communauté nationale, il y a un autre aspect qui est la guerre culturelle. Il s’agit de séparer toujours davantage culturellement les musulmans de la culture française. Pour cela, ils s’appuient sur la décomposition de la culture française pour en faire un parfait repoussoir pour tout bon musulman. Plus la société française est athée, libertaire, permissive, consumériste, sans repères, vide de sens, et en faillite éducative, plus la fracture culturelle grandit avec les musulmans. Je crois que cet aspect des choses est majeur dans le défi auquel nous sommes confrontés. Ce n’est pas le « choc des cultures », mais le « choc des incultures » comme dit François-Xavier Bellamy.
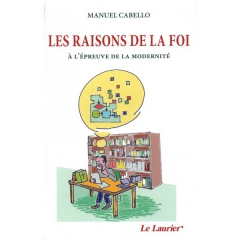 L’apologétique n’est pas morte ! Dans un style très accessible Mgr Manuel Cabello, Vicaire Régional de la Prélature de l’Opus Dei en Belgique, vient de publier aux Editions du Laurier un ouvrage bien documenté sur les présupposés de la foi aujourd’hui (Les raisons de la foi à l’épreuve de la modernité, Le Laurier, Paris 2014). Manuel Cabello est docteur en sciences de l’éducation, diplômé de l’Université de Navarre. Commentaire de Georges Rouel sur le site web didoc.be :
L’apologétique n’est pas morte ! Dans un style très accessible Mgr Manuel Cabello, Vicaire Régional de la Prélature de l’Opus Dei en Belgique, vient de publier aux Editions du Laurier un ouvrage bien documenté sur les présupposés de la foi aujourd’hui (Les raisons de la foi à l’épreuve de la modernité, Le Laurier, Paris 2014). Manuel Cabello est docteur en sciences de l’éducation, diplômé de l’Université de Navarre. Commentaire de Georges Rouel sur le site web didoc.be :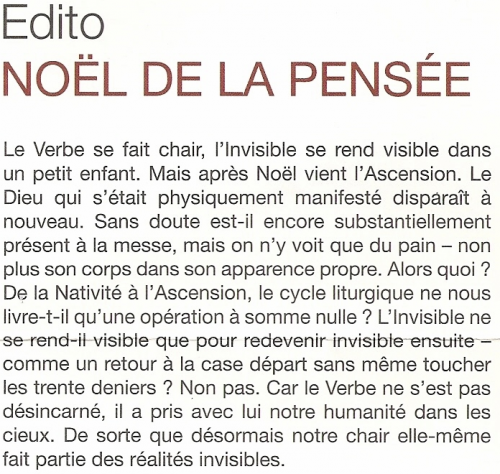
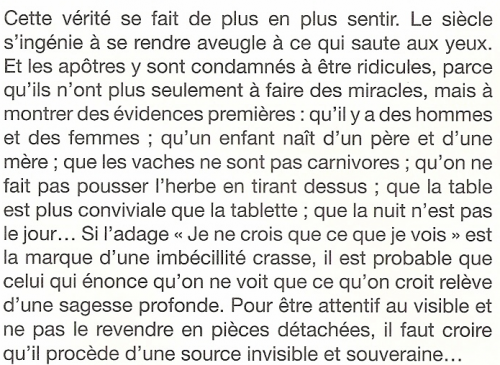
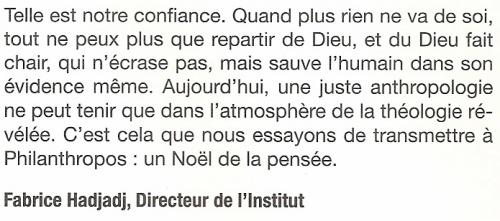
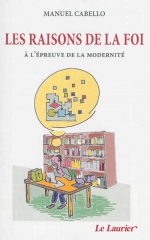 Lu
Lu  chant troisième, vendredi-saint, 8 avril 1300). Lu sur le « metablog », cette réflexion post-synodale :
chant troisième, vendredi-saint, 8 avril 1300). Lu sur le « metablog », cette réflexion post-synodale :