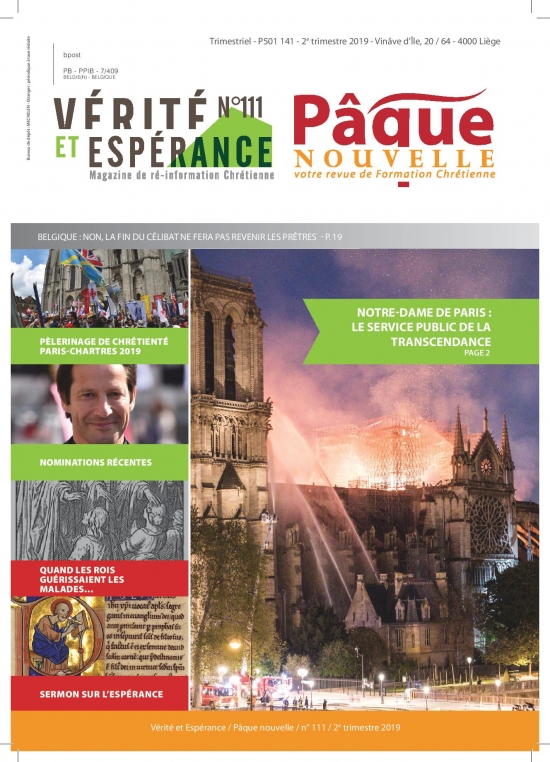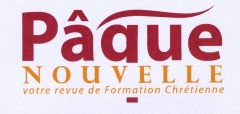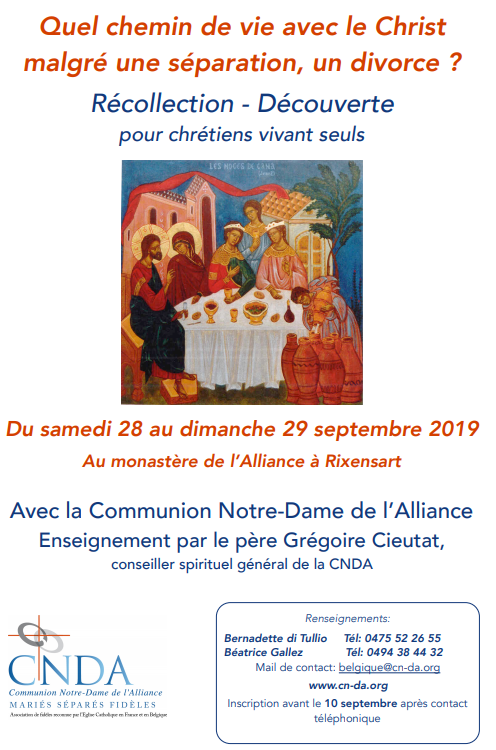De l'abbé Claude Barthe sur le site de l'Homme Nouveau :
Un message ratzinguérien avant le Synode sur l’Amazonie

Le cardinal Müller, intervenant lors du « Ratzinger-Schülerkreis », le Cercle des anciens étudiants du professeur Joseph Ratzinger, qui tenait sa réunion annuelle hier et aujourd’hui (aujourd’hui, pour la première fois en public à l’Augustinianum, à côté de la Place Saint-Pierre), sur le thème « Les défis actuels du ministère ordonné dans l’Eglise », a lancé une nouvelle fois une alerte pour que « le soi-disant chemin synodal d’Allemagne ou le Synode amazonien ne se terminent pas par le désastre de la sécularisation de l'Eglise ».
Des conférences ciblées
Dans ce colloque, outre la conférence de l’ancien Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur « les exigences de la consécration », intervenaient le professeur Karl-Heinz Menke, sur « le sacerdoce ministériel dans l’Eglise », Marianne Schlosser, historienne de la spiritualité, sur « la consécration et le célibat pour le Royaume des Cieux », cependant que le cardinal Kurt Koch, Président du Conseil pour le Dialogue, a prononcé les allocutions de bienvenue et de clôture.
Conférences très ciblées, comme on le voit, avant le mois de tous les dangers pour la foi et la discipline que sera le mois d’octobre romain. Le communiqué de présentation disait :
« En ce temps de crise et de purification douloureuse de l'Eglise, ce ne sont pas principalement les réformes structurelles qui peuvent procurer aux prêtres à la fois une aide et une guérison, mais le témoignage authentique d’une foi vécue dans l’Ordre sacré du sacerdoce ministériel. Ainsi, une issue ne pourra être trouvée que si la nature du ministère sacerdotal est et reste claire, avec des prêtres qui en témoignent sans ambiguïté ».
Le célibat pour le Royaume des cieux
Et en conclusion, le colloque a lancé un message dans lequel est affirmé :
« La présence du Christ ne doit pas se limiter à la seule action sacramentelle, mais elle doit devenir reconnaissable et efficace dans la vie quotidienne. Cela comporte les obligations de l’obéissance et du célibat pour le Royaume des cieux, qui sont des expressions humaines et spirituelles de la configuration sacramentelle du prêtre au Christ ».
A bons entendeurs synodaux…
Et on peut encore lire sur le site Pro Liturgia :
Quant au cardinal Müller, voici ce qu’il a déclaré :
« Seul Jésus-Christ [...] est la raison, le contenu et la mesure de notre foi, et non un Dieu païen qui nous parle dans les mythes et les utopies, dans la dynamique des événements, dans les processus que nous initions, dans le sang de la race, dans l’esprit populaire ou dans les réalités immorales de la vie. La théologie reconnaît comme “locus theologicus” la seule Parole de Dieu dans l’Ecriture Sainte et la Tradition, alors que le Magistère ne peut revendiquer qu’une autorité interprétative. Présumer ou reconnaître, en plus de la plénitude de la révélation du Christ, de nouvelles révélations alléguées de Dieu dans les processus dynamiques de la conscience populaire ou dans les réalités de la vie [...] n’est autre chose qu’un “néopaganisme” renaissant, déjà violemment rejeté par le pape Pie XI dans son encyclique “Mit brennender Sorge” contre la falsification par le national-socialisme du concept chrétien de révélation. »

 L’ancien Président de la République française, Jacques Chirac (86 ans) est décédé hier jeudi 26 septembre et le jour même l’Élysée a annoncé une journée de deuil national en hommage au disparu, le lundi 30 septembre. Le site "aleteia" précise qu'un «service solennel », autrement dit une messe, sera célébré le même jour par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, à 12h en l’église parisienne de Saint-Sulpice. Emmanuel Macron devrait y assister ainsi que plusieurs chefs d’Etat étrangers ».
L’ancien Président de la République française, Jacques Chirac (86 ans) est décédé hier jeudi 26 septembre et le jour même l’Élysée a annoncé une journée de deuil national en hommage au disparu, le lundi 30 septembre. Le site "aleteia" précise qu'un «service solennel », autrement dit une messe, sera célébré le même jour par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, à 12h en l’église parisienne de Saint-Sulpice. Emmanuel Macron devrait y assister ainsi que plusieurs chefs d’Etat étrangers ».
 Du 21 au 24 septembre prochains, l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne)
Du 21 au 24 septembre prochains, l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne)  des bannières et des livres liturgiques anciens ainsi que de remarquables reproductions de vitraux illustra
des bannières et des livres liturgiques anciens ainsi que de remarquables reproductions de vitraux illustra