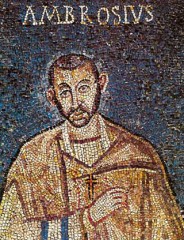QUAS PRIMAS
DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE XI
DE L'INSTITUTION D'UNE FÊTE DU CHRIST-ROI.
Aux Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres ordinaires de lieu, en paix et communion avec le Siège apostolique.
1. Dans (1) la première Encyclique qu'au début de Notre Pontificat Nous adressions aux évêques du monde entier (2), Nous recherchions la cause intime des calamités contre lesquelles, sous Nos yeux, se débat, accablé, le genre humain.
Or, il Nous en souvient, Nous proclamions ouvertement deux choses: l'une, que ce débordement de maux sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique; l'autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de Notre Sauveur. C'est pourquoi, après avoir affirmé qu'il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ, Nous avons déclaré Notre intention d'y travailler dans toute la mesure de Nos forces ; par le règne du Christ, disions-Nous, car, pour ramener et consolider la paix, Nous ne voyions pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de Notre Seigneur.
2. Depuis, Nous avons clairement pressenti l'approche de temps meilleurs en voyant l'empressement des peuples à se tourner - les uns pour la première fois, les autres avec une ardeur singulièrement accrue - vers le Christ et vers son Eglise, unique dispensatrice du salut: preuve évidente que beaucoup d'hommes, jusque-là exilés, peut-on dire, du royaume du Rédempteur pour avoir méprisé son autorité, préparent heureusement et mènent à son terme leur retour au devoir de l'obéissance.
Tout ce qui est survenu, tout ce qui s'est fait au cours de l'Année sainte, digne vraiment d'une éternelle mémoire, n'a-t-il pas contribué puissamment à l'honneur et à la gloire du Fondateur de l'Eglise, de sa souveraineté et de sa royauté suprême?
Voici d'abord l'Exposition des Missions, qui a produit sur l'esprit et sur le cœur des hommes une si profonde impression. On y a vu les travaux entrepris sans relâche par l'Eglise pour étendre le royaume de son Epoux chaque jour davantage sur tous les continents, dans toutes les îles, même celles qui sont perdues au milieu de l'océan; on y a vu les nombreux pays que de vaillants et invincibles missionnaires ont conquis au catholicisme au prix de leurs sueurs et de leur sang; on y a vu enfin les immenses territoires qui sont encore à soumettre à la douce et salutaire domination de notre Roi.
Voici les pèlerins accourus, de partout, à Rome, durant l'Année sainte, conduits par leurs évêques ou par leurs prêtres. Quel motif les inspirait donc, sinon de purifier leurs âmes et de proclamer, au tombeau des Apôtres et devant Nous, qu'ils sont et qu'ils resteront sous l'autorité du Christ?
Voici les canonisations, où Nous avons décerné, après la preuve éclatante de leurs admirables vertus, les honneurs réservés aux saints, à six confesseurs ou vierges. Le règne de notre Sauveur n'a-t-il pas, en ce jour, brillé d'un nouvel éclat? Ah! quelle joie, quelle consolation ce fut pour Notre âme, après avoir prononcé les décrets de canonisation, d'entendre, dans la majestueuse basilique de Saint Pierre, la foule immense des fidèles, au milieu du chant de l'action de grâces, acclamer d'une seule voix la royauté glorieuse du Christ: Tu Rex gloriae Christe!
A l'heure où les hommes et les Etats sans Dieu, devenus la proie des guerres qu'allument la haine et des discordes intestines, se précipitent à la ruine et à la mort, l'Eglise de Dieu, continuant à donner au genre humain l'aliment de la vie spirituelle, engendre et élève pour le Christ des générations successives de saints et de saintes; le Christ, à son tour, ne cesse d'appeler à l'éternelle béatitude de son royaume céleste ceux en qui il a reconnu de très fidèles et obéissants sujets de son royaume terrestre.