Du site "Paix liturgique" (lettre 729 du 15 janvier) :
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITE DES CHRÉTIENS … MAIS PAS AVEC LES CATHOLIQUES ATTACHÉS A LA TRADITION ?

« Puisse chaque Église reconnaître aujourd'hui le mal qu'elle a fait à d'autres chrétiens et en demander humblement pardon, et puisse-t-elle entendre la même demande que d'autres chrétiens lui adressent et, à son tour, leur accorder son pardon ». C’est la prière que la Conférence des Evêques de France nous propose pour la Semaine de l’Unité, qui va de dérouler, comme chaque année, du 18 janvier (jadis, fête de la Chaire de saint Pierre) au 25 janvier (fête de la Conversion de saint Paul).
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens fut créée à l’initiative de l’abbé Paul Couturier (1881-1953), prêtre de Lyon, en janvier 1933, pour l'unité de tous les baptisés chrétiens, notamment catholiques, orthodoxes, anglicans, réformés. Après le Concile, la Semaine vit l’organisation de prières communes, parfois même de cérémonies communes. Elle est préparée conjointement par le Conseil œcuménique des Eglises, de Genève, et le Conseil Pontifical pour l’Unité des Chrétiens.
Sur elle pèse aujourd’hui les ambiguïtés de la définition de l’œcuménisme lors du dernier concile, qui n’est ni l’œcuménisme né au sein du monde protestant, lequel considère qu’aucune Eglise chrétienne ne correspond à la vraie et toute spirituelle Eglise du Christ, ni l’unionisme catholique traditionnel, qui cherchait à réintégrer les chrétiens séparés dans des Eglises unies à Rome. L’œcuménisme issu du Concile est une sorte de transaction : il considère que l’Eglise catholique est la vraie Eglise, mais que les autres Eglises chrétiennes ont cependant une réalité surnaturelle et qu’elles sont des Eglises « imparfaites », avec lesquelles une sorte d’unité progressive est possible. L’œcuménisme comme une sorte de compromis entre l’orthodoxie et l’hétérodoxie.
Quoi qu’il en soit, l’œcuménisme pratiqué par les instances catholiques vise les autres Eglises chrétiennes, pour préparer avec elles par la prière, le dialogue, les efforts de compréhension et la charité l’unité, aussi mal définie qu’elle soit. La Conférence des Evêques nous invite ainsi à la prière et à la charité pour tous les chrétiens. Ou pour presque tous…
Balayer non devant, mais derrière sa porte
Car pourquoi, quand on prétend œuvrer pour l’unité, ne pas chercher d’abord à la retisser à l’intérieur de la maison ? N’y a-t-il pas hypocrisie à déborder de mansuétude et de bons sentiments ad extra, et de ne monter que rejet et exclusion ad intra.
Dans son livre Les dissensions ecclésiales, un défi pour l’Eglise catholique (Cerf, 2019), l’abbé Pierre-Marie Berthe, dans une perspective très centrée sur la Fraternité Saint-Pie-X, regrette cependant à juste titre le « deux poids, deux mesures » des autorités ecclésiales depuis le Concile, qui ne sont que gentillesse, ouverture et dialogue vis-à-vis des chrétiens séparés, mais dont le fond de l’attitude vis-à-vis des chrétiens traditionnels n’est que méfiance et rejet a priori.
Et malgré tout, 50 ans d’œcuménisme actif n’ont finalement abouti à aucun résultat concret avec les frères séparés. La seule exception n’en est pas une, puisqu’elle se modèle sur l’ancienne pastorale de l’uniatisme, qui réintégrait en corps, dans l’unité romaine, des Eglises orientales séparées. Il s’agit du retour au catholicisme d’un certain nombre d’anglicans – fort traditionnels au demeurant – organisé par la constitution apostolique Anglicanorum cœtibus de Benoît XVI, du 4 novembre 2009, qui permet, pour ces anglicans devenant catholiques, la création d’ordinariats personnels, des sortes de diocèses un peu semblables aux ordinariats militaires (les sujets ne sont pas les habitants d’un territoire, mais sont une catégorie déterminée de personnes, ici d’anciens anglicans bénéficiant des privilèges liturgiques).
Quelles sont alors les raisons de l’échec de l’œcuménisme ? Ses ambiguïtés fondamentales assurément, avec notamment cette étrange construction théologique de la « communion imparfaite » (Unitatis redintegratio, n. 3 : « Ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême, se trouvent dans une certaine communion, bien qu’imparfaite avec l’Église catholique »). Selon Unitatis redintegratio, on pourrait être dans la communion catholique partiellement, à 30% (les protestants), 40% (les anglicans), 80% (les orthodoxes), si on nous permet d’exprimer ainsi trivialement les choses Or, la théologie et le magistère antérieur tenaient au contraire que la foi – et donc la communion au Christ et à l’Eglise – ne se divise pas : on a ou on n’a pas la foi, et de la sorte on est ou on n’est pas en communion avec le Christ. Sauf, bien entendu pour ces chrétiens apparemment séparé, mais dont la bonne foi, dont Dieu seul juge, fait qu’ils sont en fait invisiblement catholiques.
Lire la suite
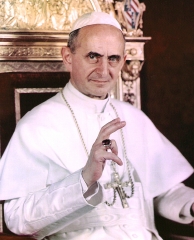 Le Credo de Nicée-Constantinople (325-381) que les catholiques chantent ou récitent encore à la messe dominicale, professe leur foi dans un seul Dieu créateur de l’univers visible mais aussi invisible, auquel se réfèrent l’ancien comme le nouveau testament lorsqu’ils évoquent, notamment, les anges.
Le Credo de Nicée-Constantinople (325-381) que les catholiques chantent ou récitent encore à la messe dominicale, professe leur foi dans un seul Dieu créateur de l’univers visible mais aussi invisible, auquel se réfèrent l’ancien comme le nouveau testament lorsqu’ils évoquent, notamment, les anges. 







 Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’
Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’