De l’abbé Christian Guyaud (Totus Tuus) sur le site web du mensuel « La Nef » :
 « Remise en cause du célibat sacerdotal dans l’Église latine et « ministères féminins » sont deux thèmes du synode sur l’Amazonie qui soulèvent questions et inquiétudes. Analyses :
« Remise en cause du célibat sacerdotal dans l’Église latine et « ministères féminins » sont deux thèmes du synode sur l’Amazonie qui soulèvent questions et inquiétudes. Analyses :
Si l’accès aux sacrements – comme l’Eucharistie – dans une situation objective de péché – comme celle dans laquelle se trouvent les personnes divorcées remariées – est ce qu’on retiendra du synode sur la famille, l’accès à l’ordination sacerdotale de personnes mariées et au ministère de femmes devrait constituer les « avancées » du synode sur l’Amazonie.
Le célibat mis en cause
Ces questions étaient en ligne de mire dès l’Instrumentum laboris (IL). Pour passer d’une « pastorale de visite » à une « pastorale de présence », le document de travail mentionnait en effet sans ambages que « tout en affirmant que le célibat est un don pour l’Église, on se pose la question de savoir si, pour les zones les plus reculées de la région, il ne serait pas possible de procéder à l’ordination sacerdotale de personnes aînées, préférablement autochtones, respectées et acceptées par leur communauté, même si elles ont une famille constituée et stable, dans le but de garantir la possibilité d’offrir les sacrements qui accompagnent et soutiennent la vie chrétienne » (IL n. 129).
De fait, dans le document final, dont la synthèse a été distribuée à la demande du pape, « le synode réaffirme l’appréciation du célibat comme don de Dieu dans la mesure où il permet au prêtre de se consacrer pleinement au service de la communauté et renouvelle la prière pour qu’il y ait beaucoup de vocations dans le célibat, bien que “cette discipline ne soit pas requise par la nature même du sacerdoce”, et il considère la vaste étendue du territoire amazonien et la pénurie des ministres ordonnés ». Il est donc proposé « d’établir des critères et des dispositions par l’autorité compétente, d’ordonner des prêtres appropriés et reconnus de la communauté qui ont un diaconat permanent fécond et reçoivent une formation adéquate pour le sacerdoce, pouvant avoir une famille légitimement constituée et stable, pour soutenir la vie de la communauté chrétienne par la prédication de la Parole et la célébration des sacrements dans les zones les plus reculées de la région amazonienne ». Il est précisé qu’à cet égard, « certains se sont exprimés en faveur d’une approche universelle du sujet ».
On remarque que le célibat est considéré comme un don de Dieu et non comme une exigence liée au sacerdoce. On cite le Décret conciliaire Presbyterorum ordinis (PO) sur la « discipline » du célibat qui n’est « pas requise par la nature même du sacerdoce » (PO n. 16). Vatican II entendait certes ne pas mettre en cause la praxis différente des Églises orientales mais était loin de réduire le célibat ecclésiastique à un pur impératif positiviste puisque le même Décret soulignait les « multiples convenances » du célibat avec le sacerdoce.
Le document final donne bien une raison au « don de Dieu » que représente le célibat, mais c’est sans doute la moindre des raisons, avec l’ambivalence du terme « consacrer » qui renvoie ici à la simple disponibilité requise aussi dans d’autres professions. Rien sur la haute convenance que constitue la configuration sacramentelle au Christ/Époux. Rien sur la radicalité de l’engagement requis par la sequela Christi de tout quitter, y compris sa femme (cf. Lc 4, 34). Si, tactiquement, le document final restreint l’accès au sacerdoce des fameux viri probati, souhaité par le document de travail, aux diacres permanents, il joue encore sur le mot « fécond » qui peut s’entendre à la fois de l’apostolat et de la progéniture. Il y a même une contradiction dans les termes puisque le diaconat permanent est précisément un diaconat qui, bien qu’étant un degré du sacrement de l’ordre, n’est pas une participation ministérielle au sacerdoce du Christ mais un service à l’épiscopat et au presbytérat. Enfin, et surtout, rien sur la continence parfaite, exigée dès le deuxième concile de Carthage (390) de la part du clergé marié « afin de pouvoir obtenir en toute simplicité ce que [les prêtres] implorent du Seigneur et afin qu’ainsi nous gardions ce que les Apôtres nous ont enseigné, et qu’a conservé une coutume ancienne » (1). Au-delà de la fonctionnalité de couvrir un vaste territoire, le sacerdoce trouve dans la continence son pouvoir d’intercession et son origine apostolique.
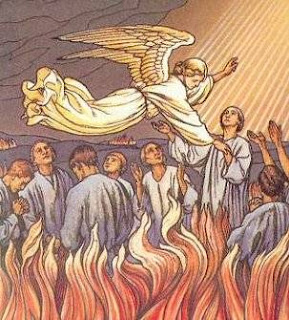

 On peut presque toujours prévoir les limites, l’objet et le langage particulier des synodes. Mais un nouveau terme susceptible d’être significatif a émergé lors des derniers jours du Synode de l’Amazonie. Selon certains les participants au synode ont parlé de changement de mentalité : nous ne penserions plus être les seigneurs et maîtres de la nature, mais ne serions que des ”visiteurs” en ce monde.
On peut presque toujours prévoir les limites, l’objet et le langage particulier des synodes. Mais un nouveau terme susceptible d’être significatif a émergé lors des derniers jours du Synode de l’Amazonie. Selon certains les participants au synode ont parlé de changement de mentalité : nous ne penserions plus être les seigneurs et maîtres de la nature, mais ne serions que des ”visiteurs” en ce monde.

 « Le synode sur l’Amazonie, qui vient de se terminer à Rome, a-t-il répondu à toutes les questions qu’il posait à ses participants ? Sans doute pas tout à fait, si l’on en croit le cardinal
« Le synode sur l’Amazonie, qui vient de se terminer à Rome, a-t-il répondu à toutes les questions qu’il posait à ses participants ? Sans doute pas tout à fait, si l’on en croit le cardinal 
 que,
que,  « Personne ne le conteste : le Pape François est un politique génial. Le document final de l’assemblée du Synode sur l’Amazonie le montre une fois encore.
« Personne ne le conteste : le Pape François est un politique génial. Le document final de l’assemblée du Synode sur l’Amazonie le montre une fois encore.