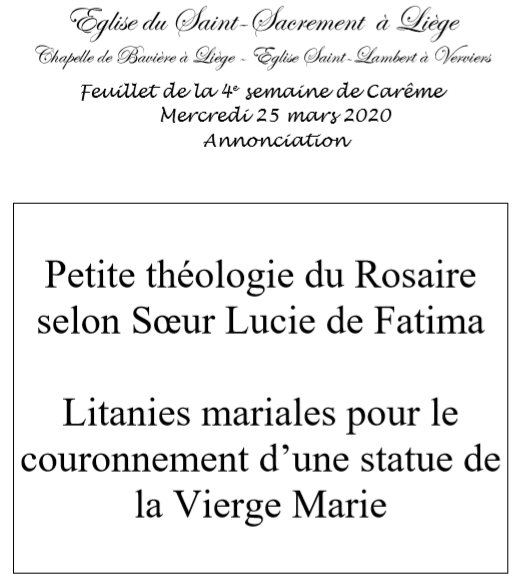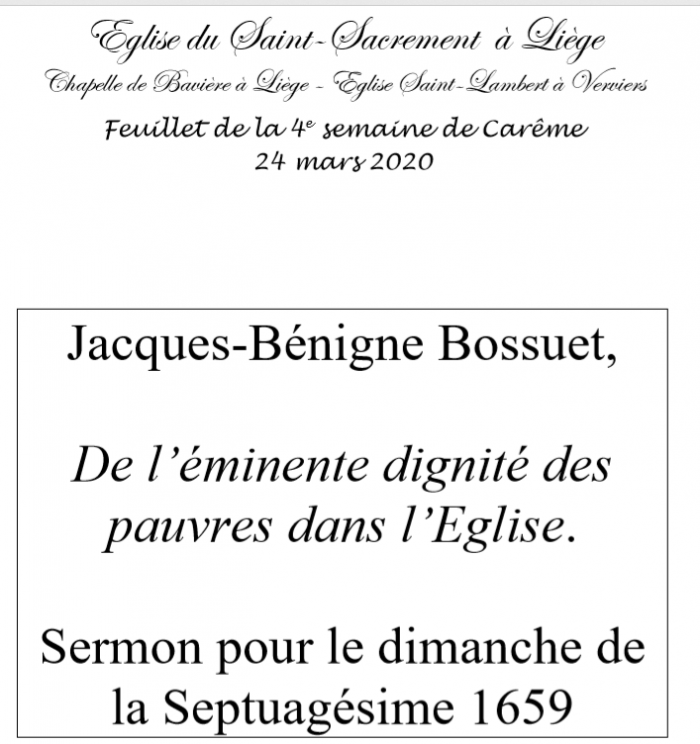BELGICATHO - Page 926
-
Carême et confinement; feuillet du 25 mars (Annonciation) : petite théologie du Rosaire selon Soeur Lucie de Fatima
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Carême et confinement : feuillet du 24 mars; De l'éminente dignité des pauvres dans l'Eglise (Bossuet)
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
L'épidémie de la peur, cette hystérie qui nous submerge
Au delà des discussions concernant les origines et des conséquences du coronavirus, des mesures pour l'éradiquer, du confinement des populations, une constatation s'impose : le coronavirus s'accompagne d'une autre épidémie : LA PEUR, dans une quasi hystérie collective. Comment cette seconde épidémie, irréfléchie, incontrôlée, a-t-elle pu arriver ? A qui profite-t-elle ? Qui l'a causée ? Pourquoi connaît-elle une si grande expansion ?
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Foi, Santé, Société, Spiritualité 0 commentaire -
Consécration au Cœur Immaculé de Marie : les évêques du Portugal appellent tous les épiscopats du monde à se joindre à leur initiative
Du blog de Jeanne Smits :
Face à la crise du coronavirus, l’Église du Portugal renouvellera sa consécration au Sacré-Coeur de Jésus et au Coeur Immaculé de Marie le 25 mars, à la fin du chapelet de 18 h 30 (19 h 30 heure de Paris). L’annonce de cette initiative des évêques du Portugal, samedi, a été suivie de la demande des évêques d’Espagne de pouvoir se joindre à cette démarche. Ce que voyant, l’épiscopat portugais a proposé aux conférences épiscopales du monde entier de se joindre à ce « geste de dévotion ».
La prière de consécration sera prononcée par le Cardinal António Marto, évêque de Leiria-Fatima.
Elle aura lieu dans la basilique de Notre-Dame du Rosaire de à l’occasion de la solennité de l'Annonciation du Seigneur. La cérémonie sera retransmise en direct sur la page en ligne du Sanctuaire de Fatima, et, au Portugal, à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques d'inspiration chrétienne.
« Tous les diocèses seront unis dans la prière du Rosaire aux intentions du monde entier et en particulier du Portugal, dans cette situation dramatique que nous traversons à cause du coronavirus Covid-19 », affirme un communiqué du Conseil permanent de la Conférence épiscopale portugaise (CEP).
Le 20 octobre 2019, les évêques du Portugal ont consacré l'Église catholique au Sacré-Cœur de Jésus, à Fatima, lors de la messe de clôture de l'année missionnaire, au sanctuaire de Fatima, marquant également les 175 ans de l'Apostolat de la Prière au Portugal.
Le site du Sanctuaire rappelle que la première consécration du Portugal au Cœur Immaculé de Marie eut lieu le 13 mai 1931, huit mois après la reconnaissance officielle des apparitions par l'évêque de Leira, au terme du premier pèlerinage national de l'épiscopat portugais à Fatima. Avant la consécration, le Cardinal-Patriarche D. Manuel Gonçalves Cerejeira, avait déclaré :
« Les évêques du Portugal, vos pasteurs, sont réunis ici aujourd'hui pour remercier Notre-Dame de Fatima de la visite qu’elle a daigné faire sur notre terre. Pour que la cérémonie d’action de grâce soit complète, ils consacreront leur travail et le destin du Portugal au Cœur Immaculé de Marie. Cette consécration est le complément de la consécration nationale au Sacré-Cœur de Jésus, faite il y a trois ans par l'épiscopat portugais. En descendant à Fatima, la Vierge a fait de ce lieu le nouveau Bethléem portugais. Si à Bethléhem la Vierge a donné au monde Jésus, Jésus qui est la Vérité, la Vie, le Pardon et la Paix, en descendant à Fatima, elle nous a fait en quelque sorte un nouveau don de son fils.
« Fatima est devenue le sanctuaire national d'où elle répète à tous les peuples : faites tout ce que mon Fils vous dira. Mère de Dieu, nous avons reçu Jésus seulement par vos mains. »
A la fin de ce discours, le cardinal prononçait la prière de consécration. Plus tard, en octobre 1942, l'année où l'on a célébré le 25e anniversaire des apparitions, le pape Pie XII a consacré le monde au Cœur Immaculé de Marie par un message radio.
Evoquant la cérémonie de mercredi prochain, 25 mars, le site du sanctuaire poursuit :
« Le Cœur de Marie s'est présenté à Lucie dès le début, dès la deuxième apparition, comme un refuge et un chemin qui mène à Dieu. De nouveau, en juillet, après la vision de l'enfer, elle l’a réaffirmé en proposant la consécration à son Cœur Immaculé comme moyen de conversion et de réparation. La dévotion au Cœur de Marie devient, surtout avec la demande de consécration de la Russie et tout ce qu’elle allait symboliser, une expression de la présence de Dieu qui accompagne le drame de l'histoire humaine, invitant les croyants à une autre vision de l’histoire, projetée sur une dimension eschatologique. À Pontevedra et à Tuy, dans les visions qui clôturent l'événement de Fatima, l'appel à la consécration a été renouvelé, avec la communion réparatrice des premiers samedis qui lui est associée. »
AciDigital annonçait il y a quelques heures que les évêques du Portugal accueilleront volontiers les demandes des autres conférences épiscopales du monde en vue de se joindre à la consécration de mercredi.
Les demandes devront être faites par les présidents des conférences épiscopales ou par les secrétaires de celles-ci, au nom des présidents. Elles doivent être adressées à Dom Manuel José Macário do Nascimento Clemente, cardinal-patriarche de Lisbonne, ou au secrétaire général de la conférence des évêques du Portugal, le P. Manuel Joaquim Gomes Barbosa, à cette adresse mail :
cep.sgeral@ecclesia.pt. Le numéro de téléphone est précisé par AciDigital.
Le cardinal-patriarche de Lisbonne et le cardinal de Leiria-Fatima ne sont pas particulièrement réputés pour leur orthodoxie. Mais les circonstances réveillent décidément beaucoup de sentiments catholiques !
Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, International, Santé, Spiritualité 0 commentaire -
Croire et comprendre; Saint Thomas et les raisons de la foi
CONFÉRENCE D'OUVERTURE - PHILO à Bruxelles (Cycle 2018-2019) : Croire et comprendre : Saint Thomas et les raisons de la foi Le Moyen Age a élaboré la distinction entre foi et philosophie, non pour les séparer, comme le voudrait une certaine modernité trop sommaire dans ses jugements, mais pour mieux les unir. Dans un opuscule sur Les raisons de la foi, nouvellement traduit par Stéphane Mercier, saint Thomas présente la manière d’aborder les dogmes de la foi avec des interlocuteurs étrangers au christianisme. La foi ne craint pas davantage la raison que celle-ci n’est mise en danger par la Révélation.
Lien permanent Catégories : conférences, spectacles, manifestations, Culture, Eglise, Foi, Idées, Philosophie 0 commentaire -
Que pouvons-nous faire pour profiter pleinement du confinement ?
Du Père Danziec sur le site de Valeurs Actuelles :
La sage leçon d'un prêtre pour profiter pleinement du confinement
22/03/2020
L’inédite situation de repli sur soi dans laquelle notre société se retrouve pourrait être l'opportunité d’un réel et sérieux examen de conscience, estime le père Danziec, dans ce nouveau billet. Plus habituée aux injonctions d’ouvertures, et si la postmodernité trouvait dans cette période de cloisonnement l’occasion historique d’une réflexion intérieure ?
1 milliard. Voilà le nombre de personnes qui se trouvent en ce printemps 2020 confinées dans l’enceinte de leur domicile. Confiner. Retirer. Enfermer. Couper du monde. En clôture. Comme le faisait remarquer le toujours excellent Sylvain Tesson, dans un entretien à lire avec Vincent Trémolet de Villers dans Le Figaro du 20 mars, nous sommes passés en quelques jours du « No borders » au « restez chez vous ». Un volte-face radical, et inattendu. Sorte de révolution copernicienne au forceps. La société postmoderne, si addict au changement, avait pour dieu le philosophe présocratique Héraclite. « Tout est mouvement » selon lui. Ses dogmes s’appelaient multiculturalisme, cosmopolitisme, mondialisme. Ses vertus se déclinaient en compagnies low cost, en parcours erasmus, en émissions de téléréalité “désenracinées”. A travers le confinement de leur population, les pouvoirs publics de 165 pays se placent aujourd’hui, sans le savoir, sous l’égide de Saint Benoît que l’Eglise fêtait hier samedi. Stabilité. Simplicité. Vie domestique en petite communauté. La fameuse règle du fondateur de l’ordre bénédictin dévoile, pour qui veut s’y plonger, des trésors de bon sens et de conseils précieux garantissant la paix d’une vie derrière quatre murs. Ne serait-il pas l’homme de la situation, capable de tirer le meilleur de cette crise en réglant toute chose avec sagesse ? Il n’y a qu’à voir la table des matières de la règle de Saint Benoît qui aborde des sujets aussi variés que la question de “la mesure du boire et du manger”, celle des “sanctions”, du “sort réservé aux vieillards et aux enfants” ou encore du “travail quotidien”.
La décadence d’une société commence quand l’homme se demande : “que va-t-il arriver ? ” au lieu de se demander : “que puis-je faire ?”
L’atmosphère soudainement souverainement calme, particulièrement en milieu urbain, semble insolite et nouvelle pour beaucoup. Sera-t-elle pour autant source d’un recueillement intérieur ou le motif d’une retraite spirituelle pour ce milliard d’hommes ? Le bruit, à défaut de venir du dehors, peut venir, hélas, des écrans. Depuis longtemps, le monde passe sous les fenêtres. Vivre sous cloche n’est plus possible. L’étanchéité relève désormais du mythe. C’est ainsi. Pouvons-nous cependant tirer profit de cette situation inédite pour tous, étrange pour certains, malheureuse pour beaucoup ? Le mystère du mal, selon la théologie catholique (même s’il peut paraître scandaleux de l’aborder en quelques lignes ici), se résume de la façon suivante. Dieu ne veut pas le mal. Jamais il ne saurait en être qualifié l’auteur. Cependant Dieu peut permettre qu’un mal advienne. En ce cas, si sa Providence permet une calamité, ce ne peut être que dans le but d’obtenir un plus grand bien. Plus grand bien qui est réalisé ou non... L’homme est en effet libre dans son for intérieur de tirer, ou non, les conséquences d’une épreuve, d’en recevoir les leçons et de prendre les résolutions qui s'imposent.
Au terme de ce confinement, il sera temps que les hommes d’Eglise de conviction exposent un diagnostic, à la fois exhaustif et précis, sur les maladies spirituelles qui traversent l’âme de la vie des hommes depuis plus de 50 ans. Le philosophe Denis de Rougemont faisait néanmoins ce constat implacable, « la décadence d’une société commence quand l’homme se demande : “que va-t-il arriver ? ” au lieu de se demander : “que puis-je faire ?” ». Sans nul doute, voilà déjà longtemps que nous y sommes. La pandémie actuelle ne fait finalement que mettre en lumière cette décadence morale. Ce lent glissement que la grande majorité se refusait jusqu’alors d’admettre. Un supérieur de communauté sacerdotale l’analysait avec beaucoup d’à-propos « L’homme moderne si fier de ses réalisations est impuissant devant un microbe invisible. (...) Un simple microbe est capable de mettre à genoux l’humanité. A l’ère des grandes réalisations technologiques et scientifiques, c’est surtout l’orgueil humain qu’il met à genoux. (...) Ce n’est pas le moment de laisser le monde entrer chez nous, maintenant que les circonstances et les mesures des autorités nous séparent du monde ! Tirons profit de cette situation. Donnons la priorité aux biens spirituels qu’aucun microbe ne saurait attaquer. »
Ne sommes-nous réduits qu’au seul « restez chez vous » pour nous en sortir ?
Avant de suivre le décompte quotidien des contaminés et des morts du Covid-19, avant de nous demander “ce qu’il va arriver” en suivant à la minute les chaînes d’information en continu, posons-nous la seule question qui vaille. Celle qui refuse la décadence et qui témoigne d’un élan : “Que pouvons-nous faire ?” Seulement rester chez nous ? Ne pouvons-nous que cela ? A l’occasion de ce confinement, l’heure n’est pas à la pause ou à l’arrêt sur image. C’est d’une véritable récréation dont ont besoin les âmes. Se recréer en repassant les ouvrages de leur bibliothèque intérieure. L’humanité a l’occasion historique de revenir à la réalité, au concret et à l’humble valeur des vertus domestiques.
Dans la préface de son recueil Les plaisirs et les Jours, Proust se confiait. « Quand j’étais enfant, le sort d’aucun personnage de l’Histoire Sainte ne me semblait aussi misérable que celui de Noé, à cause du déluge qui le tint enfermé dans l’arche pendant quarante jours. Plus tard, je fus souvent malade, et pendant de longs jours, je dus rester dans “l’arche”. Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l’arche, malgré qu’elle fût close et qu’il fît nuit sur la terre. » L’arche de notre confinement s’apparente à la chambre du jeune Marcel souffrant. Nous souffrons actuellement de bien des choses. Pour en guérir, il nous appartient de commencer par mieux voir le monde. D’y faire le tri. Se retrouver soi-même. Et retrouver Dieu. Ce virus n’aura alors peut-être pas fait beaucoup de bruit pour rien.
-
Le chant d'un rossignol qu'on préfèrerait ne pas entendre
CORONAVIRUS ET IVG : LAURENCE ROSSIGNOL DEMANDE L'EXTENSION DES DÉLAIS D'AVORTEMENT
synthèse de presse bioéthique de genethique.org
23 mars 2020
« Les services d’orthogénie constatent que les restrictions de circulation à l’intérieur et à l’extérieur du territoire français combinées aux bouleversements de l’activité hospitalière fragilisent les conditions d’accès à l’IVG et renforcent les inégalités territoriales », stipule un amendement au projet de loi urgence covid-19.
Alors que la France traverse une crise sanitaire sans précédent et « que de nombreux professionnels de santé, quelles que soient leurs spécialités, sont mobilisés en priorité pour prendre en charge les malades touchés par le coronavirus », Laurence Rossignol, sénateur et ancienne ministre socialiste, a déposé un amendement au projet de loi urgence covid-19 pour demander au gouvernement « d’allonger de deux semaines les délais légaux d’IVG » et aussi de « supprimer l’exigence d’une deuxième consultation pour les mineures ». L’objectif étant de favoriser une ultime extension des conditions d’accès à l’avortement. « Etonnant sens des priorités… »
La semaine dernière déjà, un décret publié au Journal officiel permet aux pharmaciens de délivrer les pilules contraceptives aux patientes « dans le cadre de la posologie initialement prévue » et sur présentation de l’ancienne ordonnance. La mesure prise depuis dimanche 15 mars devrait être effective jusqu'au 31 mai.
Olivier Véran, ministre de la santé, et Murielle Pénicaud, ministre du travail ont « toutefois émis leur désaccord » concernant l’avortement. Ils ne semblent pas vouloir aménager les conditions d’accès à l’IVG pendant la crise sanitaire.
Sources: Valeurs actuelles (21/03/2020) - France info (18/03/2020)
Ces curieuses priorités qui tendent coûte que coûte à sauvegarder la pratique de l'élimination d'enfants à naître sont également présentes en Belgique où les centres de planning familial s'organisent pour poursuivre l'accueil des femmes en demande d'avortement. Le fait que le fléau du coronavirus frappe des pays qui ont perdu tout sens moral et ont inscrit dans leurs législations des lois contraires au respect de la vie ne semble pas faire réfléchir grand monde. On assiste par ailleurs à un rush vers les sites porno. La route vers une remise en cause des dérives éthiques de nos sociétés promet d'être encore longue...
-
Peut-on prier dans les églises à l’heure du confinement ?
Sur le site web de « Famille Chrétienne », Jean-Marie Dumont décrit la situation en France :

« Aucune messe n’est célébrée dans les églises de France, mais beaucoup restent ouvertes. Exemple dans les églises de Paris où la prière individuelle se poursuit. En mode mineur.
A l’église Notre-Dame des Foyers, dans le 19e arrondissement, un prêtre prie en silence agenouillé devant le Saint-Sacrement. L’église est vide. Il est seul. Le quartier est plongé dans une étonnante torpeur qui rappelle le cœur de l’été. Personne ne circule dans les rues. Deux SDF sont allongés par terre. Les rues et les avenues avoisinantes sont désertes. Deux sportifs, les écouteurs vissés sur les oreilles, se croisent, échangent un regard furtif et gardent prudemment leurs distances. Depuis quelques heures, les mesures de restriction des déplacements destinées à limiter l’expansion du coronavirus sont entrées en vigueur et cela se voit.
Un peu plus loin, les battants modernes de l’église Saint-Luc sont grand ouverts eux aussi. Personne. Seule la lampe du Saint-Sacrement indique que la vie continue. Le silence est total. Le courant d’air qui pénètre dans l’édifice fait grincer une porte. Le Christ en Croix jette un regard compatissant sur tout visiteur qui se présente. Il est rare de pouvoir prier dans un tel calme.
Cinq cents mètres plus loin s’élève la belle façade de l’église Saint-Jacques-Saint-Christophe. Près de l’édifice néo-classique se déroule chaque dimanche un bruyant marché. A l’intérieur, un sac de courses à la main, un homme s’est assis quelques instants, devant une statue de Notre-Dame de Fatima. Il prie dans un calme absolu, un peu penché en avant. Mais rapidement, il se lève, et reprend le chemin de son proche domicile. Dans cette église aussi, seule la présence de Dieu dans le tabernacle habite désormais l’église vide.
« La prière d’adoration se fait devant le tabernacle »
Dans la capitale désertée où tout s’est arrêté, les églises restent ouvertes et la prière se poursuit. Mais elle est comme mise en sourdine. « Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts », a indiqué le ministère de la Santé dans son arrêté du 14 mars, mis à jour le 16 suite à l’interdiction de se déplacer de son domicile prise par décret lundi. Les rassemblements ou réunion de plus de vingt personnes y sont toutefois « interdits jusqu’au 15 avril 2020 ». Dans un message du 17 mars à ses frères évêques, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a confirmé que « les églises peuvent être ouvertes, avec moins de vingt personnes en prière individuelle et à distance les unes des autres ». « Aucune messe (dominicale, de semaine, de funérailles) avec une assemblée, de quelque taille qu’elle soit, ne doit être célébrée », a-t-il aussi demandé.
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, Santé, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
Directives des évêques de Belgique pour la Semaine Sainte : toutes les célébrations religieuses publiques sont annulées
Semaine Sainte : toutes les célébrations religieuses publiques sont annulées

Directives des évêques de Belgique
La propagation du coronavirus contraint toutes les autorités et institutions publiques de notre pays à une extrême prudence. L’Église veut, elle aussi, endiguer la propagation de ce virus. Les évêques de Belgique ont dès lors décidé de prolonger la suspension de toutes les célébrations religieuses publiques et ce jusqu’au 19 avril inclus. Ces dernières reprendront lorsque les autorités tant civiles et qu’ecclésiastiques l’auront autorisé. Les évêques prennent ces mesures conformément aux adaptations possibles pour la célébration du temps pascal, telles que le Pape François les a proposées et données en exemple.
Tous les services liturgiques de la Semaine Sainte (5-12 avril 2020) sont suspendus. Chaque évêque peut établir une exception pour quelques lieux afin que les fidèles puissent suivre ces services à la radio, à la télévision ou en livestream. Seuls les collaborateurs nécessaires pour l’enregistrement de la célébration pourront se trouver dans l’église. Ils respecteront avec soin les règles de la ‘distance sociale’.
Cette suspension s’applique à toutes les églises et chapelles où se célèbre publiquement le culte, y compris les chapelles ou lieux de prière des monastères, des institutions catholiques ou des lieux de pèlerinage. Elle s’applique également aux communautés non-catholiques qui font usage des églises ou des chapelles catholiques. Les communautés contemplatives ou monastiques célèbreront la prière des heures et les offices de la Semaine Sainte en cercle fermé, sans hôtes, ni visiteurs.
L’information sur les services liturgiques diffusés à la radio, à la télévision ou en livestream pendant la Semaine Sainte sera disponible sur le site de Cathobel et de Kerknet ainsi que sur les sites diocésains ou vicariaux.
1. Dimanche des Rameaux
Bien qu’il n’y ait pas de célébrations publiques, quelques célébrations avec seulement quelques personnes sont prévues en vue des diffusions à la radio, à la télévision ou en livestream. Elles se dérouleront en cercle fermé et dans le respect de la distance de sécurité prescrite. Les rameaux bénits ne seront mis à disposition ni à l’intérieur ni à l’extérieur de l’église. Il y a pour cela une double raison. Une raison liturgique : ces rameaux font partie de la liturgie du dimanche des Rameaux. Une raison préventive : éviter tout rassemblement.
2. Messe chrismale
La bénédiction des Saintes Huiles et la consécration du Saint Chrême (pour le baptême, la confirmation, l’ordination presbytérale et l’onction des malades) aura lieu en cercle fermé et sera présidée par l’évêque et quelques prêtres. Chaque évêque a également la possibilité de reporter la célébration de la messe chrismale jusqu’à l’autorisation de reprise des célébrations liturgiques publiques. Les Saintes Huiles seront distribuées après la pandémie selon les directives de chaque diocèse.
3. Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée pascale et Pâques
Seules les célébrations avec quelques personnes en vue de leur diffusion à la radio, à la télévision ou en streaming pourront avoir lieu. Elles se dérouleront cercle fermé, dans le respect de la distance de sécurité prescrite.
En raison des mesures actuelles, le sacrement de réconciliation individuel ne pourra être conféré. Les évêques de Belgique autorisent les fidèles à reporter leur confession pascale à une date ultérieure. Ou, comme l’a récemment déclaré le Pape François au vu des circonstances exceptionnelles de cette année : Oui, il est possible de recevoir le pardon de Dieu sans prêtre. Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : ‘Seigneur, j’ai commis le mal en ceci, en cela, …” Demande-lui pardon de tout ton cœur avec l’acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu.
Comment célébrer Pâques sans confession ni communion, ou ‘faire ses Pâques’ cette année ? En faisant ce qui est possible : prier à la maison, seul ou en famille ; lire et méditer les lectures et les prières prévues pour la Semaine Sainte ; suivre une célébration liturgique à la radio, à la télévision ou en livestream.
4. Baptêmes d’adultes
Cette année, les baptêmes d’adultes ne pourront avoir lieu ni la nuit, ni le jour de Pâques. Les évêques sont unis à tous ceux qui se préparent de longue date à leur baptême pour Pâques. Ils comprennent leur déception et leur demandent de la patience. Ils leur proposeront dès que possible une autre date ou une autre période pour leur baptême.
5. Baptêmes et mariages religieux
Tous les baptêmes et mariages religieux sont reportés jusqu’à ce que ces célébrations soient à nouveau possibles. Les évêques prennent cette décision difficile, tout en partageant la déception de tous ceux qui avaient préparé avec soin et attendaient intensément leur mariage ou le baptême de leur enfant.
6. Confirmations et premières communions
Les célébrations de la confirmation et de la première communion prévues jusqu’au 19 avril ne pourront malheureusement pas avoir lieu. C’est une décision grave dont nous mesurons pleinement l’impact pour les enfants et les jeunes concernés, pour leurs familles et pour la paroisse. En ce qui concerne les confirmations et premières communions prévues après le 19 avril, il est trop tôt en ce moment de prendre des décisions définitives. Les évêques communiqueront le plus tôt possible et dès que les mesures du gouvernement le permettront, les informations nécessaires.
7. Ouverture des églises
Sauf décision contraire de la commune, les églises restent ouvertes pour la prière individuelle et le recueillement quand c’est possible. L’église, en tant qu’espace public, est bien évidemment soumise aux mesures gouvernementales, dont la distance de sécurité.
8. Campagnes de Carême Entraide et Fraternité et Broederlijk Delen
Les campagnes annuelles de Carême des deux organisations liées à l’Eglise ne sont quant à elles pas suspendues. Seules les collectes ecclésiales en liquide ne pourront avoir lieu. Les évêques appellent les fidèles à poursuivre la solidarité avec les populations et les pays dans le besoin et à effectuer leur don annuel par virement bancaire. Pour Entraide et Fraternité via le compte BE68 0000 0000 3434 et pour Broederlijk Delen via le compte BE12 0000 0000 9292.
9. Les cloches de remerciement et d’espérance
Les évêques s’associent à toutes les marques de gratitude et d’estime de la population envers ceux qui s’investissent dans la lutte contre le coronavirus : médecins, infirmières et infirmiers, services de police et d’urgence, décideurs politiques et leurs administrations. Les paroisses qui le souhaitent peuvent bien sûr s’associer à ceux qui applaudissent le soir les personnes engagées dans la lutte contre le coronavirus. Elles peuvent mettre par exemple une bougie devant la fenêtre ou faire sonner les cloches (de préférence les cloches de l’angélus à celles des fêtes).
10. Médias
Les diocèses restent autant que possible en contact avec l’ensemble des croyants, aussi bien au plan national qu’au plan diocésain, par le biais de messages vidéo ou en livestream. Vous trouverez les liens utiles et les aperçus sur les pages interdiocésaines et diocésaines de Cathobel ou de Kerknet.
La RTBF et la VRT essayent de poursuivre la diffusion, le dimanche, des célébrations eucharistiques à la radio et à la télévision. RCF, KTO, France 2, Radio Maria et NPO Nederland diffusent également des célébrations religieuses. Les évêques de Belgique
SIPI – Bruxelles, lundi 23 mars 2020
-
Quand les séminaristes du Bon Pasteur se lâchent...
Institut du Bon Pasteur
Retrouvez la veillée du dimanche de Lætare (22 mars 2020), en compagnie des prêtres et des séminaristes de l'Institut du Bon Pasteur. Liste des chants : 1. Pelot d'Hennebont 2. La Piémontaise 3. Les Bleus sont là 4. Santiano 5. Un gai luron des Flandres 6. (Tour de magie) 7. L'habitant de saint Roch 8. Les cosaques 9. (Hommage à la FSSP) 10. Cavalcade 11. (La vie de saint Roch) 12. La strasbourgeoise 13. Miserere de la mer 14. Prière et chant final
-
Le coronavirus : un châtiment divin ?
Du Professeur Roberto de Mattei de la Fondation Lepanto :
Le Coronavirus est-il un châtiment divin ? Considérations politiques, historiques et théologiques - Le sujet de mon intervention s’intitule : “les nouveaux scénarios en Italie et en Europe pendant et après le Coronavirus”. Je n’aborderai pas la question d’un point de vue médical ou scientifique : je n’en ai pas la compétence. Mais je traiterai cette question sous trois autres angles : celui du spécialiste de sciences politiques et sociales ; celui de l’historien ; et celui du philosophe de l’histoire.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Foi, Idées, Philosophie, Politique, Santé, Société, Spiritualité 0 commentaire -
25 Mars : consécration de l'Espagne et du Portugal au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie
25 Mars : consécration de l'Espagne et du Portugal au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie
23 Mars 2020

La Conférence épiscopale espagnole est jointe à la convocation de la Conférence épiscopale du Portugal pour la récitation du Rosaire aura lieu le mercredi , 25 Mars Solennité de l'Annonciation du Seigneur, au sanctuaire de Fatima à 19,30
La récitation du Rosaire, offerte par les victimes du coronavirus, leurs familles, le personnel de santé, etc., sera présidée par l'évêque de Fatima, Card. António dos Santos Marto.
À la fin de la récitation du Saint Rosaire, le Cardinal fera la Consécration au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie dans toute la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, et leurs îles respectives.