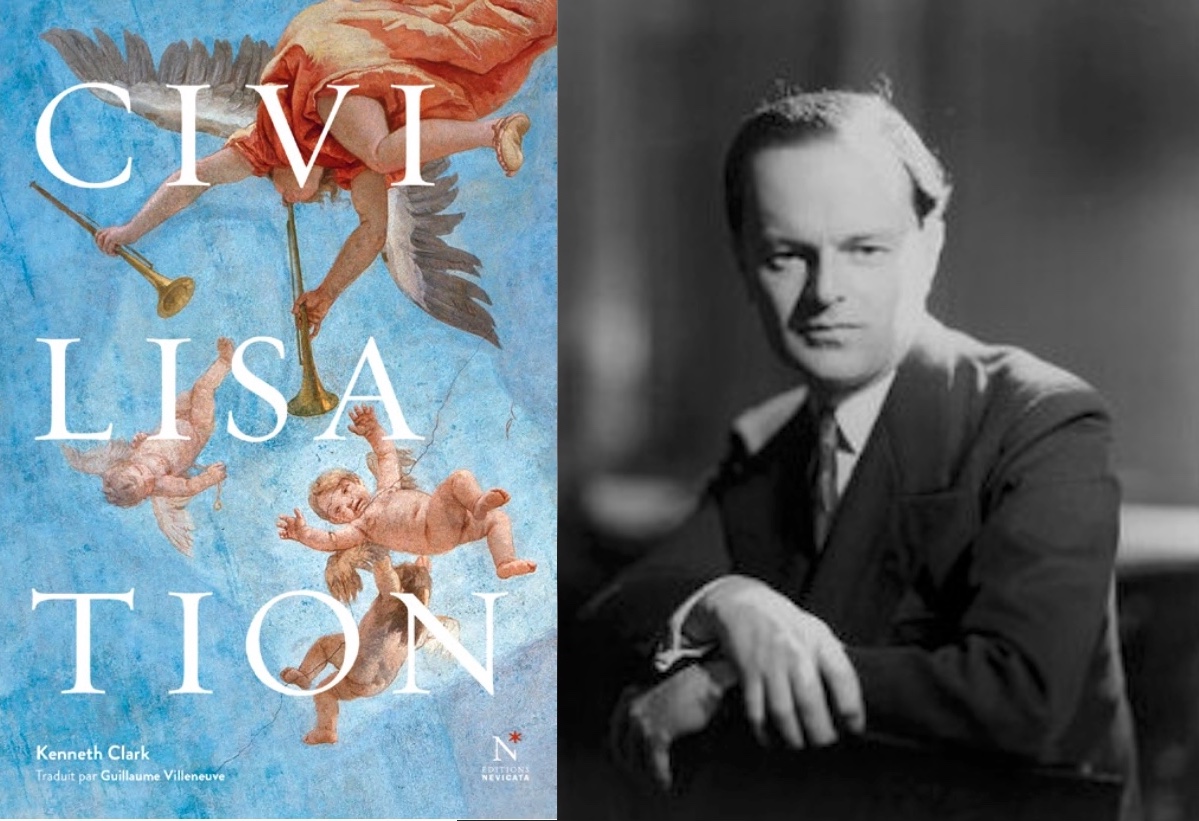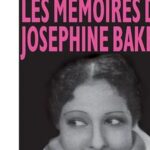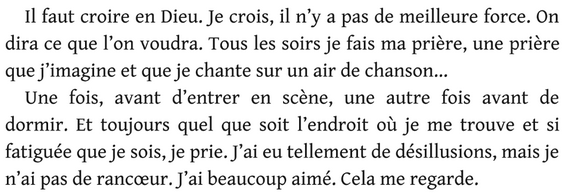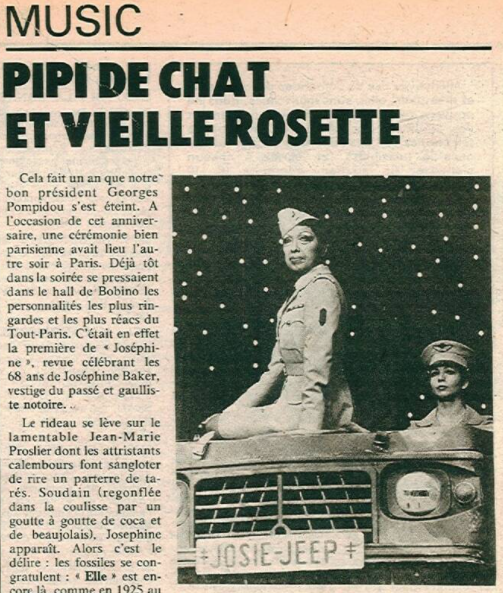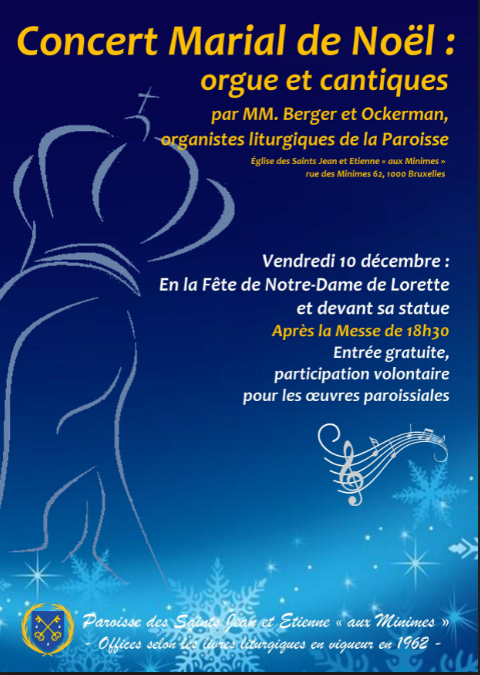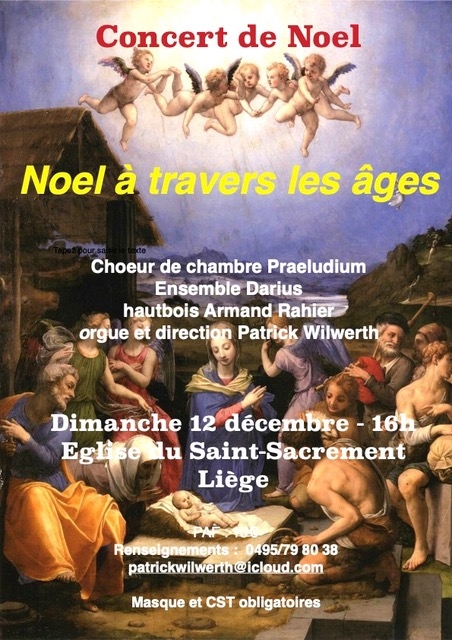De sur le site d'Ouest-France :
Notre-Dame de Paris. Voici comment l'intérieur de la cathédrale va être réaménagé
La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a validé ce jeudi 9 décembre les grandes lignes du projet présenté par le clergé. Mais attend des précisions sur plusieurs points. Elle a aussi refusé que les statues des saints dans les chapelles soient dispersées dans l’édifice. Et l’aménagement d’un espace de prière dans le chœur. Le projet global fait déjà polémique.
La commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) a validé dans ses grandes lignes le réaménagement intérieur et liturgique de Notre-Dame de Paris, présenté par le clergé. Ne refusant que deux opérations, et demandant des précisions sur d’autres, a indiqué son président Albéric de Montgolfier, à l’issue de la réunion consacrée à ce projet très attendu pour l’édifice accueillant en temps normal plus de 12 m illions de visiteurs par an. Et qui ravive déjà les querelles…
Des objets d’art modernes dialoguent avec des tableaux anciens
Plus de deux ans et demi après l’incendie qui a touché la cathédrale, le diocèse entend lui donner une nouvelle jeunesse avant sa réouverture au public et au culte en 2024. Son programme, déjà partiellement dévoilé, propose un changement dès l’entrée dans l’édifice, prévu par le portail central et non plus par les latéraux. Le parcours, dont le sens de circulation serait modifié du nord vers le sud, sera aéré autour d’un axe central épuré, de la nef au chœur. Les experts « se sont mis d’accord sur l’axe liturgique central et le mobilier (baptistère, autel, tabernacle) qui devra être conçu par un même créateur », indique encore Albéric de Montgolfier, sénateur LR d’Eure-et-Loir.
Les 24 chapelles de Notre-Dame vont bénéficier d’un nettoyage complet durant le chantier de restauration. Dans les quatorze latérales, la majorité des confessionnaux, datant parfois de la restauration par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, y seront retirés et des œuvres contemporaines pourraient « dialoguer » avec des « Mays », tableaux d’autel commandés à de grands artistes entre 1 630 et 17 07.
Mais la commission « refuse que les statues de saints qui se trouvaient sur les autels dans ces chapelles n’en sortent. Qu’elles soient déplacées pour faire un alignement envisagé le long des grands piliers de la cathédrale ». Elle s’est « opposée aussi à un espace de prière prévu dans le chœur, en raison de la fragilité du sol. Il pourrait être abîmé par le passage des fidèles et des touristes. »
« De telles propositions dénaturent le décor… »
Le projet de réaménagement vise également l’éclairage, avec une lumière à hauteur de visage. Ainsi que des projections sur les murs de phrases bibliques en plusieurs langues. Il prévoit encore que les chaises séculaires cèdent leur place à des bancs à roulettes dotés de lumignons. Mais sur ce dernier point, les experts de la CNPA ont émis des réserves. Ils demandent au clergé « de revoir le modèle de banc, et qu’un prototype leur soit soumis », sans doute début 2022 .
« Tout cela permet au diocèse d’avancer dans son projet. Il pourra nous apporter des précisions », ajoute Albéric de Montgolfier, soulignant que « toutes les œuvres se trouvant dans la cathédrale antérieurement à l’incendie y resteront présentées ».
Avant même la réunion de la commission, le projet était déjà très critiqué. Il « dénature entièrement le décor et l’espace liturgique », ont dénoncé une centaine de personnalités, dont Stéphane Bern ou le philosophe Alain Finkielkraut, dans une tribune publiée mercredi dans Le Figaro. Appelant « à respecter l’œuvre de Viollet-le-Duc ».
Lire également, sur Aleteia :