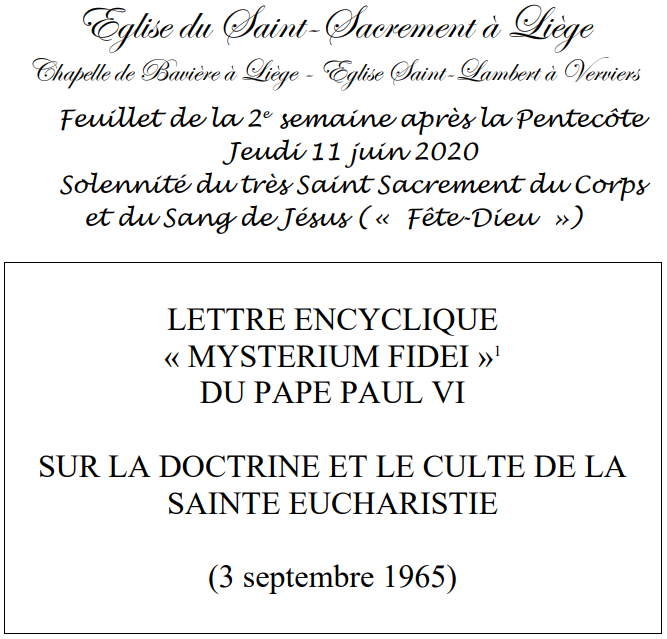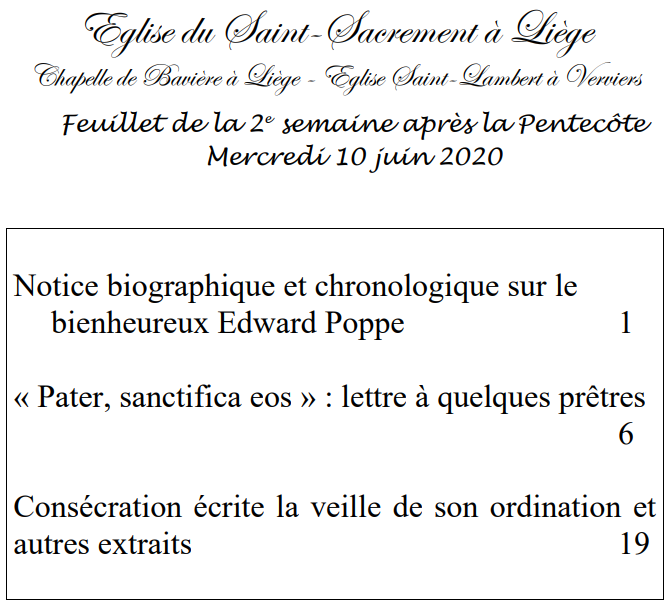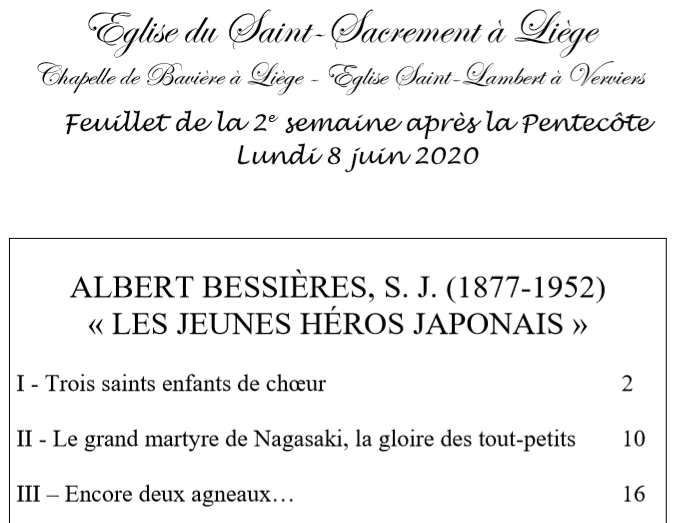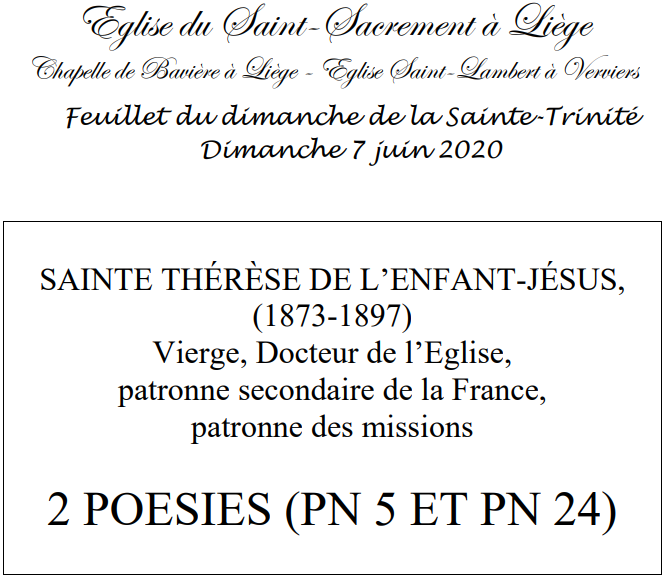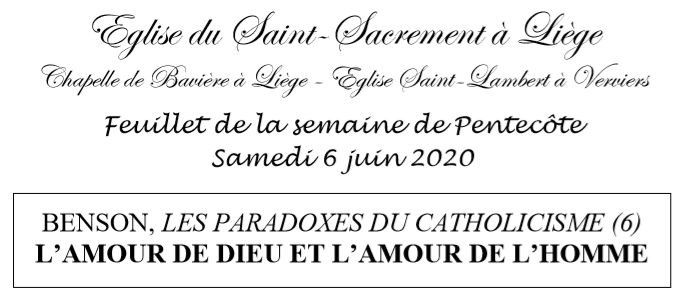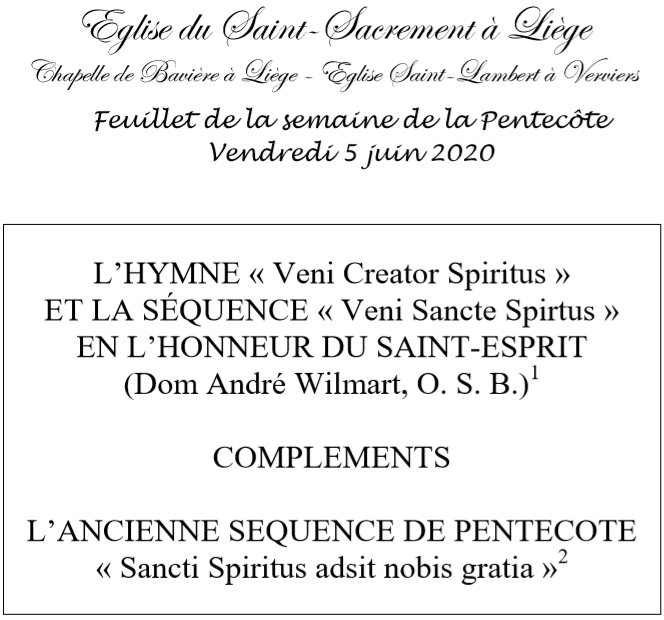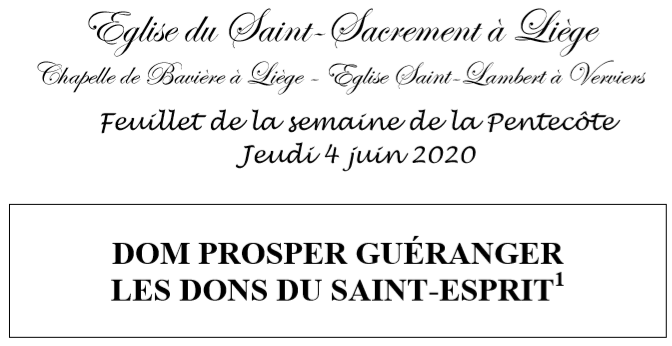Au rythme de l'année liturgique - Page 141
-
Feuillet du Jeudi (18 juin) de la Fête-Dieu : l'encyclique "Mysterium Fidei" de Paul VI
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Feuillet du mercredi (10 juin) de la 2ème semaine après la Pentecôte : notice biographique et chronologique sur le bienheureux Edward Poppe
 Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
Le bienheureux Edouard Poppe, apôtre de l'Eucharistie et de la Mission (10 juin)

Du site "Evangile au Quotidien" :
Bx Édouard Poppe - PRÊTRE († 1924) - Fête Le 10 Juin
Prêtre « Apôtre de l'Eucharistie et de la Mission »Edward Poppe naît à Moerzeke (Belgique) le 18 décembre 1890 dans une famille de boulangers très pieuse. En mai 1909, il entra au séminaire et fut ordonné prêtre en 1916.
Il commença son ministère comme vice-curé de Sainte-Colette, dans un quartier ouvrier de Gandt. C'est là que naquit son amour pour les pauvres, les marginaux et les enfants. Cela l'incita à vivre une vie de grande pauvreté personnelle et à prêter une attention particulière à l'éducation à la foi de ses fidèles à travers la catéchèse et l'Eucharistie.À la fin de la Première Guerre mondiale, il alla vivre dans la zone rurale de Moerzeke, où il fut aumônier d'une communauté religieuse. Il se consacra à la contemplation et à l'étude, à la prédication et à l'apostolat. Sa maison était ouverte à tous et se transforma en lieu de prière.Le 15 septembre 1920, il se rendit sur la tombe de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, à Lisieux, ce qui fut un moment fondamental de sa vie spirituelle. Il fut un précurseur de son temps, mobilisant tous les éducateurs pour une campagne de réévangélisation, dont le point de départ et d'arrivée devait être l'Eucharistie.En octobre 1922, il alla à Leopoldsburg, où il se chargea de la direction spirituelle des prêtres de tout le pays appelés au service militaire. Ce furent ses derniers mois d'activité apostolique. Il y fit passer son message, non seulement auprès des prêtres soldats, mais aussi auprès des fidèles, sensibilisés ainsi à l’Évangile et à leur mission. Il apprend à « se livrer, mains vides, au feu du brasier de l'amour de Dieu pour la sanctification de ses confrères ».Il meurt le matin du 10 juin 1924, les yeux fixés sur l'image du Sacré-Cœur, pleuré par toute la Flandre. Il avait 34 ans.
Édouard Poppe a été béatifié le 3 octobre 1999 par saint Jean-Paul II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005) qui, durant la cérémonie de béatification, a dit : « Le Père Poppe, qui a connu l'épreuve, adresse un message aux malades, leur rappelant que la prière et l'amour de Marie sont essentiels à l'engagement missionnaire de l'Église ».Pour un approfondissement biographique : >>> Vie et spiritualité d'Édouard Poppe
Un nouveau livre : "Le héros de mon enfance", sur le Bienheureux Edouard Poppe, prêtre du diocèse de Gand, figure emblématique de l’église du 20e siècle, et béatifiée par Saint Jean-Paul II en 1999 à Rome. Le livre est composée d'une introduction de la main du recteur du sanctuaire du Bx. Poppe, abbé Edward Janssens, et de 52 méditations tirée des lettres, des livres et des notes du journal spirituel du Bx Poppe. Le livre est une traduction du livre "De held van mijn kinderjaren" paru en 2018 en Néerlandais et éditée par les Editions Betsaïda (Boîs - le - Duc, Hollande). Le livre est en vente pour 10 euro. Le prix d' achat pour les librairies est fixée à 6 euro. Pour votre commande vous pouvez contacter le secrétariat du comité du Bx. Edouard Poppe: priester.poppe@edpnet.be Ou bien téléphoner: 0475 / 69 25 59 ou 03/ 344. 92 15 Nous vous assurons un transport sans frais supplémentaires. Merci pour votre attention et en attendant votre réponse nous vous saluons avec le plus grand respect, Mme Gracy Peelman, secrétaire du comité Priester Edward Poppe comité Molenstraat 7 9220 Hamme (Moerzeke)"
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Belgique, Eglise, Foi, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
Belgique : Fête-Dieu 2020 à Liège

Ce jeudi 11 juin aura lieu la 768ème Fête-Dieu à Liège. Cet événement est exceptionnel pour deux raisons. D’abord, ce sera la première grande messe publique après 3 mois de confinement. Quel belle coïncidence pour la fête du Corps et du Sang du Christ, fête de l’eucharistie, de la messe qui sera célébrée par les catholiques dans le monde entier. Cette fête est née à Liège en 1246 grâce à sainte Julienne de Cornillon et au premier pape liégeois : Urbain IV. Ensuite, cette période de confinement et d’isolement forcé à cause de cette maladie Covid19 nous rappelle que de tous temps, des soignants ont pris des risques pour soulager des souffrants. Sainte Julienne fut directrice de la léproserie du Mont-Cornillon, un des premiers hôpitaux de Liège, au pied de ce qui est devenu la Chartreuse. Elle s’est occupée des exclus de l’époque, les lépreux. Ce n’est pas un hasard qu’environ la moitié des infirmières liégeoises sont formées à l’école « sainte Julienne ». Les prières soutiendront les soignants.
Les festivités 2020 sont simplifiées et font preuve de créativité pour permettre au plus grand nombre de participer compte tenu des contraintes sanitaires. En particulier, pour la messe de la Fête-Dieu à la basilique Saint-Martin ce jeudi 11 juin à 19h00. Le nombre de places est limité à 100, incluant 25 places pour les célébrants et les divers services. En fait, il y aura 3 messes à Saint-Martin: 9h par le chanoine Jean-Pierre Pire, doyen de Liège, à 12h par Marek Adamczuk, curé de Saint-Martin et à 19h par Mgr Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège, suivie de la NightFever de 20 à 22h. Une billetterie sera ouverte dès ce mardi 9 juin à 9h00 sur le site www.liegefetedieu.be. Sinon, les évènements pourront également être suivis via les médias ou les réseaux sociaux.
Le programme complet des festivités est repris sur le site www.liegefetedieu.be
2 grandes conférences diffusées sur RCF et les réseaux sociaux :
- mercredi 19h, depuis son ermitage dans les alpes suisses : le père Nicolas Buttet « Fête-Dieu, Pentecôte eucharistique »
- vendredi 19h, depuis le sanctuaire de Cornillon : Mgr Jean-Pierre Delville « Sainte Julienne de Cornillon, messagère de la Fête-Dieu, signe du temps présent »
4 journées de prière et d’adoration dans 4 hauts-lieux spirituels de Liège
Plusieurs eucharisties à la cathédrale Saint-Paul, à l’église du saint-Sacrement, à la basilique Saint-Martin, à CornillonAnnexe :
Programme complet de Liège Fête-Dieu 2020Mercredi 10 juin : Ouverture
19h00 : "Fête-Dieu, Pentecôte eucharistique", Conférence d’ouverture par le père Nicolas Buttet, fondateur d’Eucharistein, suivi d’un temps de méditation – A suivre à distance en audio et vidéoJeudi 11 juin : Jour de la Fête-Dieu à Liège, à la basilique Saint-Martin
9h00 : Première messe de la Fête-Dieu, célébrée par Jean-Pierre Pire, doyen de Liège – Sur réservation à partir du mardi 9 juin à 9h00
10h00-18h30 : Journée d’adoration à Saint-Martin
12h00 : Seconde messe de la Fête-Dieu, célébrée par Marek Adamczuk, curé de saint-Martin – Sur réservation à partir du mardi 9 juin à 9h00
19h00 : 768ème Eucharistie solennelle de la Fête-Dieu, présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège – Sur réservation à partir du mardi 9 juin à 9h00 ou à suivre à distance en audio et vidéo
20h00-22h00 : Veillée NightFever – Eglise ouverte, coeur ouvert – Sur réservationVendredi 12 juin : Cathédrale saint Paul et Sanctuaire de Cornillon
9h00 – 17h00 : Journée d’adoration à la cathédrale Saint-Paul, animée par le Mouvement Eucharistique Liégeois
19h00 : Conférence de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège « Sainte Julienne de Cornillon, messagère de la Fête-Dieu, signe du temps présent », suivi d’un temps de méditation-adoration au sanctuaire sainte Julienne de Cornillon, pour les soignants et les soignés, animée par la Communauté de l’Emmanuel – A suivre à distance en audio et vidéoSamedi 13 juin : Eglises Saint-Pholien et du Saint-Sacrement
9h00-17h00 : Journée d’adoration à l’église Saint-Pholien en Outremeuse, animée par Venite Adoremus
19h00 : Solennité de la Fête-Dieu à l'église du Saint-Sacrement célébrée par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège (rite et chants traditionnels) suivi d’un temps d’adoration animée par Sursum Corda – Sur réservation ou à suivre à distance en audio et vidéoDimanche 14 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ partout en Belgique
9h00 – 17h00 : Journée d’adoration au Sanctuaire de saint-Julienne du Mont-Cornillon
10h00 et 16h30 : Eucharisties à la cathédrale Saint-Paul de Liège, dont une célébrée par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, avec une homélie du nouveau vicaire général de Liège, le chanoine Eric de Beukelaer. Informations sur le site de la cathédraleCertains évènements seront retransmis par la radio ou par internet :
Audio / radio : RCF Liège 93.8 FM, 1RCF Belgique DAB+, www.rcf.be
Lien Doyenné de Liège youtube
Lien RCF Liège Facebook ou Youtube
Lien NightFever Liège YoutubeContacts et informations : www.liegefetedieu.be – info@liegefetedieu.be – http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com
-
Feuillet du lundi (8 juin) de la 2ème semaine après la Pentecôte : les jeunes héros japonais (Bessières)
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Feuillet du dimanche de la Sainte Trinité (7 juin) : deux poésies de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore (Sainte Elisabeth de la Trinité)
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore
(Sainte Elisabeth de la Trinité)
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire Sortir de vous, ô mon Immuable , mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère.Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi , tout adorante , toute livrée à votre Action créatrice.
Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre Coeur, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir ! Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me « revêtir de vous même », d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir , de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement.
Ô Feu consumant , Esprit d'amour, « survenez en moi » afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, « couvrez-la de votre ombre », ne voyez en elle que le « Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances »
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds , je me livre à vous comme une proie . Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs .
21 novembre 1904 (Notes Intimes 15)Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
O lux beata Trinitas (Hymne grégorien pour la Sainte Trinité)
Hymnus
O lux beata Trinitas
et principals Unitas,
iam sol recedit igneus :
infunde lumen cordibus.te deprecemur vespere ;Lumière, heureuse Trinité,
qui es souveraine Unité,
quand l'astre de feu se retire,
répands en nos cœurs ta clarté.Te mane laudum carmine,
te nostra supplex gloria
per cuncta laudet saecula.A toi nos hymnes du matin,
à toi nos cantiques du soir,
à toi, pour les siècles des siècles,
la prière de notre gloire.Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Feuillet du samedi (6 juin) de la semaine de Pentecôte : "L'amour de Dieu et l'amour de l'homme" (Benson)
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Feuillet du vendredi (5 juin) de la semaine de la Pentecôte : l'hymne et la séquence en l'honneur du Saint-Esprit
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
François demande de prier pour tous ceux qui traversent des difficultés, afin qu’ils puissent trouver des chemins de vie dans le Cœur de Jésus
De Vatican News :Dans la Vidéo du Pape du mois de juin, relayant l’intention de prière mensuelle du Saint-Père, la compassion et la tendresse sont mises en avant: François demande de prier pour tous ceux qui traversent des difficultés, afin qu’ils puissent trouver des chemins de vie dans le Cœur de Jésus.Alors que la pandémie de coronavirus est toujours présente dans de nombreuses régions du monde, le Saint-Père n’oublie pas ceux qui traversent toutes sortes de difficultés. En ce mois de juin, il demande de prier spécialement pour que tous ceux qui souffrent «trouvent des chemins de vie, en se laissant toucher par le Cœur de Jésus».
Là où il y a de la douleur, là où il y a de la souffrance, là où il y a des épreuves, le Cœur de Jésus est là. Personne n’est seul. Le message du pape François nous rappelle qu’il existe un chemin pour aider quiconque en a besoin. Il nous exhorte à nous approcher du Sacré-Cœur car il est capable d’accueillir «tout le monde dans la révolution de la tendresse».
Juin, mois du Sacré-Cœur de Jésus
La dévotion au Cœur de Jésus, auquel le mois de juin est consacré, a une longue histoire. Du «cœur transpercé de Jésus» dans l’Évangile de Saint-Jean - interprété dans la mystique médiévale comme la blessure qui manifeste la profondeur de son amour - en passant par les révélations à Sainte Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle et le culte ultérieur du Sacré-Cœur au XIXe siècle, jusqu’à la Divine Miséricorde avec Sainte Faustine Kowalska au début du XXe siècle. Le pape Pie XII a même écrit une encyclique sur le Sacré-Cœur, Haurietes aquas (1956). Tout au long de l’histoire, il y a eu diverses inculturations de cette dévotion, sous diverses formes et langages, mais toujours pour que le Père nous révèle dans toute sa profondeur le mystère de Son Amour à travers un symbole privilégié: le cœur vivant de Son Fils Ressuscité. Car «le Cœur du Christ est le centre de la miséricorde», rappelle François.
Cette année, nous célébrons le centenaire de Marguerite-Marie Alacoque, canonisée le 13 mai 1920 par le pape Benoît XV. C’est avec l’aide du père Claude La Colombière, jésuite, que cette religieuse visitandine française du 17e siècle a fait connaître le message que le Seigneur ressuscité lui a révélé sur la profondeur de sa Miséricorde.
Par ailleurs, le 3e vendredi après la Pentecôte est célébrée la solennité du Sacré-Cœur, qui est aussi, depuis 2002, la journée de prière pour la sanctification des prêtres. Elle a lieu cette année le 19 juin.
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Feuillet du jeudi (4 juin) de la semaine de la Pentecôte : Les dons du Saint-Esprit (Dom Guéranger)
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire