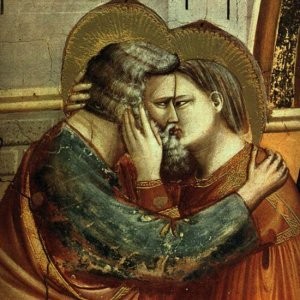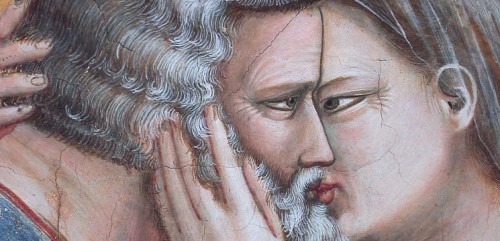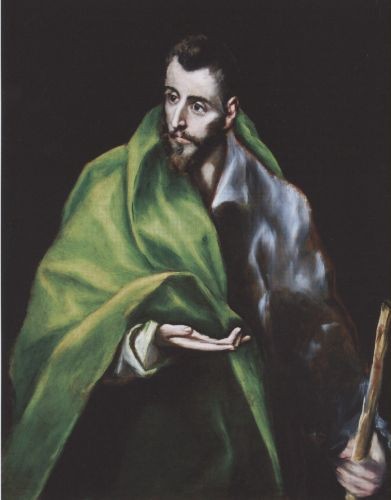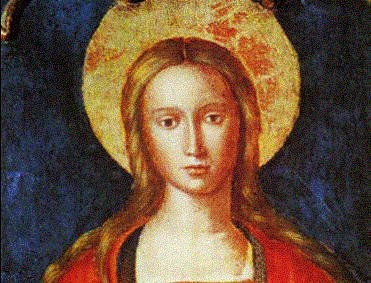D'Arnaud Dumouch sur "1000 raisons de croire" :
Saint Titus Brandsma : lumière dans l’enfer nazi
Prêtre carme et journaliste, homme « doux mais déterminé », Titus Brandsma utilise dès les années 1930 les journaux catholiques pour stigmatiser l’idéologie nazie comme « anti-humaine » et défendre la dignité de chaque personne. Ses écrits se heurtent au Reich, qui craint « ce professeur maléfique ». Arrêté et déporté à Dachau, il est exécuté par injection létale le 26 juillet 1942.
Les raisons d'y croire
- Après l’invasion des Pays-Bas par Hitler en 1940, le père Titus Brandsma aurait pu sauver sa vie si, comme beaucoup d’autres, il s’était fait discret en attendant que la guerre se passe. Mais il a préféré rester sur place en s’opposant ostensiblement au régime, alors qu’il était tout à fait au courant du sort qui l’attendait.
- Il s’oppose au nazisme, non par idéologie politique, mais par fidélité à l’Évangile et à la dignité humaine universelle qu’enseigne le Christ. C’est pour cela qu’il refuse de collaborer avec la puissance oppressive qu’est l’Allemagne du IIIe Reich.
- Son courage à défendre la vérité, même au risque de la mort, est un témoignage puissant. Ce courage face à la mort est alimenté par son espérance en la vie éternelle : « N’ayez pas peur de ceux qui tuent le corps... » ( Mt 10,28 ).
- L’attitude du père Brandsma dans le camp de Dachau révèle sa capacité de pardon et d’amour envers ses tortionnaires. D’un point de vue humain, cette attitude n’a pas de sens.
- En particulier, il faut souligner la façon dont il accompagne la petite infirmière chargée de lui injecter le produit létal. Elle raconte : « Il m’a pris la main : "Pauvre jeune fille que tu es, je vais prier pour toi !" » Il a tenu promesse depuis le Ciel et obtenu pour elle des grâces qui lui permettront par la suite de vivre avec le poids de ce qu’on l’avait forcé à faire, et de revenir à la foi catholique. « Le père Titus Brandsma, que je ne connaissais pas, m’a engendré à la grâce. »
- Le chemin de croix qu’il vécut à Dachau, son épuisement physique, son attitude édifiante et sa mort héroïque manifestent ce qu’il avait à l’intérieur de son âme : tout ce qu’il a enseigné n’était pas simplement parole. Son âme était réellement attachée au Christ plus qu’à sa propre vie.
- En 1983, en Floride, une religieuse carmélite contracte une forme grave de cancer grave, apparemment incurable. Après qu’elle a prié avec ferveur pour l’intercession de Titus Brandsma, sa guérison est rapportée comme totale et inexplicable du point de vue médical. Ce miracle a conduit à la béatification de Titus Brandsma en 1985.
- Le second miracle reconnu survient en 2004, lorsqu’un prêtre carmélite américain, frère Michael Driscoll, est atteint d’un mélanome métastatique avancé (stade IV). On lui remet un fragment du costume noir du père Brandsma, qu’il applique quotidiennement sur sa tête : le cancer disparaît complètement et les médecins signalent qu’il s’agit d’une rémission scientifique inexplicable.
En savoir plus
Titus Brandsma naît le 23 février 1881 aux Pays-Bas. Il faut savoir que ce pays, au moment de la Réforme, a basculé en grande partie dans le protestantisme. Titus est donc issu d’une vieille famille catholique, avec cette sensibilité particulière très différente de ce qu’on peut trouver dans le sud de l’Italie. La foi s’exprime de manière discrète et rigoureuse, sans démonstration excessive.