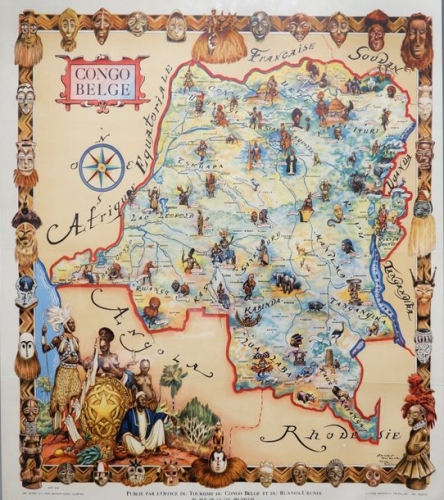"Justice et Paix vous propose une conférence animée à partir de récits vidéo, sonores de Congolais, depuis le boy – le domestique, le maçon, le Clerck – l’employé, le prêtre, l’étudiant, le militant au futur ministre, avec les photos et les documents de l’époque. Ces récits raconteront avec détails le Congo « colonie modèle », Léopoldville coupée en deux par un apartheid, le début des revendications politiques et sociales, le soulèvement de Léopoldville en janvier 1959, la Table ronde, l’indépendance et les événements dramatiques qui ont suivi. Cette histoire, racontée par les Congolais vient compléter et corriger l’histoire « officielle » de la colonie, écrite depuis longtemps par la Belgique uniquement. Les trois intervenants, François Ryckmans, journaliste, Julien Truddaïu, chercheur à la Coopération Education Culture, et Kentey Pini-Pini Nsasay, doctorant en sciences politiques, écrivain-conférencier, auteur entre autres de "Croisades de l’Europe christianisée contre l’Afrique ancestrale », proposeront une analyse contemporaine des faits afin de mieux comprendre le lien historique qui unit la Belgique et l’Afrique centrale, 60 ans après l’indépendance. Ces interventions seront suivies d’un débat qui sera modéré par Patrick Balemba (Justice et paix).
Lieu: Forum St Michel : Boulevard Saint-Michel 24, 1040 Bruxelles. Mardi 07.07.2020
En ce qui concerne Mr Kentey Pini-Pini Nsasay, un des orateurs de la soirée, voici un commentaire de son livre, cité plus-haut, sur le site du CMCLD (dont il est membre). https://www.memoirecoloniale.
"Cet ouvrage permet d’établir le lien entre la tragédie congolaise, africaine, et la prétention du christianisme romain de refaire le monde débouchant sur des massacres des peuples entiers. C’est un éclairage nouveau sur la terrible mise-à-mort du peuple congolais en particulier. Il apporte aussi des solutions nouvelles. Ainsi, plus que le simple refus des rites et autres pratiques du christianisme comme cela se remarque actuellement en Europe, ce livre préconise le rejet total de l’idéologie du royaume des cieux et appelle à l’autodissolution du christianisme romain pour le retour à un monde humain et harmonieux. Concernant l’avenir immédiat de l’Afrique où le christianisme s’est implanté par la confiscation des territoires des autochtones, l’ouvrage préconise que ces territoires soient rendus à leurs propriétaires traditionnels et que les entités missions et diocèses soient supprimées.."