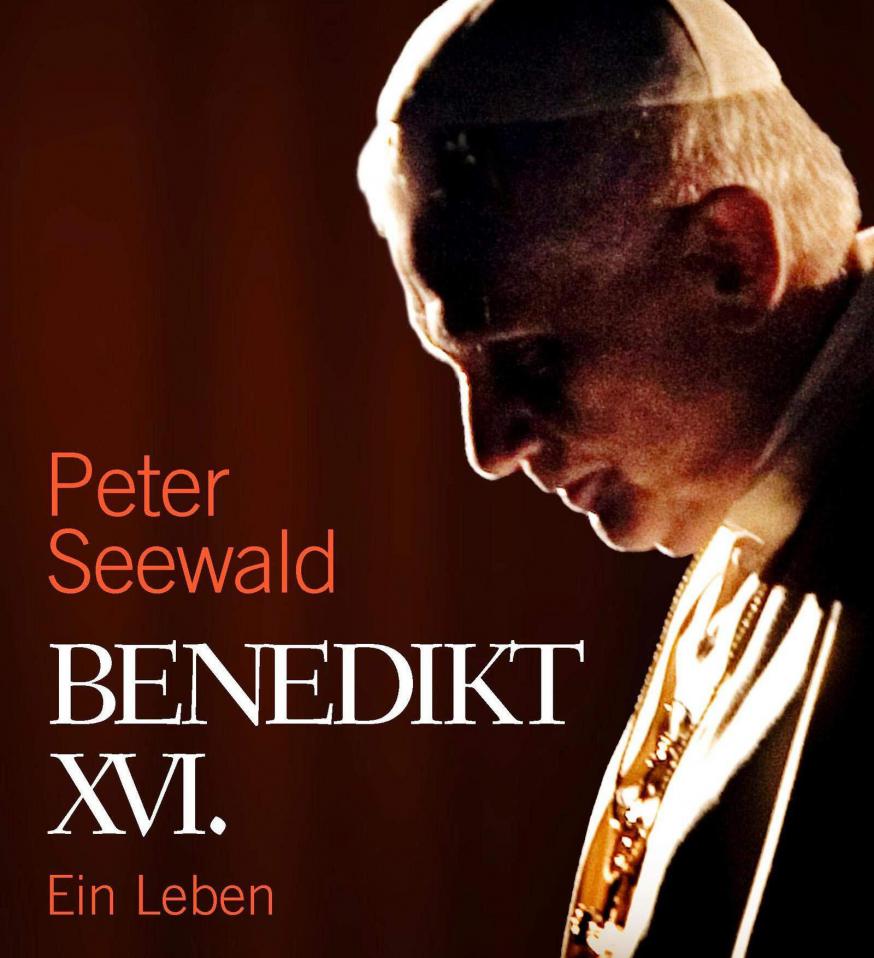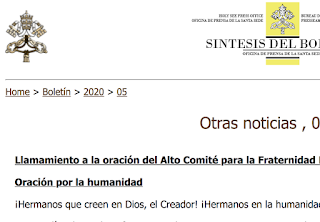De Paul Vaute sur le blog "Le passé belge" :
Civilisation, exploitation, exactions…: le Congo léopoldien (1)
Pour le Roi comme pour ses contemporains, il n’y avait pas de contradiction entre l’élévation des peuples coloniaux et l’enrichissement de la métropole. Mais sur le terrain, on ne peut nier que l’entreprise a dérapé, même si les accusations récurrentes furent au départ étroitement liées aux ambitions britanniques en Afrique centrale (1885-1908)

L’abondante bibliographie de notre histoire coloniale s’est enrichie de trois ouvrages centrés sur la période léopoldienne – la plus controversée, comme on le sait. Signe des temps: deux sont dus à des chercheurs natifs du Congo, dont un y vit. Leurs regards n’en divergent pas moins, exactement comme l’ont fait ou le font toujours ceux des acteurs, des témoins et des experts belges. Le livre de Mathieu Zana Etambala, docteur en histoire (Katholieke Universiteit Leuven), a été entrepris dans le prolongement d’un projet de recherches du Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren [1]. On y trouve brassées amplement les sources relatives aux débuts de la colonisation dans quatre régions tenues pour avoir été durement éprouvées: le royaume Kuba (qui résista longtemps à toute pénétration étrangère blanche ou noire), le Domaine de la couronne au lac Léopold-II (aujourd’hui Maï Ndombé), la province de l’Equateur et l’Ituri (ou Aruwimi). D’une tout autre tonalité, l’essai de Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo, chercheur et enseignant, docteur en géographie et pratique du développement, est un véritable plaidoyer pour l’œuvre africaine de notre deuxième souverain, sans pour autant faire l’impasse sur les zones d’ombres [2]. Venu un peu avant les deux précédents, Pierre-Luc Plasman a adapté sa thèse de doctorat, défendue à l’Université catholique de Louvain, en une étude où prévaut la volonté d’équilibrer les points de vue [3].
L’ampleur de ces travaux et du sujet lui-même justifie qu’exceptionnellement, deux articles consécutifs leur seront consacrés. Les trois approches, avec leurs spécificités, sont de celles qui redonnent la priorité à la quête du vrai, trop souvent altéré dans l’opinion commune par la masse des écrits passionnels.